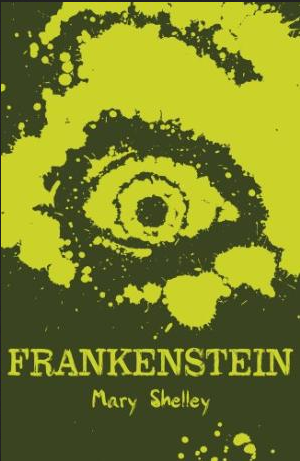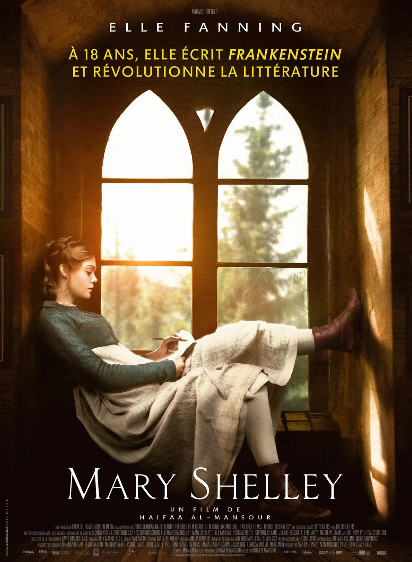Référence : Anne-Marie du Bocage, Les Amazones, tragédie. En cinq actes, Paris, chez F. Merigot, 1749, avec approbation et privilège du Roy. Réimpression à la demande du fichier numérisé de l’édition sur Gallica : Paris, Hachette/Bibliothèque nationale de France, sans date (commande passée en décembre 2018).
Une tragédie mythologique
Les Amazones est une tragédie mythologique dont le sujet s’inspire directement des auteurs antiques grecs et romains. L’action de la pièce se déroule à Thémiscyre, la capitale du royaume des Amazones, sur les bords du fleuve Thermodon. Au moment où la pièce commence, les Amazones, menées par leur reine Orithyie (orthographiée Orithie dans le texte), viennent de remporter d’éclatantes victoires contre le peuple voisin des Scythes, mené par le roi Gélon, mais aussi contre les Athéniens conduits par Thésée, qu’elles ont fait prisonnier. La question qui se pose alors est de savoir que faire du héros. En vertu des lois des Amazones, d’où l’amour est banni, tout homme capturé doit être mis à mort, et c’est ce que le peuple des Amazones réclame à la reine, par la bouche de la cheffe des armées, Mélanippe, de loin la plus belliqueuse de toutes. Mais Orithye temporise et tarde à trancher, laissant Thésée libre de ses mouvements en son palais dans l’intervalle.
La raison en est simple : la reine Orithye est tombée amoureuse de Thésée. Elle s’en ouvre à son amie intime, Antiope, princesse héritière du trône, et la presse de faire la cour à Thésée pour elle. S’il se laisse fléchir, Orithye est prête à tout pour le sauver ; sinon, dans sa colère, elle oubliera ses sentiments et trouvera enfin le courage de le faire exécuter. Mais Antiope a également un secret. Si Thésée a été capturée, c’est parce qu’au beau milieu de la mêlée, ébloui par la beauté d’une Amazone blessée, il a pris sa défense et a couru des risques inouïs, au point de se laisser isoler de ses troupes, emporter et capturer. Or cette Amazone, c’est elle… et elle nourrit également des sentiments pour le héros. Ce double affrontement, entre le sentiment et le devoir et entre deux amies devenues rivales, forme le cœur du mécanisme tragique, de la « machine infernale » que la capture de Thésée enclenche au palais de la reine des Amazones.
Une tragédienne à redécouvrir
J’ai découvert l’existence de Mme Du Bocage grâce au manuel scolaire Des femmes en littérature. 100 textes d’écrivaines à étudier en classe, coédité par Belin et les éditions Des femmes l’année dernière. Grand amoureux des mythes et par ailleurs pas du genre à refuser de beaux vers, j’ai été très heureux d’apprendre qu’une tragédie avait été consacrée aux Amazones dès le XVIIIe siècle, non pas par Corneille, Racine ou Rotrou, mais bien par une femme : Anne-Marie du Bocage (orthographié à l’époque « Boccage »), déjà connue à l’époque pour ses poèmes et pour une traduction du Paradise Lost de Milton. Les Amazones, lu et approuvé pour la représentation par nul autre que Fontenelle, semble avoir remporté un succès net, en dépit de quelques commentateurs immondément sexistes cités par son article sur Wikipédia (mais non sourcés pour le moment). Entre autres œuvres postérieurs, Mme du Bocage consacre une épopée à l’exploration des Amériques par Christophe Colomb. C’était l’une des premières femmes à s’illustrer dans ces deux grands genres poétiques, genres « nobles » par excellence, jusqu’alors pratiqués exclusivement par des hommes. Par quel mystère a-t-elle été oubliée en dépit de ses succès et de son statut de pionnière ? Je vais encore faire les gros yeux à la postérité, cette marionnette dont les ficelles ont été trop longtemps orientées par des mains mâles.
À la question, légitime, qui demanderait si cette pièce a d’autres mérites que d’avoir été écrite par une femme à une époque où c’était rare, je peux répondre : oui, sans hésitation. Son sujet est original (j’ai découvert depuis d’autres pièces consacrées aux Amazones au XVIIIe siècle, mais pas sous le même angle) et rien que son trio d’Amazones dans les rôles principaux suffit à justifier sa lecture. Les dilemmes, les craintes et les colères d’Orithye, d’Antiope et de Mélanippe sont dépeints en répliques d’une belle énergie, qui montrent une grande habileté à saisir les subtilités des passions humaines. La pièce est bien construite et son sujet, inspiré de personnages et d’épisodes célèbres sans coïncider tout à fait avec eux, rend sa découverte d’autant plus pleine de suspense, car rien ne permet de savoir comment la pièce va se terminer. On se doute que l’introduction de l’amour au pays des Amazones aura des conséquences funestes pour elles, tandis que Thésée, normalement, survit pour poursuivre son règne à Athènes et ses exploits ; mais qu’arrivera-t-il au juste ? Je me garderai bien de vous le dire, mais j’ai apprécié le choix d’un dénouement qui n’était pas celui auquel on pourrait s’attendre.
Dans un genre dominé par les figures féminines solitaires (Médée, Phèdre, Andromaque, Antigone), isolées parmi les hommes en dehors de confidentes occasionnelles et effacées, il est passionnant de voir le mécanisme tragique transposé dans un environnement entièrement féminin, où Thésée n’est qu’un enjeu. Le personnage du héros athénien apparaît d’ailleurs bien pâle par rapport aux héroïnes véritables de la pièce : il est manifeste qu’il n’est qu’un personnage secondaire, catalyseur du conflit davantage qu’acteur, bien que ses choix conditionnent et entretiennent l’engrenage tragique. Il ne reprend davantage le devant de la scène que vers la fin. J’ai noté avec intérêt, d’ailleurs, que plus la tragédie avance, plus les hommes réinvestissent la scène, cernant et contraignant de plus en plus le royaume des Amazones (même si pas toujours de la façon qu’on pourrait croire).
Au moment où j’écris, il n’existe pas d’édition des Amazones aisément accessible au grand public. L’édition que je chronique ici est une impression à la demande et à l’identique de la première édition du texte en 1749, sous une reliure brochée et une couverture souple. Dépourvue d’introduction ou de notes qui en éclaireraient le contexte ou les difficultés de langue propres à une œuvre de cette époque, cette édition présente des obstacles typographiques à la lecture pour qui n’a pas un peu tâté des ouvrages anciens : par exemple, elle utilise le s long ſ, ancienne forme du s qui ressemble furieusement à un f, ce qui peut donner l’impression trompeuse que tous les personnages parlent comme le chat Grosminet (« Reine, dont les vertus paſſent l’éclat du thrône… ») et altère quelque peu l’atmosphère solennelle de la tragédie. J’ai pu surmonter l’obstacle sans problème, mais le lectorat grand public, notamment les élèves et les étudiants, ne devrait pas avoir à se le coltiner.
Il existe, depuis peu, deux éditions scientifiques de la pièce, qui la regroupent toutes les deux avec d’autres tragédies de la même époque : le tome II de l’anthologie Femmes dramaturges en France, 1650-1750, réunie par Perrine Gethner en 2002, et le tome IV de l’ouvrage collectif Théâtre de femmes de l’Ancien Régime, réuni par Aurore Evain, Perry Gethner et Henriette Goldwyn en 2015. Mais ce sont d’épais et coûteux volumes, destinés à un public d’universitaires ou d’étudiants spécialisés. L’étape d’après – et je me joins à celles et ceux qui l’appellent de leurs vœux – serait une édition de la pièce seule, avec apparat critique, dans une édition de poche plus accessible. De cette façon, la pièce pourrait, pourquoi pas, figurer bientôt au programme d’un concours ou d’un examen. Il me paraît indéniable qu’elle présente l’intérêt littéraire nécessaire pour cela. Plus généralement, une réédition commentées des œuvres complètes de Mme du Bocage ne serait pas un luxe.
Une telle tragédie ne manquerait pas, non plus, d’alimenter l’inspiration des artistes, à commencer par les troupes de théâtre, qui feraient bien de s’y intéresser. Je rêve aussi à ce que les dramaturges et metteuses en scène d’aujourd’hui pourraient créer en s’inspirant librement du sujet de la pièce pour en écrire et en monter une au goût du jour.



 Publié par Liber
Publié par Liber