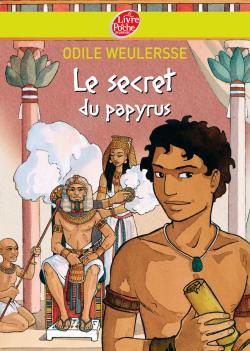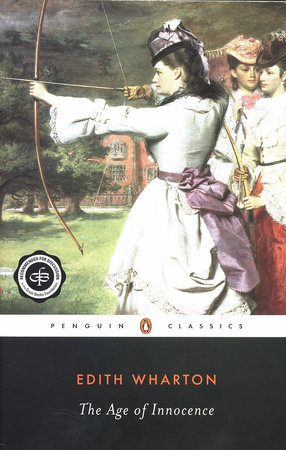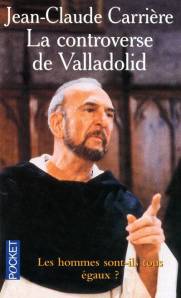Référence : Odile Weulersse, Disparition sur le Nil, Paris, Hachette jeunesse, Le livre de poche jeunesse, 2006 (lu dans une réédition de 2007).
Quatrième de couverture de l’éditeur
« Rouddidite, la femme du nain Penou, a disparu. Qui l’a enlevée ? Où la retrouver ? Tétiki, Penou et le singe Didiphor partent à sa recherche dans le désert de l’Ouest, dans les mines d’or de Nubie et jusqu’au pays de Kousch (sic, pour « Koush »). Naufrage, emprisonnement, forteresse imprenable et ruse de la perfide espionne Makaré jalonnent cette poursuite, où Tétiki va encore faire preuve de tout son courage. »
Mon avis
Après Les Pilleurs de sarcophages et Le Secret du papyrus, que j’ai tous deux chroniqués ici, Disparition sur le Nil forme le troisième volet de la trilogie de la romancière pour la jeunesse Odile Weulersse consacrée aux aventures de Tétiki et Penou en Égypte ancienne, au temps du pharaon Ahmôsis Ier. S’il reste possible de le lire indépendant des autres, on en profite nettement mieux en ayant d’abord lu les deux volumes précédents, puisqu’il met en scène les mêmes personnages principaux, qui ont encore grandi et accédé à de nouvelles responsabilités, et qui vont se trouver confrontés à leurs vieux ennemis.
Ma lecture de ce volume a commencé par une surprise désagréable : les images intérieures sont de mauvaise qualité, très pixélisées. Cela rend la lecture de la carte géographie qui ouvre le livre plus difficile (certains noms écrits en petite taille en deviennent illisibles). C’est aussi très gênant pour les illustrations, puisque, contrairement aux deux volumes précédents, celui-ci ne contient aucune illustration en pleine page, mais uniquement des images de petite taille en tête de chapitre… dont les détails délicats sont massacrés par la pixélisation, donc. Une négligence coupable de la part de l’éditeur, au point que j’aurais envisagé de ne pas acheter le livre si je m’en étais rendu compte avant l’achat (je n’ai pas eu l’occasion de le feuilleter avant de l’acheter). Comme, en plus, le roman est bien intéressant, je lui souhaite de bénéficier d’une réédition qui corrigera ces manquements fâcheux !
Notons que le livre se termine par deux pages de vulgarisation historique et géographie au sujet du Nil, dont les personnages remontent le cours au fil des chapitres.
Comme dans les deux romans précédents, l’aventure et le voyage restent les maîtres-mots de l’intrigue, qui s’ancre avec précision dans le temps et l’espace de l’Égypte ancienne. Cette fois, nos héros se dirigent vers le Sud, au sein d’une expédition militaire d’Ahmôsis, déterminé à reprendre le contrôle des mines d’or de Nubie et des forteresses égyptiennes conquises par le royaume de Koush, avec lequel l’Égypte voisine au sud, pendant la période de la domination hyksôs. Les différentes forteresses et les mines correspondent à des localités antiques réelles ayant donné lieu à des fouilles archéologiques. L’annexe en fin de livre indique que certaines forteresses ont été englouties dans le lac Nasser au moment de la mise en service du barrage sur le Nil dans les années 1960 (contrairement au temple d’Abou Simbel, qui a été déplacé moyennant d’énormes travaux et a ainsi pu être préservé).
En dehors de ces visites de lieux célèbres, l’intrigue se renouvelle avec des événements jamais vus dans les deux volumes précédents, notamment une inondation qui scelle le sort d’un personnage récurrent de la trilogie. Plusieurs animaux sauvages dépaysants interviennent également dans l’histoire, avec, parfois, un rôle important.
Les personnages, quant à eux, sont encore approfondis par rapport au roman précédent, moins dans leurs relations que dans les détails de leur histoire personnelle. Tétiki a bien entamé sa dix-septième année et est donc presque adulte ; son rôle dans les dernières péripéties du Secret du papyrus l’a engagé fermement dans une carrière militaire. J’ai trouvé qu’on ne savait pas grand-chose de ses émotions ou de ses réflexions sur ce sujet (cela m’avait un peu manqué dans le final du roman précédent, mais c’est dans celui-ci que l’absence de ce type de détail m’a le plus manqué). Ses liens affectifs avec Penou, Rouddidite et Ramose sont mieux évoqués. Je me suis parfois demandé comment Tétiki et Penou parvenaient à rester amis puisqu’ils n’arrêtent pas d’être en désaccord et de se chambrer l’un l’autre sans beaucoup d’humour ; au moins, leur inquiétude l’un pour l’autre en cas de péril rend leur amitié plus sensible. Tétiki garde un côté jeune premier générique un peu décevant par rapport au degré d’approfondissement dont il bénéficiait dans le premier volume. Rouddidite, de son côté, se trouve moins mise en avant que dans Le Secret du papyrus où elle apparaissait pour la première fois, et le rôle peu glorieux de femme enlevée qu’elle endosse dès les premières pages m’avait laissé craindre le pire, mais elle arrive à faire deux ou trois choses importantes.
Le personnage qui bénéficie de tous les soins de l’auteur dans ce volume reste visiblement Penou, qui a bien mérité sa place sur la couverture. Quand on sait qu’Odile Weulersse n’avait pas planifié dès le départ d’écrire une trilogie, on ne peut que constater à quel point elle tire ingénieusement parti des détails sur l’histoire personnelle des héros qu’elle avait semés dans le premier roman puis dans Le Secret du papyrus. C’est en effet grâce à son passé d’esclave que Penou se trouve être le personnage qui connaît le mieux la région où il doit se hasarder de nouveau, cette fois accompagné de Tétiki. Ses sentiments pour Rouddidite sont, en outre, toujours aussi vifs, et il joue un grand rôle à plusieurs moments de l’intrigue où il se trouve séparé de Tétiki. Après Penou, le personnage le mieux utilisé m’a paru être Didiphor, qui n’a pas fini de montrer son intelligence, mais devient aussi parfois un enjeu dramatique en tant qu’animal vulnérable (la maltraitance gratuite d’animaux étant un moyen classique et efficace de montrer la méchanceté d’un « méchant » dans un roman d’aventures).
En dépit du côté un peu routinier que prennent les aventures de Tétiki et Penou quand on en enchaîne la lecture en peu de jours, j’ai donc trouvé que Weulersse parvenait à se renouveler en termes d’intrigues, et ce n’est pas sans émotion que j’ai assisté à leur confrontation finale avec leurs derniers ennemis et au dénouement qui les voit accéder au statut d’adultes.
Au chapitre des regrets, le style et l’approfondissement de l’intériorité des personnages m’ont paru inégaux selon les scènes. J’ai parfois eu le sentiment que Weulersse faisait avancer son histoire à marche forcée pour accumuler les péripéties. Par exemple, la fin d’un des personnages récurrents de la trilogie, qui survient dans les premiers chapitres, est relatée d’une manière assez abrupte et décrite sans grande émotion de la part des personnages par rapport à l’importance de l’événement. De ce point de vue, heureusement, le roman s’améliore dans sa seconde moitié, comme si la perspective de devoir dire au revoir à ses héros avait incité l’autrice à s’appesantir davantage sur leurs émotions. Enfin, si de manière générale Weulersse est toujours aussi habile à insérer dans ses histoires des détails de la vie quotidienne et de l’histoire antique, certains détails de l’intrigue pèchent par manque de vraisemblance, notamment l’absence de Rouddidite lors de la dernière grande scène avec Makaré, alors qu’elle a toutes les raisons de se trouver là, et le peu d’émotions qu’elle manifeste après cette confrontation. Je crois néanmoins que ce type de roman jeunesse doit probablement répondre à des contraintes fortes, notamment en termes de nombre de caractères, qui ne doivent pas faciliter un traitement régulier de tous les aspects d’une histoire.
En dépit de ces quelques réserves, j’ai eu beaucoup de plaisir à suivre Tétiki, Penou et Rouddidite dans ces trois romans. Je suis très heureux d’avoir pris la peine de revenir sur Les Pilleurs de sarcophages une fois adulte, car cela m’a permis de me pencher sur la manière dont Weulersse avait conçu ce roman et ses suites, et de prêter l’attention qu’il mérite à l’important travail de documentation et de conception d’intrigue qui préside à ce type de livre. Une fois un roman terminé, tout peut sembler s’enchaîner avec facilité, mais cela n’a en réalité rien de simple de conjuguer harmonieusement des aventures variées, crédibles et haletantes vécues par des personnages tout jeunes, la mise en scène d’une époque lointaine pas nécessairement plus favorable à la liberté de mouvement des jeunes gens que la nôtre, et un soin de vulgarisation historique constant qui ne relève pas du cours d’histoire mais se glisse à toute occasion dans les ressorts même de l’intrigue. Il faut un véritable talent de romancière pour y parvenir, et Weulersse possède sans aucun doute un grand talent dans ce domaine. Si elle n’est pas la meilleure sur le plan du style, peu d’auteurs parviennent aussi bien qu’elle à marier l’Histoire et le roman sous une forme aussi instructive, divertissante et accessible.




 Publié par Liber
Publié par Liber