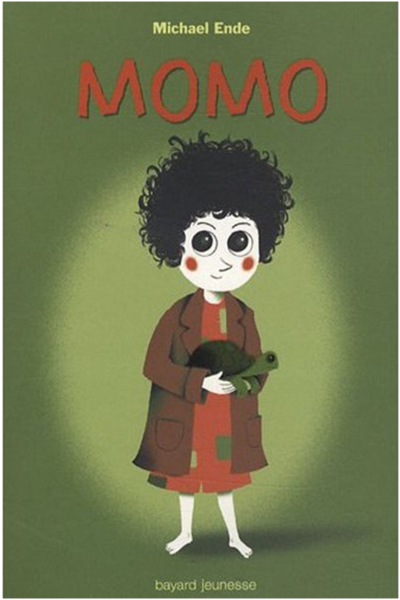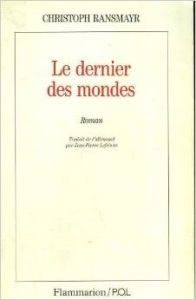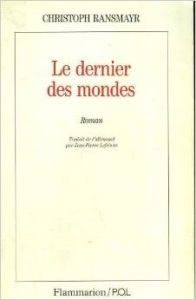 Référence : Christoph Ransmayr, Le Dernier des mondes, traduit de l’allemand par Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Flammarion/P.O.L., 1989 (titre original : Die Letzte Welt, Nördlingen (R.F.A.), Greno Verlagsgesellschaft, 1988).
Référence : Christoph Ransmayr, Le Dernier des mondes, traduit de l’allemand par Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Flammarion/P.O.L., 1989 (titre original : Die Letzte Welt, Nördlingen (R.F.A.), Greno Verlagsgesellschaft, 1988).
Quatrième de couverture
« Christoph Ransmayr est né en 1954 à Wels en Haute-Autriche. Après des études de philosophie à Vienne, il est pendant plusieurs années chroniqueur culturel. Depuis 1982, il se consacre entièrement à la littérature. Il a écrit un premier roman, Les effrois de la glace et des ténèbres (1984).
Le dernier des mondes
Le poète latin Ovide a été condamné à l’exil par l’empereur Auguste, aux confins du monde barbare, sur les bords de la mer Noire : à Tomes, la ville de fer.
Quelques années plus tard, un de ses disciples, Cotta, embarque dans l’espoir de retrouver le poète et son manuscrit des Métamorphoses. Mais à peine arrivé, il entre dans un univers étrange, halluciné. Rêve et réalité, présent et passé se mêlent, changent les rôles, brouillent les pistes. Il semble qu’Ovide, introuvable, soit cependant partout… Cotta piétine. Mais au long de son enquête, au long de sa quête, il croisera Echo, la belle couverte d’écailles, un montreur de films ambulant, un fossoyeur allemand, une fileuse sourde-muette, Pythagore, l’énigmatique serviteur d’Ovide, et beaucoup d’autres : toute une population inquiétante, instable, changeante… Au fil de ces rencontres et de mystère en mystère, il comprendra que tout change, tout se transforme. Et il retrouvera la trace d’Ovide bien loin de là où il l’attendait…
Magnifiquement traduit par Jean-Pierre Lefebvre, Le dernier des mondes, chef-d’œuvre du réalisme magique, connaît un immense succès en Allemagne. Il est en cours de publication dans le monde entier. »
Mon avis
Le Dernier des mondes est donc paru en 1988. Je l’ai trouvé dans la première édition de sa traduction française de 1989, en grand format, en bibliothèque, mais je précise qu’il en est paru au moins une édition en poche ensuite.
Au premier abord, on pourrait croire à une fiction péplumesque, un de ces romans policiers à l’antique comme il s’en écrit beaucoup, que ce soit à destination des adultes (il y en a pas mal aux éditions 10/18, des livres comme Aristote détective de Margaret Doody) ou de la jeunesse (le très classique L’Affaire Caïus d’Henry Winterfeld en 1953, les tout aussi classiques romans historiques d’Odile Weulersse, ou plus récemment les enquêtes de Titus Flaminius de Jean-François Nahmias ou encore Les Enquêtes d’Antisthène de Martial Caroff, etc.). Le point de départ de l’intrigue semble très antique : Cotta, un ancien admirateur d’Ovide, finit par partir à la recherche du poète disparu dans la ville de son exil, à Tomes, quelque part en Europe de l’Est. Après tout, tout comme Ovide et les Métamorphoses, Cotta a réellement existé, de même que Tomes.
En réalité, on se rend compte très vite que les choses sont plus complexes, car les vêtements, la technologie et même en partie l’état d’esprit des personnages du roman relèvent de la première moitié du XXe siècle européen. Aurions-nous affaire, alors, à une uchronie prolongeant la domination romaine bien après l’Antiquité (là encore, les exemples ne manquent pas, par exemple Reconquérants de Johan Heliot en 2001 ou Roma Æterna de Robert Silverberg en 2003) ? Non plus, car il n’y a pas de jeu délibéré avec le déroulement réel de l’Histoire, et, à vrai dire, le roman ne met en avant aucune divergence de fond avec l’histoire antique, à cela près que le décor est celui de la société et des techniques du XXe siècle. La transposition au XXe siècle des débuts du principat d’Auguste est en revanche pour l’auteur un moyen de mettre en scène un empire romain dictatorial voire vaguement totalitaire, mais ce dernier n’est évoqué qu’à distance, par les souvenirs de la vie d’Ovide ou de la jeunesse de Cotta. Le commentaire politique ne se joue pas dans un affrontement direct avec les réalités de Rome, mais dans l’évocation d’une capitale qui, quoique aussi fastueuse qu’étouffante, demeure toujours lointaine et sans réel impact sur les événements qui se nouent à Tomes. Car Tomes, comme l’auteur l’indique dès les premières pages du roman, est un lieu coupé du monde. C’est « le trou ».
Un trou qui n’est pas sans intérêt, pourtant, car c’est sur cette ville hors du monde, entre la grisaille perpétuelle et les durs rochers de la montagne, que se concentre l’intrigue. Le Dernier des mondes m’a surpris de ce point de vue, car c’est un livre dont j’ai entendu parler et sur lequel j’ai commencé à rêver plusieurs mois avant de commencer à le lire, et je me suis rendu compte que j’avais plus ou moins imaginé ma propre version de l’histoire, que je concevais comme un voyage vers des contrées encore plus lointaines que Tomes, alors que ce n’est pas du tout ce que fait Ransmayr. Ni roman policier, ni roman d’aventure ou de voyage, Le Dernier des mondes est ce qu’on pourrait qualifier en très gros de roman d’atmosphère. Si vous êtes incapable de braver quelques centaines de pages sans votre dose de bouleversements cosmiques, de combats endiablés ou de révélations ébouriffantes, vous vous ennuierez sans doute, mais, si vous appréciez les romans comme Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq où ce ne sont pas tant les événements que les sensations, les rêveries et le cheminement des pensées du personnage qui créent le suspense, ou encore ces jeux vidéo des années 1990 du type L’Amerzone ou Atlantis où l’on peut se promener pendant des demi-heures entières dans un phare désert ou un cercle de mégalithes sous un ciel d’orage, en quête d’une inscription trahissant un secret ou d’un sanglier qui n’en est pas vraiment un, vous devriez apprécier de suivre Cotta dans sa recherche malaisée d’Ovide et du texte des Métamorphoses, poème qui, dans le roman, a disparu au moment de l’exil du poète, alors qu’il s’annonçait comme son chef-d’œuvre.
Bien que le véritable voyage de Cotta ne soit pas une odyssée au sens géographique du terme, le roman ne manque nullement d’éléments fantastiques. Le fantastique se fait sentir dès l’arrivée dans ce monde à part qu’est Tomes, mais il se révèle un peu plus à chaque chapitre, au fil d’une quête où Cotta découvre peu à peu les habitants de la ville, leur vie, leur passé et leurs secrets, tout en croyant toujours se rapprocher d’Ovide. Le jeu qui se met en place, pour Cotta mais surtout pour les lecteurs, est alors un jeu cultivé dans lequel nous sommes invités à reconnaître ou à soupçonner, ici ou là, l’apparition d’une figure mythologique dont nous savons (ou dont nous gagnons à savoir) qu’elle vient précisément des Métamorphoses d’Ovide. Lycaon, Echo, Narcisse, Cyparissus, Térée, Philomèle et Procné, sont quelques-uns des personnages que Cotta rencontre ou côtoie à Tomes. Mais Ransmayr joue avec habileté sur ce jeu des reprises et des différences : il semble décevoir nos attentes, pour mieux réinventer ces personnages qui ne seront jamais exactement les figures mythologiques fameuses qu’on connaît déjà, mais en garderont toujours certains traits.
Ce jeu cultivé suppose que les lecteurs connaissent déjà, au moins un peu, la mythologie gréco-romaine, voire les Métamorphoses elles-mêmes, au moins dans leurs grandes pages. Par bonheur pour les gens qui n’ont pas cette chance, le roman est complété, en annexe, par un lexique des personnages historiques et mythologiques qui montre côte à côte leur histoire ou leur mythe antique et ce que Ransmayr fait d’eux dans le roman. Personnellement, comme je connaissais déjà bien la mythologie gréco-romaine et Ovide, je ne m’en suis servi qu’à la fin, pour approfondir la lecture à propos des personnages les moins connus (Cotta lui-même, par exemple). Mais ce lexique permet aux lecteurs de procéder chacun à sa façon, en s’y reportant avant, pendant ou après la lecture du roman. J’espère surtout qu’il a été inclus dans les rééditions en poche du livre, car il forme une annexe vraiment utile.
Mais malgré son caractère assez classique de roman réécrivant les mythes, la grande force du Dernier des mondes est de parvenir à réinventer ces personnages et de mettre en place un univers hybride original qui relève bel et bien du réalisme magique, au même titre que les romans d’un Gabriel Garcia Marquez ou d’un Alejo Carpentier. Le résultat est un mélange d’histoire romaine, d’imagerie du XXe siècle, de réécriture mythologique et de réflexion hallucinée sur la condition humaine. De ce dernier point de vue, Ransmayr reprend la réflexion qui était celle d’Ovide lui-même dans les Métamorphoses, qui se fondaient grosso modo sur le pythagorisme pour décrire les changements perpétuels du monde. De là vient le nom du serviteur d’Ovide à Tomes, Pythagore, et de là aussi le cheminement intellectuel de Cotta au fil du roman, nourri par les rencontres avec des personnages eux aussi marqués par des transformations plus ou moins consenties.
Le tout est grandement servi par une écriture d’une maîtrise impressionnante. Ransmayr élabore ici une belle prose capable aussi bien de périodes élégantes et ciselées, encore enrichies par un vocabulaire très riche, que d’énoncés plus ramassés dont le tranchant vient marquer la fin d’un développement, un retournement ou un argument inattendu, ce qui permet au roman de ménager un intérêt dramatique et même un suspense constant. La distance que conserve toujours le narrateur envers Cotta lui permet de nous faire apercevoir, par-dessus son épaule, les rouages implacables et sclérosés de la machine impériale ou les mystères de Tomes, qu’il ne dévoile jamais tout à fait. Le quatrième de couverture vante la traduction de Jean-Pierre Lefebvre, et, même si je ne suis pas capable de la juger par rapport au texte original, j’ai été impressionné par la maîtrise de la langue et de l’ample vocabulaire dont témoigne le texte français, qui semble largement approprié pour rendre la richesse du style de l’auteur.
Personnellement, j’ai été très sensible à ce travail sur la langue ainsi qu’au réalisme magique qui irrigue tout le livre. J’avoue avoir été un peu moins convaincu par ce que cette esthétique peut avoir de complaisamment fataliste, car les figures du roman, y compris Cotta, ne sont réinventées d’après Ovide que pour mieux se figer dans des poses désespérées. Cette ville de Tomes où tout le monde semble voué à une condition nécessairement miséreuse, douloureuse ou mesquine, à la bordure d’un empire où la dictature semble elle aussi une fatalité, relève d’une esthétisation du pessimisme qui a quelque chose de facile et d’assez convenu, de nos jours comme en 1988. Malgré ces réserves, l’originalité du livre pour ce qui est du réalisme magique et sa maîtrise formelle, tant dans le style que dans la construction d’une réécriture des mythes, en font une lecture recommandable pour quiconque apprécie ce type d’univers.




 Publié par Liber
Publié par Liber