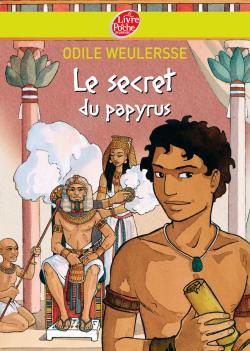Référence : Alejo Carpentier, Le Partage des eaux, Paris, Gallimard, 1956, rééd. Folio. (Los Pasos Perdidos, 1953.)
Référence : Alejo Carpentier, Le Partage des eaux, Paris, Gallimard, 1956, rééd. Folio. (Los Pasos Perdidos, 1953.)
Présentation de l’histoire
Le narrateur de ce roman, qui parle à la première personne, vit dans la première moitié du XXe siècle, sans doute quelque part aux États-Unis (le lieu et l’année exacts restent volontairement indéterminés). Il est marié à une actrice, Ruth, mais leur mariage bat de l’aile, noyé dans une routine mécanique ; il entretient une liaison avec une mondaine appelée Mouche. Au début du roman, le narrateur étouffe sous l’artificialité de son univers quotidien. Autrefois musicologue, il est également compositeur, mais son rêve de composer une œuvre réellement novatrice s’est toujours soldé par un échec, et il végète dans des travaux publicitaires. Lorsqu’il reçoit une proposition inattendue de la part d’un conservateur de musée, un financement pour un voyage en Amérique du Sud à la recherche d’exemplaires d’instruments de musique de peuples dits primitifs, il est d’abord dérouté, puis accepte contre toute attente.
Il part, accompagné de Mouche, d’abord avec l’intention de profiter de l’argent pour s’offrir de simples vacances et tromper le collègue qui l’a financé en se contentant d’acheter les premières répliques d’instruments qui lui tomberont sous la main. Mais à mesure que les imprévus et les impondérables s’accumulent et que sa relation avec Mouche se dégrade à son tour, le narrateur est peu à peu envahi par un désir plus profond de voyager. Il décide alors d’entreprendre pour de bon la mission de recherche qui lui a été confiée. Il s’enfonce dans la jungle amazonienne, où il fait la connaissance de plusieurs compagnons et guides de voyage : Yannes, le chercheur d’or grec ; l’Adelantado, le religieux en contact avec ces peuples « sauvages » de la jungle ; et Rosario l’indigène, une femme différente de tout ce qu’il a connu auparavant. Son périple dans la forêt prend l’allure d’une véritable quête initiatique qui lui fait entrevoir la possibilité d’une vie radicalement différente de son univers familier, hors de l’espace et du temps européens. Mais il n’est pas si facile de laisser son ancienne vie derrière soi.
Mon avis
D’Alejo Carpentier, j’avais déjà lu et évoqué ici Le Royaume de ce monde, livre aux fausses allures de roman historique, qui inventait un « réalisme merveilleux » consistant à relater des événements réels (la révolte des esclaves noirs de Saint-Domingue, future Haïti) en les revêtant d’une causalité magique. J’avais été impressionné par la virtuosité de la prose classique de Carpentier, dont la maîtrise ressort à un tel point dans la traduction qu’on croirait le roman bel et bien écrit en français et non en espagnol. Mais la beauté du livre avait quelque chose de glacé et de marmoréen qui m’avait empêché de m’immerger dans l’intrigue et de partager pour de bon les mésaventures du personnage principal ; la prose ciselée avait quelque chose d’un monument aussi froid que la forteresse d’Haïti dont il était question dans le livre, et ses personnages ne m’avaient pas paru pleinement vivants.
J’ai retrouvé dans Le Partage des eaux les mêmes qualités, mais avec des réserves différentes.
L’écriture de Carpentier, pour commencer, impressionne au moins autant dans ce roman que dans Le Royaume de ce monde. Même virtuosité dans l’écriture, mêmes longues phrases sinueuses au riche vocabulaire qui tracent ici en linéaments adroits les réflexions du narrateur, même talent incontestable dans l’évocation des paysages, notamment, qui donnent lieu ici à des passages somptueux, comme la plongée de l’expédition dans la jungle ou l’arrivée dans le lieu secret qui en forme le cœur hors du temps, sans parler des réflexions amenées par les derniers chapitres, dont je ne dévoilerai pas le contenu pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte, et qui donnent beaucoup à réfléchir.
Contrairement au héros du Royaume de ce monde, le narrateur du Partage des eaux est immédiatement vivace et crédible : Carpentier met ses connaissances visiblement nombreuses au service de la construction de ce personnage de musicologue à l’ample culture, musicale mais aussi livresque. Le sentiment d’échec personnel du narrateur, son passé familial, sa vie sentimentale sont brossés par touches progressives au fil des chapitres et bâtissent un personnage d’une grande complexité, avec ses espoirs, ses mesquineries et ses contradictions, assez imparfait pour obliger les lecteurs à un certain recul tout en entretenant leur empathie, condition indispensable pour nous permettre de suivre ce voyageur tout au long de son voyage. De ce point de vue, donc, Le Partage des eaux est un roman plus vivant que le précédent que j’avais lu.
Ce qui m’a posé problème dans ce roman a été avant tout la représentation qu’il donne des peuples à bas niveau technologique qui vivent dans la jungle (pour les lieux du voyage comme pour le lieu de départ, l’auteur s’abstient volontairement de situer son intrigue dans un cadre géographique précis, mais on pense naturellement à l’Amazonie). Il faut certes faire la distinction entre les pensées que Carpentier prête à son personnage et ses propres réflexions : au début du roman, le narrateur nourrit des préjugés naïfs envers le monde qu’il s’apprête à découvrir, et le roman se veut l’histoire de sa découverte de ces peuples et de ces régions autres, une découverte qui le bouleverse. Dans les propos qu’il prête au narrateur, Carpentier pourfend à plusieurs reprises le primitivisme qui voudrait assigner à ces peuples un rang inférieur aux peuples européens ou nord-américains dans une hiérarchisation qu’il rejette. Le problème, c’est que le propos du roman n’est pas sans contradictions sur ce plan-là. Non pas seulement au début mais tout au long du livre, on a souvent l’impression que le narrateur et/ou l’auteur balayent un préjugé d’une main pour mieux en reprendre naïvement un autre quelques pages ou même quelques lignes après. C’est notamment le cas de l’idée, très européenne, selon laquelle ces peuples seraient des peuples « sans Histoire » : le narrateur rejette ouvertement ce préjugé colonialiste, mais ses réflexions un peu plus loin n’ont pas l’air sous-tendues par autre chose.
L’ambivalence du propos du narrateur et du roman lui-même provient d’un parti pris qui s’affirme de plus en plus clairement au fil des chapitres : la recherche d’une forme d’universalité dans un symbolisme emprunté aux grandes œuvres de la culture occidentale, principalement européenne. Ainsi, le narrateur ne peut s’empêcher de considérer les avanies et les revers qu’il subit comme autant d’épreuves sur ce qu’il se représente comme un chemin initiatique par lequel il espère parvenir à une forme de purification, à l’opposé de l’artificialité creuse dont il était prisonnier avant son départ. Le choix de ne jamais situer l’action du roman dans un référentiel géographique précis (on sait que le narrateur se rend en Amérique du Sud, mais les repères géographiques, assez vagues, disparaissent bientôt complètement) a tôt fait de faire basculer l’histoire dans le domaine du symbolisme propre au mythe, ou en tout cas à une vision mythologisante de la réalité. Partout, dans les lieux, les paysages, les rencontres et les événements, le narrateur s’imagine en train de revivre ici l’Odyssée, là la Bible, ailleurs tel autre page empruntée à un monument culturel européen. Plus on avance, plus il devient clair qu’à ses yeux, il ne s’agit pas d’un voyage précisément situé dans le temps et l’espace, mais de la réitération d’une série de péripéties fondatrices ou refondatrices, pratiquement cosmogoniques, qui l’amèneront à la découverte d’une Vérité ou plutôt à la redécouverte d’une sincérité ou d’une innocence perdue dans son rapport au monde.
Or, dans cette vision des choses, les indigènes revêtent le rôle de gardiens secrets de ce trésor spirituel que l’homme européen aurait perdu depuis longtemps. Et le narrateur a beau affirmer qu’ils ne sont pas pour lui des primitifs, ils n’en restent pas moins enfermés dans cette grille plaquée sur tout ce qui lui arrive, et selon laquelle ils n’ont bel et bien pas bougé depuis le Déluge biblique, contrairement aux autres hommes. Seul l’homme européen ressent le poids de l’Histoire et se sent, de ce fait, vieux, coupable, prisonnier de ce que le narrateur rejette bientôt comme une culture aliénante, voire décadente ; les peuples de la jungle, en revanche, ont seuls préservé une jeunesse à l’échelle du monde qui n’est pas séparable d’une innocence tout infantile, visible dans leur façon de penser qui ne comprend rien à la rationalité (façon de penser incarnée par Rosario).
À cette persistance d’une vision paternaliste des peuples indigènes sud-américains, on pourrait ajouter la persistance d’une vision des femmes ingénument patriarcale. Dans le roman de Carpentier, les femmes dites civilisées, c’est-à-dire Ruth et Mouche, sont toutes un peu des Pandore, placées sous le signe de l’artificialité, c’est-à-dire du maquillage, du théâtre, de l’hypocrisie. Ce sont elles, et non les personnages masculins, qui incarnent par excellence le danger de l’enfermement dans les usages de la culture d’origine du narrateur, dans une routine creuse et aliénante dont il comprend qu’il doit se défaire pour retrouver la voie de la création artistique véritable. Ni le Conservateur du Musée, ni Yannes ou les autres personnages masculins, dont certains pourraient pourtant incarner au même point (voire davantage) le pouvoir aliénant de la société que fuit le narrateur, ne font l’objet de passages aussi férocement caricaturants. Rosario, de son côté, touche à l’extrême inverse, avec son côté femme-enfant ou petit animal apeuré ; heureusement, elle gagne en complexité au fil des chapitres.
Au fil de la lecture, je me suis souvent demandé dans quelle mesure Carpentier disposait d’un réel surplomb par rapport aux idées qu’il prête à son personnage principal, et s’il avait réellement prévu de le rendre aussi tête à claques par endroits. S’il est clair que le narrateur du Partage des eaux n’est absolument pas conçu pour être parfait, ni pour porter telles quelles les idées de l’auteur, la lecture d’autres fictions de Carpentier montre que ce penchant pour le symbolisme mythifiant par références érudites interposées n’est pas du tout spécifique au personnage, mais représente une tendance de l’auteur lui-même. À partir de là, on peut lire à un autre niveau ces références multiples égrenées au fil des pages, car il est évident que, puisque nous sommes dans une fiction écrite par un romancier et non dans la vie réelle, chacune de ces références a été ménagée à dessein au moment même de l’élaboration de l’intrigue : il était prévu par l’auteur dès le départ que son personnage passe devant tel rocher et pense à tel monument biblique, ou que tel personnage lui fasse penser à un héros de l’Odyssée. De même, toute la structure du roman, toutes les péripéties du voyage, ont bien sûr été pensés dès le début par l’auteur pour être présentées comme les étapes d’une quête initiatique. Si ce symbolisme général sous-tendant tout le roman était une tendance propre au narrateur, il serait possible pour l’auteur d’en mettre en scène l’échec, au moins momentané, à un moment ou à un autre. Mais (sans dévoiler l’intrigue) à aucun moment cette logique n’est remise en question. Quoi qu’il arrive, le personnage continue à projeter sur les événements de sa vie tout un paysage de grandes références culturelles sous le signe desquelles il s’imagine placé, voire sur les traces desquelles il s’imagine marcher.
Où est le problème avec un tel choix esthétique ? Après tout, il n’est ni nouveau ni méprisable : par moments, on pourrait penser aux romans de Julien Gracq, dont les narrateurs aiment eux aussi à faire surgir, par-dessus les paysages et les personnes, toute une troupe de fantômes célèbres, épopées, contes, livres, films. Tels le soldat du Balcon en forêt qui rencontre dans la forêt une femme vêtue de rouge et croit être tombé sur le Chaperon du conte, ou bien le personnage principal du Roi Cophetua hanté par un tableau du même nom…
Le problème, ici, est que le narrateur est supposé voyager et quitter son univers familier pour découvrir une vie radicalement autre. Et voilà que, tout au long du roman, il ne cesse jamais de ramener les indigènes à tel peuple fabuleux de l’Odyssée, les paysages de jungle à tel passage de la Genèse, etc. etc. etc. Et toutes ces œuvres relèvent des cultures européennes. Autrement dit, le narrateur – et avec lui l’auteur – ne quitte jamais une seconde ses références habituelles européennes, alors même que le roman est supposé montrer le contraire. Certes, on entend aussi parler des cultures indigènes, de la musique, des mythes, mais très peu et toujours pour déboucher sur une comparaison avec la Bible ou une autre référence de ce genre. Si l’on considère tout cela comme l’expression de la vision du monde qu’a le narrateur, j’ai tendance à croire qu’il voyage beaucoup moins en esprit que physiquement, et qu’il est loin de s’ouvrir autant à ce qu’il découvre qu’il ne le prétend, ce qui peut être une façon de justifier le titre original du livre, Los Pasos Perdidos (Les Pas perdus), en plus du sens que la simple lecture du livre en entier peut faire venir en tête. Si l’on considère que ces choix reflètent un parti pris esthétique d’Alejo Carpentier, je reste assez sceptique devant le résultat, qui aboutit à ne jamais penser l’altérité des peuples de la jungle sud-américaine autrement qu’à travers une grille de références lourdement européano- ou occidentalo-centrée.
Certes, on ne peut pas s’affranchir complètement de sa culture ou de ses références d’origine au moment de découvrir d’autres cultures, mais, mis en œuvre à une telle échelle et avec une telle densité, ce réseau de références aboutit à écraser toute altérité sous une vision du monde préexistante, surimposée à toute nouveauté, et qui n’est jamais réellement remise en cause ou affectée par ce qu’elle découvre au cours du voyage. J’aurais bien aimé qu’à un moment donné le narrateur s’aperçoive qu’il ne peut justement pas comprendre réellement les gens qu’il rencontre s’il se contente de les imaginer comme les Lotophages de l’Odyssée ou comme les hommes de telle génération des premières pages de la Bible !
Je suis donc ressorti de ce roman avec un avis en demi-teinte, et avec le sentiment qu’il accusait quelque peu son âge sur le fond malgré ses qualités d’écriture indéniables. Carpentier le publie en 1953, au moment où Claude Lévi-Strauss commence à peine à publier les ouvrages qui le rendront célèbre : son opuscule Race et histoire est paru en 1952, Tristes tropiques ne sera publié qu’en 1955. Malgré une bonne volonté louable, ce roman de Carpentier semble peiner à se détacher d’un état d’esprit très ancré dans la première moitié du siècle, et qui rappelle davantage les écrits anthropologiques d’un Roger Caillois, adversaire intellectuel de Lévi-Strauss et sournois défenseur de la supériorité occidentale, que des publications novatrices qui révolutionnent à la fois l’anthropologie et les relations interculturelles après 1950. Ou plutôt, d’une certaine façon, c’est un peu comme si Lévi-Strauss et Caillois avaient essayé d’écrire un roman ensemble, d’où un résultat quelque peu schizophrène.
En étant perfide, on pourrait aussi remarquer qu’une telle densité de références sent un peu son huile de lampe ou son hypokhâgne, voire la rapprocher de ce qu’écrit Barthes dans ses Mythologies sur le besoin de l’homme bourgeois d’universaliser et de détemporaliser ses valeurs culturelles afin de les faire passer pour naturelles et de s’imaginer en acteur des grandes bouleversements cosmiques prévus de toute éternité. Le pire, c’est qu’on aurait parfois presque l’impression que l’auteur n’a pas voyagé lui-même, alors que Carpentier s’inspire à plusieurs reprises de ses propres voyages, comme il le précise dans une note à la fin du roman. J’ai tendance à regretter qu’il n’ait pas opté pour un récit de voyage plutôt que pour une réécriture si travaillée qui tient tant à supprimer tout lieu ou date précis au profit d’une volonté d’universalisme qui ne me paraît pas atteindre vraiment son but. L’esthétique du roman me semble rester trop prisonnière de la récitation de références culturelles qui plaquent les mythes du « vieux continent » sur la réalité de l’autre de manière envahissante et étouffante. C’est comme si Carpentier avait été trop imprégné de culture européenne pour pouvoir laisser vraiment place à ce qu’il avait sous les yeux en Amérique du Sud…
Ce que j’ai présenté ne constitue bien sûr qu’une lecture personnelle du roman, qui est loin d’en épuiser toute la complexité. Et en dépit de mes réserves, Le Partage des eaux reste à mon avis une lecture prenante, recommandable rien que pour son style. De plus, malgré l’ambivalence que j’ai montrée dans son projet esthétique, il constitue tout de même un plaidoyer en faveur des cultures autres qu’européennes ou occidentales et une invitation au voyage. Les derniers chapitres, en particulier, qui montrent le chemin intellectuel parcouru par le narrateur, referment l’ensemble sur certaines des meilleures pages du livre.
D’autres choses du même genre ?
Vous pouvez d’abord lire les autres écrits d’Alejo Carpentier, que ce soit Le Royaume de ce monde ou son recueil de nouvelles Guerre du temps, par exemple.
En matière d’histoires de voyages qui seraient plus réussies dans leur description de la confrontation avec l’altérité, je n’ai pour le moment en tête que des récits de voyage comme L’Usage du monde de Nicolas Bouvier, ou bien des autobiographies comme la BD Persepolis de Marjane Satrapi. Même des nouvelles de science-fiction comme celles de Ray Bradbury dans Chroniques martiennes peuvent parfois faire réfléchir aussi bien à ce genre de sujet.
En matière de films, cette ambivalence esthétique me rappelle un peu la semi-déception qu’a été à mes yeux La Forêt d’émeraude de John Boorman (1985), visuellement magnifique, mais où les indigènes correspondent beaucoup trop bien à tout ce qu’un Européen pourrait en attendre sans avoir jamais voyagé pour ne pas apparaître comme des créations faites d’encre, de papier et de clichés pseudo-anthropologiques. En science-fiction, je ne m’attarderai pas sur Avatar de James Cameron (2010), qui mérite la même critique à la puissance mille, et brasse par ailleurs sans le moindre effort des clichés de science-fiction que le genre a su dépasser depuis longtemps.




 Publié par Liber
Publié par Liber