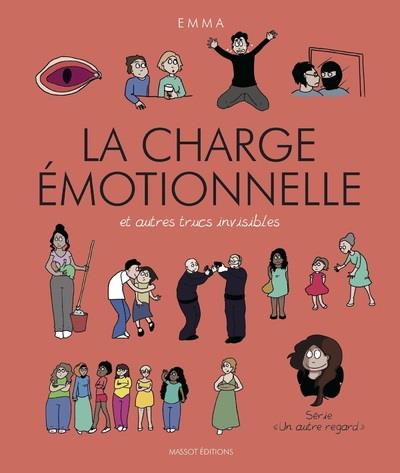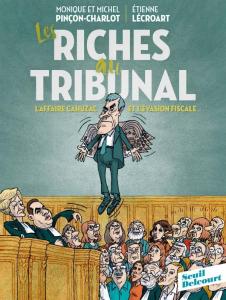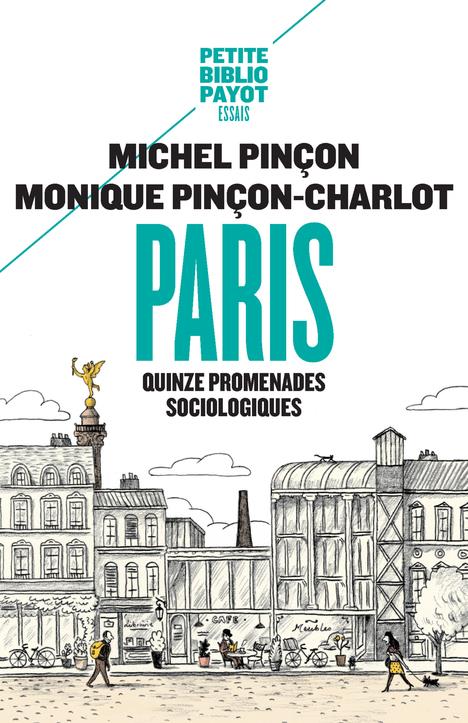Référence : Victoire Tuaillon, Les Couilles sur la table, Paris, Binge audio éditions, 2019.
Quatrième de couverture de l’éditeur
« Qu’est-ce que ça veut dire d’être un homme, en France, au XXIe siècle ? Qu’est-ce que ça implique ? Pour dépasser les querelles d’opinion et ne pas laisser la réponse aux masculinistes qui prétendent que « le masculin est en crise », Victoire Tuaillon s’est emparée frontalement de la question, en s’appuyant sur les travaux les plus récents de chercheuses et de chercheurs en sciences sociales. Ensemble, au fil des épisodes de son podcast au titre percutant, elles et ils ont interrogé la masculinité et ses effets : pourquoi, dans une immense majorité des cas, les harceleurs, les violeurs, les casseurs, sont-ils des hommes ? Pourquoi les petits garçons disent-ils tous que « l’amour c’est nul » ou encore que « l’amour c’est pour les filles » ? Comment la domination masculine affecte-t-elle aussi les hommes ?
Réunissant les réponses à ces questions et à bien d’autres, ce livre démontre sans dogmatisme que la masculinité n’a rien de naturel, que c’est une construction sociale et qu’il faut la remettre en question si on veut atteindre une véritable égalité entre les femmes et les hommes. »
Mon avis
Le contexte
Ma première réaction en lisant le titre de ce livre a été la répulsion. « Les Couilles sur la table » est une expression que je n’ai jamais aimée : elle est vulgaire, et elle symbolise à mes yeux une forme de masculinité que je n’ai jamais eu envie de faire mienne – une domination brutale et désinvolte. Bien évidemment, c’est tout le sujet du livre : les différentes formes de masculinité. J’ai donc fini par le feuilleter, puis l’acheter pour le lire, et je m’en suis félicité à chaque page. Donc, si jamais le titre vous rebute, je vous invite à aller plus loin, la lecture en vaut la peine. On va voir pourquoi.
Un peu de remise en contexte s’impose. Les Couilles sur la table est au départ un podcast créé par la journaliste Victoire Tuaillon et diffusé sur la plate-forme française Binge Audio depuis septembre 2017 pour évoquer non pas la mais les masculinités, en interviewant des spécialistes. Il en est actuellement à son soixante-douzième épisode, au rythme actuel d’un épisode de 45 minutes toutes les deux semaines. En dépit de son succès grandissant, je suis passé complètement à côté pendant deux bonnes années, parce que j’écoutais très peu de podcasts, tout comme j’écoutais très rarement la radio, préférant la presse écrite. Il faut dire aussi que ce n’est pas toujours évident de dégager 45 minutes pour écouter une émission certes très claire, mais qui demande tout de même un minimum d’attention (j’ai fini par trouver le moment idéal : pendant mon repassage). Bref, il m’aurait fallu une version écrite, et c’est justement ce qui est arrivé avec la parution, fin 2019, d’un livre synthétisant les grands thèmes du podcast. C’est ainsi que ce livre est arrivé jusqu’à moi, sur la table d’une librairie, avec son quatrième de couverture aussi passionnant que son titre avait l’air vulgaire.
Notons enfin que le livre a été réédité cette année en poche aux éditions Pocket.
La forme
Avant de passer à la question du fond, parlons un peu de la forme. Elle est pratique et agréable. Un moyen format pas trop grand, pas trop lourd, trimballable, avec une couverture assez solide pour ne pas pelliculer au moindre contact avec une paume moite. Et, à l’intérieur, une mise en page bien équilibrée, juste assez aérée et juste assez dense, avec un usage intelligent de la couleur pour égayer la présentation et éviter toute impression d’austérité. Bref, c’est dense comme un ouvrage de vulgarisation scientifique un peu ambitieux, mais la mise en page fait tout pour être accessible à un large public. Une ambition que je ne peux que saluer, tant le sujet est important.
Mais ai-je parlé de forme, de mise en page, d’orthographe, de typographie ? Angoisse, horreur ! Voici que débarque la troupe sourcilleuse et implacable de l’Inquisition Typographique d’Internet (ITI), avec sa lampe-torche, sa grosse caisse et son porte-voix ! Voici déjà la lampe-torche braquée sur mon visage tandis qu’on me met à la question ! Attendez ! Laissez-moi vous parler de la qualité de la relecture, vous garantir qu’elle est soignée, que les accords verbaux, nominaux et adjectivaux sont correctement faits ! Qu’on ne trouve ni solécismes, ni redondances, ni truismes, et assez peu d’hiatus ! Que le style est léger et précis sans verser dans le cabotinage, que les développements sont concis et bien structurés, que les arguments sont sourcés à l’aide de notes et d’une bibliographie qui figure en bonne place en fin du livre ! Mais non, on me secoue comme un sac de patates et on me crie : « Rien de tout cela ne nous intéresse ! Rien de tout cela n’est important ! Qu’on massacre les conjugaisons, qu’on oublie l’accord du participe passé, qu’on accumule approximations et généralisations, peu nous importe ! Nous ne voulons savoir qu’une chose, une seule, tu sais laquelle ! Avoue ! Victoire Tuaillon utilise-t-elle l’écriture inclusive ? — Pitié, seigneurs ! Oui, elle l’utilise un peu ! — Hérétique ! Profanatrice ! Corruption ! Décadence ! Qu’as-tu vu entre ses pages, malheureux ? Des pronoms neutres ? — O-oui ! — Des points médians ? Utilise-t-elle des points médians ? — Pitié, pitié ! Oui, elle en utilise… quelques-uns. — Enfer ! Massacre ! Feu et foudre sur vous ! — Pitié, messires, ce ne sont que dix ou vingt néologismes en deux-cent-cinquante-cinq pages… J’implore votre indulgence. Après tout, une langue est aussi vivante que les gens qui la parlent. S’il est vrai qu’il faut employer les mots de tout le monde pour se faire comprendre des autres, tout locuteur, toute locutrice native d’une langue peut revendiquer son droit à une part de création lexicale. D’ailleurs, bien des écrivains ont eu recours au néologisme, par exemple… — Silence, avorton ! Tu veux dire que les points médians ne t’ont pas empêché de lire ? Que tu ne t’es pas crevé les yeux, pareil à Œdipe comprenant qu’il avait mis son E dans l’O de sa propre mère ? Que tu n’as pas aussitôt détourné le regard et refermé cet objet du démon ? Que tu as aimé cela ? Que tu t’es vautré dans le stupre plein et délié de cette partie de jambages en l’air ? — Pitié, messires ! Je l’avais payé 18 euros, et puis… quand on se concentre sur le fond, c’est bien intéressant… — Hérésie ! Compromission abjecte ! Péché en capitales ! Fornication True Type ! Crime inexpiable qui invalide, annule et efface tout texte qui s’y adonne ! Rien de ce qui est écrit de cette manière ne peut avoir de pertinence ! C’est une atteinte intolérable à notre très sainte et très parfaite langue française ! Il ne faut rien changer à notre très sainte et très parfaite langue française ! Lisez les tables de la loi sur le site de l’Académie ! Haro ! Haro ! La fin est proche ! Repentez-vous ! DONG, DONG ! » Et la grosse caisse nous étrille les tympans, et les beuglements du porte-voix nous étourdissent, et la meute hurlante de la chasse sauvage nous mord les jarrets avant de s’éloigner, la bave aux lèvres, vers l’abîme sans fond des réseaux sociaux.
Alain Rey soit loué, ils sont partis. Ils ne brillent pas par leurs qualités d’écoute ou leur sens de la nuance. Quel dommage ! D’un autre côté, des gens prêts à éclipser 255 pages de travail pour tout réduire à ce type de question sont-ils de bonne foi ? Si ça n’avait pas été ce prétexte-là, ils en auraient trouvé un autre pour ne pas lire. Heureusement, je ne leur ai pas dit que la couverture était rose.
Le fond
Venons-en au fond du propos. Les Couilles sur la table est donc un livre féministe qui parle non pas des femmes, mais des hommes (mais du coup aussi des femmes) ; et non pas des hommes en général, mais des notions de masculinité et de virilité. Autrement dit : de ce que c’est que d’être éduqué en tant qu’homme, que d’avoir des relations sociales, que d’adopter tel ou tel comportement, telle ou telle façon d’être, que la société attend des hommes ou que les hommes ont tendance à adopter entre eux et avec les autres, pour des raisons variées. Et des conséquences de tout cela sur les femmes.
Pour les gens que le mot « féminisme » mettrait mal à l’aise, ou qui auraient des fantasmes de guerre des sexes ou de castration chaque fois qu’il est question d’égalité entre hommes et femmes, le premier paragraphe de l’introduction (p.9) clarifie les choses d’une manière que je trouve magistrale :
Ceci n’est pas un manuel pour apprendre à être un homme, un vrai. Ce n’est pas non plus un pamphlet contre une entité abstraite qui s’appellerait « les hommes », et qu’on mettrait tous dans le même sac. Et ce n’est pas un point de vue personnel sur la masculinité que j’aurais tiré d’observations plus ou moins inspirées de mon entourage proche. Ce livre est une tentative de synthèse des centaines de travaux — articles, thèses, essais, documentaires — concernant la masculinité, les hommes et la virilité, que j’ai eu la chance de lire dans le cadre de mon travail.
Tandis que le podcast consiste intégralement en entretiens avec des spécialistes en tout genre et de tout genre, le livre consiste en grande partie en un travail personnel de synthèse de la part de la journaliste. Cette synthèse demeure cependant proche de ses sources : Tuaillon mentionne à longueur de pages les livres, documentaires, etc. d’où elle tire ses informations, ses statistiques, ses analyses. Elle les indique dans le corps du texte, recourt à quelques notes de bas de page (en nombre très raisonnable) et ajoute une petite bibliographie à la fin (j’aurais aimé plus de références plus complètes, avec mention de l’éditeur et de l’année, mais mettons que c’est une concession à l’orientation « grand public » du livre, et cela fait déjà beaucoup à lire et à voir). Les chapitres alternent avec un choix d’extraits d’entretiens directement issus des épisodes du podcast, et qui se distinguent du reste du texte par leurs pages à fond coloré. J’ai beaucoup apprécié ce parti pris, qui permet d’alterner entre des développements généraux et des analyses précises, et de donner voix à toute une variété d’approches, en découvrant les travaux de tel ou telle spécialiste. On peut ainsi y lire les philosophes Olivia Gazalé et Manon Garcia, les sociologues Benoît Coquard et Raphaël Liogier, la militante féministe Valérie Rey-Roberts et le militant trans queer Paul B. Preciado. Les pages d’ouverture des chapitres sont illustrés et ponctués, au verso, de brèves citations de chercheurs et de chercheuses (Pierre Bourdieu, Simone de Beauvoir) mais aussi d’artistes (Anne Sylvestre, Virginie Despentes, Jennifer Lopez) qui sont autant de pistes de lectures et d’écoutes supplémentaires.
Après l’introduction, Les Couilles sur la table se divise en cinq grandes parties : « Construction », « Privilège », « Exploitation », « Violence » et « Esquives ». Une dernière partie, « Prolongation », regroupe les annexes. Voyons rapidement ces différentes parties.
« Construction » évoque le rôle de l’éducation et l’illusion d’une masculinité « naturelle ». Le constat est simple, et fait écho à la phras de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». La même chose est vraie des hommes : les comportements masculins ne sont pas spontanés, ils sont modelés par la société à travers l’éducation des garçons et les modèles de masculinité. Après cela, Victoire Tuaillon, prenant la suite d’un nombre croissant de sociologues, bat en brèche la notion de « crise de la masculinité » promue par des philosophes comme Élisabeth Badinter et les militants qui se disent « masculinistes ». Sur cette supposée crise de la masculinité, j’avais acheté avec passion le livre XY, de l’identité masculine d’Élisabeth Badinter, pour finir par le laisser tomber, très déçu par l’accumulation de généralités vaseuses et étonnamment mal argumentées qui forme les premiers chapitres – je suis bien mieux convaincu par les arguments cités par Tuaillon qui montrent que cette prétendue crise est en réalité une rhétorique récurrente des hommes (ou plutôt de certains hommes) pour réaffirmer une forme de masculinité dominatrice. Enfin, Tuaillon pose les notions de virilité et de masculinité, mot dont elle montre qu’il faut l’employer au pluriel : il n’y a pas une seule façon de se comporter, de s’habiller, de parler, d’agir comme un homme, mais bien plusieurs, selon les époques, les milieux sociaux, les métiers, le type d’éducation reçue, l’orientation sexuelle, etc.
« Privilège » explique pourquoi, quand on est un homme, on est favorisé dans les sociétés actuelles par rapport aux femmes. Par exemple, l’homme est considéré comme l’être humain standard, tandis que la femme est considérée comme un cas particulier. J’avais entendu parler de ça, mais c’est ahurissant de voir à quel point c’est encore vrai… jusque dans la détermination des protocoles de test des ceintures de sécurité pour les automobiles, où les mannequins standards ont des poitrines d’hommes ! (Et, oui, ça peut faire une différence d’avoir une poitrine de femme pour ce genre d’accessoire de survie.) D’autres exemples, en matière de recherche médicale notamment, sont tout aussi déconcertants et inquiétants. Autre domaine, que je connaissais un peu mieux : la façon dont l’urbanisme favorise les hommes, depuis les noms des rues jusqu’aux choix d’aménagement des espaces sportifs, sans oublier le problème du harcèlement de rue. Suit une section sur le domaine du travail : inégalités de salaires, phénomène des boys’ clubs (avec l’évocation d’affaires récentes comme la « ligue du LOL » en 2018, mais aussi les bizutages et le harcèlement sexiste dans les grandes écoles).
« Exploitation » montre de quelles manières les hommes exploitent (consciemment ou non) les femmes. J’ai retrouvé là des classiques des études sur le genre, qui figurent en bonne place dans des manuels universitaires comme la classique Introduction aux études sur le genre de Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard (De Boeck, 2008, régulièrement réédité et mis à jour) : la question du travail domestique, de la répartition de ce travail au sein du couple (toujours très inégalitaire en dépit de quelques progrès), son invisibilisation voire la négation de sa valeur. La notion de charge mentale, que je connaissais, mais aussi celle de travail émotionnel, que je ne connaissais pas : la manière dont une grande partie de la prise en charge des émotions dans les relations humaines se retrouve dévolue aux femmes, notamment tout ce qui améliore le quotidien, la gentillesse, l’attention prêtée à l’autre, ce que les anglophones appellent le care (soin). Enfin, la question de la contraception, qui m’a fait tomber des nues quand j’ai appris que l’écrasante majorité des couples fait encore reposer la contraception sur les femmes, via la pilule en général, plutôt que sur la pourtant toute simple utilisation du préservatif. Et cela alors même que la technologie nécessaire pour élaborer une pilule masculine est au point et qu’il existe d’autres formes de contraception masculine, complètement invisibilisées.
« Violence » est la partie difficile où l’on aborde les violences conjugales, les violences sexuelles, la « culture du viol » (expression oxymorique à mes yeux, mais qui a le mérite de mettre en lumière des phénomènes déplorables), le viol et ses liens avec la masculinité. C’est une fois encore l’occasion d’enfoncer des mythes : le violeur n’est que très rarement cet inconnu armé d’un couteau qui s’en prend aux femmes dans les rues obscures le soir, mais bien plus souvent un proche, mari, ami, parent, frère, connaissance amicale, que la victime connaît déjà. De même, contrairement à ce qu’on voit tout le temps dans les films ou les séries, la victime ne va pas toujours se débattre bruyamment quand elle se fait agresser et violer : la faute à un phénomène de sidération, d’incrédulité et d’irréalité qui se produit dans ce type de circonstances – et ce n’est pas parce qu’elle ne se débat pas qu’elle serait d’accord, ou qu’elle l’aurait mérité, ou que ce serait sa faute parce qu’elle n’en ferait pas assez. Autant de développements salutaires sur un sujet encore incroyablement mal dépeint dans les fictions et dans l’imaginaire collectif. Pire : les statistiques montrent à quel point le viol reste largement impuni. La manière dont la violence sexuelle est érotisée, dans une confusion délétère, alors que rien n’empêche de mettre en avant d’autres types de récits dans les histoires d’amour et dans la pornographie. La notion de consentement, avec les réponses à des questions aussi simples que primordiales, comme : comment faire pour s’assurer que sa partenaire est consentante ? Faut-il demander à chaque geste qu’on fait (révélation : non, quand même pas) ? Comment faire, alors (révélation : demander souvent, quand même, se souvenir qu’un « oui » pour faire l’amour ne signifie pas « oui à tout ce que vous avez envie de faire au lit cette fois-ci » et vérifier que l’autre se sent bien). Très intéressante, aussi, est la section « Paroles de violeurs ? » qui s’intéresse à l’identité des vrais violeurs, aux raisons de leurs gestes et à la manière dont ils peuvent comprendre ce qu’ils ont fait – ou tenter d’esquiver la réalité.
La partie « Esquives » termine l’ouvrage sur un propos résolument constructif, en fournissant des conseils et des pistes afin de savoir que faire pour améliorer les choses. Victoire Tuaillon se concentre sur les domaines de la sexualité, de l’éducation et de l’engagement proféministe des hommes. Repenser la sexualité pour se libérer de constructions collectives délétères au profit de pratiques respectueuses qui sont elles aussi propices au plaisir. Améliorer l’éducation des garçons, occasion d’aborder la question du marketing genré et de ses effets pervers (les fameuses pages bleues et roses des catalogues de jouets à Noël, mais le problème se pose même quand le fond de la page n’est pas coloré). Et enfin, des pistes pour être un allié des causes féministes : ne pas rester dans l’ignorance des violences faites aux femmes et des inégalités, s’informer, en parler, mais aussi, tout simplement, écouter les femmes sans être dans le déni ou la minimisation systématiques.
La dernière partie, « Prolongation », regroupe les annexes, parmi lesquelles figurent des remerciements, la biblio-filmographie, un très utile index des épisodes du podcast bien pratique pour découvrir les épisodes qui pourraient vous intéresser, et une évocation des coulisses du podcast et de l’écriture du livre, terminée par la liste des premiers soutiens du financement participatif du livre sur Ulule en 2019.
Conclusion
Voilà donc un livre court, clair et concis, mais qui parvient à aborder de nombreux domaines de manière accessible, informative et aussi bien documentée que possible pour un travail de ce format. Que vous ayez ou non l’intention ou le temps d’écouter le podcast correspondant ensuite, je ne saurais trop en recommander la découverte. Il m’a appris beaucoup de choses, y compris dans des domaines sur lesquels je me pensais raisonnablement bien informé. Ce n’est pas un ouvrage de recherche, mais c’est de la vulgarisation solide, comme on en a grand besoin sur ce type de sujet. Le but est atteint à mes yeux, et c’est le genre de petit livre qui me donne envie de l’offrir à tout le monde.
Si vous cherchez d’autres lectures sur des sujets proches, j’avais chroniqué récemment Je suis une fille sans histoire, un seule-en-scène d’Alice Zeniter. En bande dessinée, je peux vous recommander la biographie dessinée d’Olympe de Gouges par Catel et Bocquet, la drôle et hilarante BD autobiographique de Florence Cestac Un papa, une maman, une famille formidable ! et pourquoi pas Une histoire du sexe par Coryn et Brenot, sans oublier La Charge émotionnelle et autres trucs invisibles par Emma. Si vous préférez la fantasy, lisez donc Lavinia d’Ursula Le Guin, et si vous préférez la science-fiction, plongez-vous dans les Chroniques du pays des mères d’Élisabeth Vonarburg. Enfin, si vous vous demandez pourquoi je m’intéresse au féminisme et aux études sur le genre, voyez donc le billet où je me suis rendu compte que je parlais beaucoup plus d’œuvres d’hommes que de femmes sur ce blog.




 Publié par Liber
Publié par Liber