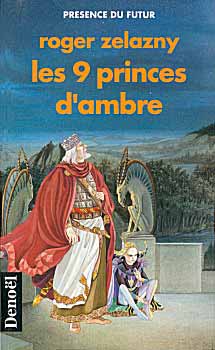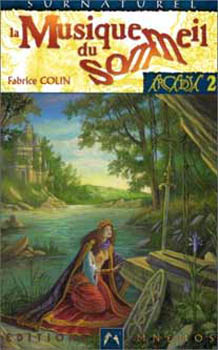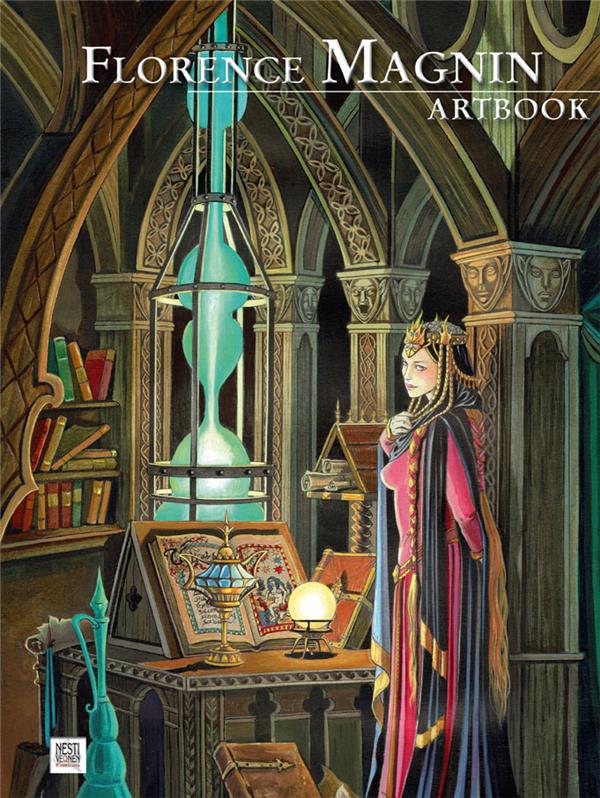Référence : Nancy Peña (dessin), Blandine Le Callet (scénario), Céline Badaroux-Denizon et Sophie Dumas (mise en couleurs), Médée, Bruxelles, Casterman, 2013-2019, 4 tomes.
Présentation de l’éditeur
« Un mythe réinventé : la vérité sur une femme libre, savante et meurtrière
Médée est surtout connue pour être la magicienne qui aida Jason à conquérir la toison d’or, et la femme qui, des années plus tard, tua ses enfants pour se venger d’avoir été abandonnée. Entre les deux, une série d’aventures, de voyages et d’exils jalonnés de meurtres abominables.
Qui Médée était-elle vraiment ? Une mère aimante et une amoureuse assumant ses désirs, que sa passion finit par égarer ? Une femme libre refusant la tyrannie des hommes ? Une barbare venue semer la confusion dans le monde civilisé des Grecs ? Une sorcière redoutable, maîtresse de forces occultes ? Un monstre, tout simplement ?
Pour percer ce mystère, c’est Médée en personne que la romancière Blandine Le Callet et l’illustratrice Nancy Peña ont choisi de nous faire entendre : par-delà calomnies, exagérations, et déformations infligées par le temps, Médée nous raconte sa véritable histoire, depuis les jardins luxuriants de son enfance en Colchide jusqu’à l’île mystérieuse d’où elle livre son ultime confession. »
Le contexte
Médée, un sujet idéal
Médée est l’une des héroïnes les plus célèbres et l’une des plus ambivalentes de la mythologie grecque. Dotée de grands pouvoirs magiques, tour à tour secourable et bienveillante ou implacable et cruelle, la magicienne originaire du royaume de Colchide est présente dans plusieurs mythes distincts, qui nous sont parvenus par des œuvres appartenant à des genres littéraires très différents les uns des autres. Elle apparaît d’abord dans plusieurs épopées appelées les Argonautiques, c’est-à-dire les voyages des marins du navire Argo, les Argonautes, menés par Jason d’Iolcos jusqu’en Colchide où ils cherchent à s’emparer de la toison d’or. Personnage secondaire de l’épopée, Médée joue pourtant un rôle décisif en apportant son aide à Jason dont elle est tombée amoureuse, sans hésiter à s’opposer pour cela à son propre père, Aiétès, roi de Colchide, descendant du dieu Hélios. C’est grâce à elle que Jason parvient à ses fins et, en échange, il la prend pour épouse et la ramène en Grèce. Plusieurs poètes grecs et romains ont composé des Argonautiques. La plus connue est sans doute celle d’Apollonios de Rhodes, poète de l’époque hellénistique qui s’est trouvé à la tête de la légendaire bibliothèque d’Alexandrie, en Égypte (excusez du peu).
Nous retrouvons Médée dans une œuvre plus ancienne mais qui conte l’une des aventures qu’elle a vécues après les événements de la quête de la toison d’or : une tragédie composée par le poète Euripide, dont elle est cette fois le personnage principal. Comme la plupart des tragédies, la pièce de théâtre d’Euripide évoque les malheurs des puissants. Devenue reine aux côtés de Jason, Médée se voit répudiée par son ingrat de mari au profit d’une nouvelle épouse, plus jeune, grecque, riche et puissante. La vengeance de la magicienne éveille la terreur chez les spectateurs. Par la suite, plusieurs autres auteurs grecs et romains reprennent ce sujet, l’un des plus connus du côté romain n’étant autre que Sénèque, dont la Médée, particulièrement sombre, a bénéficié récemment de plusieurs traductions nouvelles.
On connaît de nombreuses autres aventures de Médée en dehors des quelques grands textes dont je viens de parler (Le Callet a notamment puisé chez Ovide), mais ces quelques grands traits du mythe suffisent pour ce que je voulais montrer, à savoir que Médée constitue un personnage idéal pour servir de sujet à une fiction mythologique, et les autrices de cette bande dessinée l’ont bien compris.
Deux aspects des réécritures récentes des mythes : historicisme et féminisme
Ajoutez à cela la vogue actuelle des réécritures de mythes, tous supports confondus : littérature pour adultes ou pour la jeunesse, bande dessinée, cinéma, séries télévisées ou diffusées sur Internet, et même des jeux vidéo… sans parler des nombreux sites Web ou chaînes Youtube offrant des résumés ou des « cours » plus ou moins fiables sur les mythes. N’en déplaise aux administratifs qui multiplient les coupes budgétaires et les restrictions de moyens dans l’enseignement des langues anciennes, l’humanité, sous nos latitudes et sous les autres, s’intéresse plus que jamais aux littératures de l’Antiquité.
À la différence des œuvres à sujet historique, scientifique ou philosophique, les récits mythologiques tirés des épopées et des tragédies font l’objet d’une tradition de réécritures et de réinterprétations restée ininterrompue depuis l’Antiquité. Chaque époque, chaque région du monde, chaque culture, chaque langue aime s’approprier les mythes et les légendes, s’exprimer par leur intermédiaire, faire vivre les histoires anciennes en les métamorphosant plus ou moins au passage. Depuis la fin du XXe siècle, la tendance est aux réécritures dites « historicisantes » des mythes. Une réécriture historicisante repose pourtant sur un paradoxe profond : raconter un mythe en minimisant ses éléments les plus merveilleux (monstres, magie) et en l’ancrant dans une période historique précise, afin d’obtenir un récit vraisemblable qui pourrait s’être réellement produit. Pourquoi un tel déploiement d’efforts alors qu’un mythe n’a que rarement plus de fondement historique qu’un conte, alors que, par exemple, la guerre de Troie, si elle a eu lieu, n’a guère été qu’une escarmouche devant une ville bien moins puissante et prospère que la Troie de l’Iliade, et qu’Ulysse ou Achille n’ont certainement jamais existé, pas plus que Médée ou Jason ou la toison d’or ? Mystère. Le fait est que c’est une tendance de fond dans les réécritures récentes des mythes (aussi bien grecs qu’issus d’autres cultures, puisque l’écrivain américain de science-fiction Robert Silverberg s’est adonné à cet exercice avec l’épopée mésopotamienne de Gilgamesh dans son roman Gilgamesh, roi d’Ourouk).
Un exemple célèbre, mais à mes yeux complètement raté, de ce type de réécriture, est le film Troie de Wolfgang Petersen, qui racontait la guerre de Troie en supprimant toutes les apparitions des dieux et tous les éléments surnaturels (hors de question de laisser les chevaux d’Achille lui prédire sa mort), pour un résultat qui n’est parvenu à me convaincre ni en tant qu’adaptation (trop d’écarts injustifiés avec les épopées homériques), ni en tant qu’œuvre autonome (longuette, plate, filandreuse). On peut faire bien mieux, et l’auteur de BD américain Eric Shanower le démontre superbement avec son comic L’Âge de bronze, qui, sur le même postulat de réécriture historicisante de la guerre de Troie, livre un récit à la fois très fidèle à la tradition et riche en réinventions intelligentes, porté par un dessin soigné et par un scénario bien ficelé (ce récit-fleuve est encore en cours : j’espère que l’auteur parviendra à le boucler).
Avant d’aborder la bande dessinée Médée, il faut évoquer une autre tendance forte dans les réécritures de mythes actuelles : la mise en valeur des figures féminines, parfois (pas toujours) dans un esprit féministe. J’ai eu l’occasion de chroniquer ici plusieurs livres de ce type, dont l’inégale Penelopiad de Margaret Atwood qui réécrit l’Odyssée du point de vue de Pénélope et le très beau Lavinia d’Ursula Le Guin, qui sort du silence et de l’oubli Lavinia, l’épouse d’Enée, à peine mentionnée par Virgile dans son Énéide. Cette approche s’est développée depuis au moins une cinquantaine d’années et on pourrait en mentionner de nombreux exemples, jusqu’au récent roman de Madeline Miller consacré à la vie de Circé.
C’est dans ce contexte que la dessinatrice Nancy Peña et l’écrivaine Blandine Le Callet (Une pièce montée, La Ballade de Lila K., Dix rêves de pierre) ont œuvré ensemble à une bande dessinée qui relate la vie de Médée, en adoptant ce double parti pris historicisant et féministe. Le résultat est une excellente bande dessinée qui fait partie des meilleures réécritures mythologiques récentes dont j’aie connaissance, tous supports confondus.
Une réécriture intelligente aux allures de réinvention
Comme j’ai déjà beaucoup parlé du mythe de Médée en introduisant cette chronique, autant poursuivre sur la question du scénario.
Un univers « historicisé »
Je ne savais pas, avant de lire cette BD, que Blandine Le Callet était agrégée de Lettres classiques et enseignante-chercheuse en latin, autrement dit une spécialiste ; mais cela ne m’a pas du tout surpris de l’apprendre, tant le scénario montre une connaissance fouillée de son sujet. Non seulement Le Callet maîtrise les aspects connus ou moins connus du mythe sur le bout des doigts et s’en sert largement (depuis l’ascendance familiale de la magicienne et sa formation au culte d’Hécate jusqu’à son fils Médos, qu’elle a eu avec Égée, le père de Thésée, lequel forme un obstacle aux ambitions royales de la magicienne, etc.)… mais elle accomplit un formidable travail de détail pour donner corps à l’univers où évolue Médée, à son personnage et aux personnages qu’elle rencontre.
Ce travail, comme je l’ai indiqué, s’inscrit dans une approche historicisante du mythe. Qu’est-ce que cela veut dire ? Eh bien, sa caractéristique la plus frappante concerne les composantes merveilleuses du mythe : elles sont toutes réinterprétées d’une manière rationnelle ou, si vous préférez, réaliste. Prenons l’exemple de la magie de Médée. Dans cette bande dessinée, Médée est une adoratrice d’Hécate et se voit transmettre, dans le cadre de ce culte présenté comme exclusivement féminin, des connaissances très avancées pour son époque en matière de botanique, de médecine et de chimie. L’ignorance des autres fait le reste et la voilà qualifiée de magicienne, victime de multiples rumeurs infamantes. C’est un parti pris fort, qui conduit la scénariste à réimaginer entièrement plusieurs épisodes-clés de la vie de son héroïne. D’autres aspects du mythe, comme les épreuves de Jason (le dragon, par exemple), se voient fortement transformés par cette démarche. Cette logique implique enfin de ne jamais montrer explicitement les divinités, contrairement à ce qu’on trouve dans l’Iliade, l’Odyssée ou même les différentes épopées antiques des Argonautiques. Ce dernier choix est largement répandu parmi les réécritures récentes : les dieux sont invisibles, ou alors leurs apparitions peuvent être comprises comme des rêves, des visions, des hallucinations, etc.
Bien entendu, les gens qui aiment lire des histoires de mythes grecs pour le plaisir de voir des assemblées divines et d’assister à des combats contre des hydres ou des serpents géants iront au devant d’une certaine frustration en entamant cette bande dessinée. Je ne saurais trop leur recommander de ne pas bouder Médée pour autant, car, en dépit de mes réserves sur l’intérêt des réécritures historicisantes des mythes, force m’a été de constater que les choix de réécriture opérés par le scénario aboutissent à une intrigue fouillée et passionnante, qui fonctionne remarquablement bien.
Tandis que les éléments merveilleux se voient fortement transformés et minimisés par des explications rationnelles, le monde où vit Médée, assez vague en dehors des actes des héros et des héroïnes, se voit, en revanche, augmenté d’innombrables détails qui lui confèrent une profondeur largement accrue par rapport à celle du canevas de départ. Les scènes s’enchaînent si naturellement qu’il est facile, pour un non-spécialiste, de passer à côté de l’immense travail de réécriture effectué en coulisses. En voici quelques exemples. Alors même que les épopées homériques et les Argonautiques antiques mélangent allègrement des composants empruntés à plusieurs époques historiques différentes, l’intrigue de la BD, elle, est située à une époque historique réelle. C’est fait de manière très discrète, au détour d’une case du premier tome, où l’on apprend que le royaume d’Aiétès a été fondé par le pharaon Sésostris. Même si l’on ne sait jamais duquel des quatre pharaons portant ce nom il s’agit, et même si l’on ignore combien de temps au juste s’écoule entre l’époque de Sésostris et celle où règne Aiétès, cela revient à planter un repère chronologique assez précis, pendant l’âge de bronze grec, quelque part entre le XXe et le XIXe siècle avant J.-C.
À quoi bon se donner autant de peine pour un détail, me demandera-t-on ? C’est que le cadre de l’histoire devient indispensable pour donner une vraisemblance plus soutenue à l’aventure des Argonautes. En effet, dans la tradition grecque, il est dit généralement que l’Argo aurait été le tout premier navire capable d’effectuer des navigations au long cours, ce qui implique que l’aventure se déroule à une époque reculée, où voir un bateau étranger arriver par la mer constituait un événement extraordinaire en soi. La BD imagine donc de mettre en scène une sorte de course à la technologie entre Aiétès et les Grecs, à qui montera en premier une expédition au long cours (de nos jours, ce serait la course à l’espace). Cette situation chronologique bien réfléchie s’avère tout aussi indispensable dans les tomes 3 et 4, lorsque Médée et Jason se trouvent mêlés aux intrigues de cour de plusieurs villes grecques, en particulier Corinthe, dont le roi entend bien exploiter la situation géographique privilégiée pour en faire un point de passage incontournable du commerce maritime alors en plein essor. Comme souvent dans ce type de réécriture, ce sont la politique et l’économie qui se trouvent mises en avant de cette façon.
Les personnages et l’approche féministe
Mais Le Callet ne fait pas que modifier les différents éléments de l’intrigue ou de son cadre : elle reprend énormément d’éléments de la tradition antique, mais en les remotivant au prisme de son parti pris de réalisme. Avec toujours une passion pour la politique, qui s’explique aisément puisque Médée fait partie d’une famille royale. Le grand avantage de cette BD (observable aussi dans Age of Bronze de Shanower) est sa capacité à s’emparer de figures peu connues du mythe, des personnages secondaires voire obscurs, pour en faire des personnages à part entière, dont l’existence et les actions pèsent d’un poids décisif sur les événements. C’est tout particulièrement le cas pour Argos, le constructeur du navire Argo, et pour ses frères, tous enfants de Phrixos, un Grec arrivé en Colchide seul (sur le dos du bélier à la toison d’or, dans le mythe antique) et de Chalciope, son épouse colque. Dans le premier tome, Argos grandit aux côtés de Médée, dont il est le meilleur ami d’enfance. Mais Phrixos et ses fils subissent des avanies grandissantes de la part du roi Aiétès, qui voit en eux une menace pour son royaume.
Quid de Médée elle-même ? C’est le moment d’aborder un autre versant important de cette BD : son féminisme. L’un des choix qui structurent la BD est l’idée de faire de Médée non seulement le personnage principal, mais aussi la narratrice de sa propre vie. Le quatrième de couverture du premier tome donne le ton : « Médée la scandaleuse, Médée la sorcière, Médée la meurtrière, Médée, le monstre. Voilà ce que l’on dit de moi. Les gens ne veulent retenir que ce qui les arrange. Au milieu de ces voix qui m’accablent, il est temps que je fasse entendre la mienne : il est temps que je raconte mon histoire. Pour rétablir enfin la vérité. » Donner la parole à une femme, qui plus est à une magicienne qui fait peur, c’est-à-dire en somme à une sorcière, afin qu’elle rétablisse la vérité dans un monde façonné par les mensonges des hommes, c’est une démarche typique des œuvres féministes, que nous avons eu l’occasion de rencontrer dans The Penelopiad de Margaret Atwood avec Pénélope, ou dans Lavinia d’Ursula Le Guin avec Lavinia.
Le cas de Médée se distingue nettement de ces deux autres héroïnes dans la mesure où il s’y ajoute une forte dimension morale : l’accusée prend enfin la parole, va-t-elle faire ses aveux, sa confession, son apologie, ou même contre-attaquer et accuser à son tour ? Réponse : un peu de tout cela à la fois, selon les moments de l’histoire. Dans les premières pages, c’est une vieille femme, qui paraît vieille comme le monde, qui s’installe à sa table pour écrire, longtemps après les faits, l’histoire de sa vie, en commençant par son enfance. La Médée que nous découvrons n’est ni entièrement coupable ni entièrement innocente. C’est une petite fille vive et indépendante, dont le premier tome montre les envies de liberté d’une manière un peu convenue dans certaines pages (le coup de la robe qui entrave les mouvements a peut-être été un peu trop vu et revu). C’est une petite fille curieuse et intelligente qui se passionne vite pour les sciences, dans les pages les plus convaincantes du premier tome. Là encore, la réflexion préalable sur l’univers de Médée s’avère de la plus grande importance : la Colchide (un royaume imaginaire pour lequel Le Callet a donc eu plus de liberté en matière d’invention) dispose d’une avance scientifique notable sur les Grecs et enseigne des connaissances poussées aux femmes par le biais du culte d’Hécate, ce qui pose les bases de l’ignorance, de la peur et du rejet que suscite Médée lorsqu’elle arrive en Grèce avec Jason.
Au fil des tomes, nous suivons les étapes de la vie de Médée, dont le choix d’aider et de suivre Jason bouleverse la vie. L’enchaînement de crimes que devient la vie de la magicienne dans la tradition antique se trouve notablement nuancé par la réinvention des circonstances précises de ses meurtres, de ses mensonges et de ses manipulations. Les choix opérés au sujet de Jason sont tout aussi intéressants : contrairement à Achille, à Ulysse ou à Héraclès, Jason a été montré à plusieurs reprises comme un héros assez falot, voire comme un quasi anti-héros dans certains textes dès l’Antiquité (le Jason de la tragédie d’Euripide est tout sauf recommandable). D’autres réécritures mythologiques ont tenu à en faire le héros grec propre sur lui par excellence, en témoigne son traitement dans des films comme Jason et les Argonautes de Don Chaffey en 1963, où la mise en avant de Jason se fait très largement… aux dépens de Médée, qui prend des allures de potiche. Le Jason de Le Callet se situe quelque part entre ces deux extrêmes : un jeune homme intègre qui, par ambition ou par faiblesse, tourne le dos à ses engagements.
Un scénario qui sait se taire
Écrivaine jusqu’à présent, Blandine Le Callet doit la réussite de Médée à sa capacité à s’approprier pleinement le langage de la bande dessinée. J’ai été frappé par le grand nombre de pages presque dépourvues de dialogues, et dont l’impact repose exclusivement sur l’image. Le procédé, employé à bon escient dans tous les tomes, donne lieu aux pages les plus émouvantes, certaines bouleversantes, en particulier dans le tome 4, magistral, qui évoque la répudiation, les préparatifs de plusieurs crimes, l’infanticide de Médée et, plus tard, la naissance de Médos.
Le dessin et l’univers visuel
Il est grand temps de parler de ce qu’on voit en premier dans une BD : le dessin ! Nancy Peña, dont j’ai découvert le travail avec cette BD, a déjà plusieurs séries à son actif (La Guilde de la mer, Les Nouvelles Aventures du chat botté, Le Chat du kimono) ainsi que des illustrations d’ouvrages pour la jeunesse. Son dessin, quoique relevant de la ligne claire, frappe par sa capacité à élaborer des cases riches en détails (rides des visages, plis des vêtements, feuillages, bâtiments, décors en général) tout en conservant une allure de grande simplicité, avec une lisibilité parfaite. L’épure de son trait se prête idéalement à la mise en couleurs, elle-même réalisée avec soin par Céline Badaroux-Denizon, Sophie Dumas et Nancy Peña elle-même, selon les tomes.
Les cases sont en moyenne grandes et aérées, avec trois bandes par page, mais le choix d’un format de 64 pages par tome (108 pour le « monstrueux » quatrième et dernier tome) rend cela possible sans que la densité de l’intrigue ait à en souffrir. L’alternance entre des pages aux cases vastes et peu nombreuses et d’autres aux cases plus resserrées traduit à certains endroits la sensation d’enfermement de Médée opposée à ses envies de liberté (comme ses escapades nocturnes où la page, comme elle, respire). La mise en cases aime à jouer des liens entre les cases à l’échelle de la page, comme ces volutes de fumée qui sinuent et s’enroulent sur toute la hauteur de la page au cours d’une scène nocturne du tome 1, ou le serpent qui suit Médée sur certaines pages du tome 4 et lui susurre de mauvaises pensées (expression graphique de sa frustration ? de son envie de vengeance ? de son ambition ? de sa cruauté ? ce n’est pas dit, à nous de nous faire un avis).
J’ai parlé plus haut du soin apporté à l’univers mythologique-mais-historicisé de cette bande dessinée. Ce soin ne se retrouve pas seulement dans le scénario mais aussi dans les dessins. Puisque la mythologie grecque ne correspond à aucune période historique réelle, des éléments comme l’architecture des palais et des temples, les vêtements, les coiffures ou les bijoux des personnages nécessitent une multitude de choix créatifs. La question devient encore plus complexe dans le cas d’un royaume comme la Colchide, car ce lieu de la mythologie grecque représente un étranger fantasmé, qui ne reflète pas les véritables cultures antiques des rives du Pont-Euxin. Que faire ? Jusqu’où pousser l’historicisation, jusqu’où pousser l’invention ?
Là encore, sans avoir pu pousser la vérification très loin, il me semble que Médée se tire honorablement de ces dilemmes, paradoxalement parce que ses graphismes ne misent pas trop sur l’historique. Les bâtiments et costumes de Colchide évoquent vaguement l’Antiquité grecque, mais sans chercher à correspondre à une période précise, ni minoenne, ni mycénienne, ni vraiment classique. Comme dans l’Antiquité classique, le mobilier reste rare et les vêtements peu recherchés en dehors des teintures et des bijoux. Quelques détails renvoient précisément à l’Antiquité gréco-romaine : dans le tome 1, la bibliothèque de papyrus d’Aiétès a des allures de bibliothèque d’Alexandrie en avance sur son temps, et les personnages utilisent des lampes à huile plates en terre cuite typiques de la Grèce ou de Rome. Dans le tome 4, les villes grecques montrent des bâtiments d’une blancheur résolument non-historique (l’architecture grecque antique était bariolée, on ne le répètera jamais assez, surtout les temples) et ne prétendent pas restituer un état précis des villes de Corinthe ou d’Athènes. On y croise des céramiques peintes d’un style rappelant la céramique attique ou italiote de l’époque classique, dans un mélange d’époques qui correspond finalement assez bien à ce que faisaient déjà les épopées homériques.
De ce fait, les décors (jardin, palais, chambres) gardent une allure de conte dans l’accent mis sur une atmosphère générale et un jeu de couleurs plutôt que sur la précision documentaire. Ainsi les ruelles tortueuses et les toits-terrasses de Corinthe, reliés par des passerelles de bois branlantes, revêtent une allure avant tout symbolique de la position intenable de Médée et de son basculement dans le crime. Un détail comme la face de Méduse peinte au fond de la coupe du roi Égée, dans le tome 4, sert manifestement à évoquer les dangers de l’ivrognerie et de la dépression qui le menacent et pas à reproduire une époque historique précise (au passage, ce détail m’a rappelé certaines scènes du film Alexandre d’Oliver Stone, tout comme les serpents de Médée rappellent un peu ceux d’Olympias). Cela n’empêche pas les lieux d’être décrits avec une grande clarté, ce qui donne lieu à des scènes d’action très lisibles.
En somme, Médée invente son propre univers graphique d’une Antiquité imaginaire, en restant davantage du côté du mythologique que de l’historique. Un choix sage, car prétendre plaquer complètement un mythe grec sur l’histoire ancienne réelle du Moyen-Orient aurait été difficilement tenable (les mythes grecs fantasment l’Orient et ne nous renseignent sur le véritable Orient antique que très indirectement). Dans un récit placé du point de vue de l’étrangère qui arrive en Grèce, la BD se concentre sur les éléments visuels qui nourrissent son propos, en particulier les différences de couleur de peau et d’habits qui aboutissent à l’isolement de Médée au milieu de femmes grecques dont les coutumes et le statut social n’ont rien à voir avec ce qu’elle a connu.
Pour terminer sur le dessin et la couleur, on ne peut pas ne pas mentionner l’inspiration habile puisée dans La Grammaire de l’ornement d’Owen Jones, où Nancy Peña a puisé de nombreuses idées de motifs qui, quoique discrets, étoffent notablement son univers graphique en habillant planchers à damiers, étoffes tissées, frises peintes… La même esthétique à motifs se laisse voir sur les couvertures des tomes successifs (avec des médaillons montrant le navire Argo, le centaure Chiron, Hécate avec ses six bras entourée de serpents, etc.) sur des fonds colorés. Là encore, le résultat allie élégamment richesse du détail et lisibilité de l’ensemble.
Enfin, un détail important à mes yeux : les bulles de texte et le lettrage employé ne tranchent pas sur le dessin et savent rester discrets, avec des bulles de texte dépourvues de contour. Une bonne idée, que nombre de BD feraient bien d’imiter plutôt que de surcharger leurs pages.
Conclusion
Au terme de cette longue critique, j’espère avoir donné une idée de la masse de travail et des multiples bonnes idées qui sont entrées dans l’élaboration de cette bande dessinée. Sa facilité d’accès pour qui ne connaît pas la mythologie grecque et la grande clarté de son récit ne doivent pas faire oublier que cette simplicité est le produit d’un savant travail de documentation, de nombreux choix créatifs, scénaristiques et graphiques, qui non seulement m’ont paru convaincants, mais aboutissent à mon avis à une des meilleurs réécritures mythologiques qu’il m’ait été donné de lire ces dernières années. Dans un paysage de surproduction en matière de bande dessinée, où les albums et les séries à sujets mythologiques ou plus généralement antiques se multiplient, Médée se distingue avec brio et sans effort apparent comme une réussite majeure.
C’est, en plus, une lecture recommandable dès l’adolescence – pas avant, car quelques cases montrant la mort de plusieurs personnages peuvent être effrayantes pour de petits enfants. Je remarque, dans les deux derniers tomes, un traitement de la sexualité particulièrement sain qui évite aussi bien la pudibonderie que la complaisance : on voit deux ou trois fois les personnages faire l’amour, dans des cases pleinement intégrées au récit et qui ne traînent pas en longueur non plus. Les lecteurs et lectrices adolescentes, au collège ou au lycée, pourront se faire une idée de la façon dont les choses se passent, tout simplement, avec des dessins sensuels et sans obscénité. Ce n’est pas rien non plus.
Pour aller plus loin
J’ai retrouvé la trace d’un site Internet consacré à la série. Il semble inactif depuis 2015, mais contient des informations utiles sur les autrices et sur leur démarche.
En matière de BD mythologiques, j’avais eu l’occasion il y a quelques années de chroniquer le premier tome de la série Les Derniers Argonautes, de Legrand et Ryser, qui avait pour ambition d’inventer une suite à la quête des Argonautes, centrée sur Jason et sur ses nouveaux compagnons. Plus péplumesque et orientée vers le merveilleux, cette série commence lorsque « les dieux se taisent » et cessent de répondre aux prières comme aux demandes d’oracles ou de présages ; Jason, tiré de sa retraite, se lance dans la quête d’un objet magique. La série, à présent terminée, compte trois tomes.
En matière de réécritures mythologiques en général, je ne peux que vous recommander le très beau roman d’Ursula Le Guin Lavinia, dont je parlais plus haut. Dans une moindre mesure, The Penelopiad de Margaret Atwood n’est pas mal non plus. Si les textes anciens ne vous font pas peur, vous lirez avec profit la tragédie d’Anne-Marie du Bocage, Les Amazones, qui vous changera de Corneille et de Racine.
Si vous cherchez plus d’informations sur les grands classiques de la mythologie grecque et romaine, je vous conseille d’aller lire mes billets consacrés à l’Iliade, à l’Odyssée et à l’Énéide.
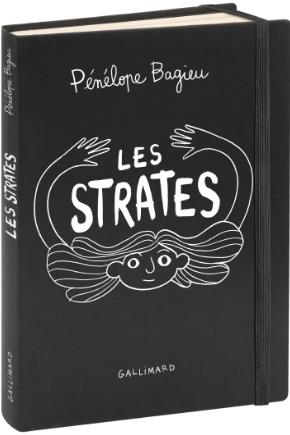



 Publié par Liber
Publié par Liber