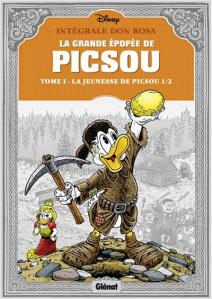Référence : 300, réalisé par Zack Snyder, d’après le comic de Franck Miller, produit par Legendary Pictures, Virtual Studios et Cruel and Unusual Films, États-Unis, 2006, 115 minutes.
Résumé
Né dans la cité de Sparte, en Grèce centrale, au Ve siècle avant J.-C., Léonidas est formé par l’éducation militaire dispensée à tous les jeunes garçons de la ville. Après avoir triomphé des épreuves de l’agôgè, il gravit les échelons jusqu’à devenir roi. Une fois au pouvoir, Léonidas se trouve confronté aux émissaires envoyés par le puissant empire perse, qui s’étend en Asie Mineure, de l’autre côté de la mer, à l’est de la Grèce. Xerxès, le Grand Roi de Perse, réclame l’allégeance des cités grecques, sans quoi il les soumettra par la force. Léonidas refuse et fait massacrer les émissaires : c’est la guerre. Après avoir cherché en vain le soutien du conseil des éphores, le roi reçoit une prophétie d’une oracle peu vêtue. Pour arrêter l’armée des Perses, très supérieure en nombre, la seule solution consiste à choisir habilement le champ de bataille : ce sera le défilé des Thermopyles, une étroite bande de terrain entre la mer et une chaîne de montagnes abruptes.
Léonidas rassemble trois cents guerriers d’élite pour accomplir cette mission-suicide dont ils n’ont aucune chance de revenir vivants. Il est déterminé à faire la fierté de leur ville et à impressionner les autres Grecs. Tandis que le roi et ses guerriers se couvrent de gloire au combat, les dangers se multiplient pour Sparte, tant de la part d’une recrue refusée par Léonidas en raison de son handicap que de la part de Théon, un politicien spartiate sensible à la corruption des Perses et qui a des vues sur la reine Gorgô, la femme de Léonidas.
Mon avis
« Un film basé sur un roman graphique, qui était basé sur un autre film, qui était basé sur la propagande grecque antique, qui était basé sur une histoire vraie ! » (Bande annonce parodique de 300 sur la chaîne Youtube Honest Trailers)
Après Gladiator en 2000 et Troie (dont je parlais l’autre jour) en 2004, 300, sorti en France en 2007, a été le troisième péplum des années 2000 à remporter un grand succès au box-office. Encore une fois, il importe de prêter attention à la nature précise du projet afin de bien comprendre et donc de juger convenablement le film.
Le sujet général de 300 est de type historique : la résistance héroïque de trois cents guerriers spartiates face aux troupes d’invasion du roi perse Xerxès à l’occasion de la bataille du défilé des Thermopyles, pendant la seconde guerre médique, en 480 av. J.-C. Mais, contrairement à Alexandre d’Oliver Stone, 300 n’est pas du tout un film historique. C’est une adaptation d’un comic américain (plus précisément d’un roman graphique, c’est-à-dire grosso modo d’un récit autonome plus long que les bandes dessinées américaines classiques) dessiné et scénarisé par Frank Miller et paru chez Dark Horse en 1998, en cinq épisodes rassemblés en une intégrale l’année suivante.

La bande dessinée…
Première source de confusion : bien qu’elle se fonde sur un sujet historique, la bande dessinée de Miller n’est pas une fiction historique, mais un récit fantastique librement inspiré d’une base historique et inspirée au départ par un film (La Bataille des Thermopyles réalisé par Rudolph Maté en 1962). Le roman graphique de Miller élabore un univers visuel nettement affranchi de la simple reconstitution et qui donne dans le fantastique ou le fantasmatique (un peu comme l’univers exubérant de l’adaptation en BD du roman Salammbô de Flaubert par Philippe Druillet, sauf que Druillet transpose le roman de Flaubert dans un univers de science-fiction). De là des éléments purement imaginaires, comme les piercings dorés du roi Xerxès, la représentation des éphores de Sparte en bossus libidineux, celle des Perses comme des espèces d’assassins enturbannés (les Immortels, soldats d’élite, portant quant à eux des masques et des épées d’allure japonisante), ou encore l’aspect fantastique de certaines créatures présentes dans l’armée perse.
Plus gênant : Miller centre toute l’intrigue sur le roi spartiate Léonidas et sa troupe de trois cents guerriers, en occultant complètement le rôle joué par Athènes et les autres cités grecques pendant cette phase de la guerre. Or c’est une déformation partisane de la réalité historique. Léonidas n’aurait rien pu faire sans les autres cités grecques, qui vont au combat avant Sparte, et avec beaucoup plus de troupes. Les Spartiates ne rejoignent l’alliance grecque qu’assez tard, officiellement en raison d’un rituel religieux à terminer… ce qui ne les empêche pas de réclamer de prendre le commandement de l’armée. Non seulement Miller ne dit rien de tout cela, mais il ne montre les autres Grecs que par les yeux des Spartiates, en se moquant de la pédérastie des Athéniens… alors que, dans la réalité, ce type de pratique existait aussi à Sparte (quoique de façon moins ouverte). Bref, Miller adopte un point de vue partiel et partial afin de faire l’éloge de Sparte et de ses guerriers. Pouvoirs surnaturels à part, les trois cents apparaissent pratiquement comme un personnage collectif de super héros, impression renforcée par leur équipement standardisé dans la BD (ils ont tous une lance, un bouclier, un casque et surtout une cape rouge très super-héroïque, mais dont l’exactitude historique me semble des plus limitées…). Leur glorieuse carrière militaire se termine en martyre, puisqu’ils finissent par succomber sous le nombre, cuisante défaite relatée dans le cinquième et dernier épisode… que Miller a intitulé toutefois « Victoire ». (Désolé de révéler la fin, mais la bataille a eu lieu il y a plus de 2500 ans… et ce n’est pas son issue qui fait l’intérêt du scénario.) Cela fait beaucoup de déformations pour pas grand-chose, et cela soulève une question toute simple : pourquoi s’entêter à se fonder sur un événement historique pour le respecter aussi peu ? Pourquoi ne pas avoir simplement inventé l’histoire de toutes pièces ? La réponse se trouve dans le projet de l’auteur, et c’est là que le bât blesse.
Frank Miller est un auteur de comics reconnu aux États-Unis, auteur de plusieurs chefs-d’œuvre du genre, dont plusieurs ont été adaptés au cinéma (par exemple Sin City, qu’on peut traduire par La Cité du péché ou, en gardant l’allitération dont les anglophones sont friands, La Ville des vices ou Le Patelin du péché – si cela vous rappelle les titres des films des années 1930, c’est le but, puisque le récit s’en inspire, mais les publicitaires du film en France n’ont pas dû juger que cela aiderait le film à attirer du public et ont préféré ne pas traduire le titre). L’une des principales qualités de la bande dessinée 300 réside dans son art achevé du récit visuel, notamment d’impressionnants dessins en pleine page. Le scénario, en revanche, s’il est porté par un souffle épique indéniable, m’a laissé sceptique par sa simplicité manichéenne et par l’idéologie implicite qui gouverne ses choix dans les libertés prises avec l’Histoire, des choix que Miller a effectués en pleine connaissance de cause puisqu’il s’est documenté sur la bataille avant d’écrire son scénario. Un tel univers, où la Grèce est entièrement éclipsée à l’exception d’une Sparte héroïsée dont le gouvernement aristocratique et eugéniste (les bébés malades ou handicapés sont jetés du haut d’une falaise – détail macabre mais, pour le coup, conforme à la réalité historique) fait de la vie civique une machine de guerre, où les Perses sont décrits comme une foule bigarrée de barbares décadents gouvernés par leur sensualité débridée et menés par un roi-dieu tyrannique, où l’apparence dit tout sur les qualités morales (les gentils sont beaux, les méchants sont laids et vice-versa), atteint un degré de fidélité inédit à son sujet dans la mesure où il pourrait être directement le produit de l’imagination d’un Spartiate du Ve siècle écrivant un texte de propagande pour glorifier sa cité !
Mais nous sommes au XXIe siècle, et héroïser Sparte au XXIe siècle n’a plus exactement le même sens. Rappelons que la cité de Sparte s’est caractérisée par l’un des régimes aristocratiques les plus durs de Grèce, par l’éducation la plus violente et par le pire traitement de ses esclaves, les hilotes. Il est quelque peu embarrassant de choisir cette cité en particulier comme parangon de l’héroïsme. Qui plus est, une telle reprise s’inscrit dans la lignée de nombreux « laconophiles » (admirateurs de Sparte), qui, en majorité, n’ont pas exactement été de fervents partisans de la démocratie. Démocratie que les Spartiates détestaient, d’ailleurs, comme ils le montrent bien pendant la guerre du Péloponnèse qui les oppose à Athènes entre 430 et 404 avant J.-C. : victorieuse, Sparte abolit le régime démocratique athénien et y impose un régime aristocratique policier et brutal, la Tyrannie des Trente, heureusement renversé au bout d’un an environ.
Frank Miller est très loin d’ignorer cela, et ses convictions politiques personnelles l’ont peu à peu rapproché de ce que les États-Unis comptent de plus extrémiste en matière de patriotisme violent, pour ne pas dire fascisant. Ses interviews sont éloquentes sur le degré de non-subtilité de sa vision du monde, en particulier du monde arabe, et elles confèrent une signification politique assez consternante aux anachronismes volontaires qu’il commet dans sa représentation des Perses de 300, montrés comme des combattants islamistes actuels dans un contexte qui n’a rien à voir (rappelons que l’empire perse était une monarchie avec suzerains et vassaux assez proche d’un empire médiéval européen dans ses mécanismes politiques, et non une organisation terroriste oeuvrant en marge des gouvernements ; quant à l’islam, il est apparu grosso modo mille ans après les guerres médiques…). Peu après l’adaptation en film de 300, un autre comic en date du monsieur, Holy Terror, paru en 2011, qu’il présente lui-même comme « un outil de propagande », mettait en scène un super-héros, le « Réparateur », partant en guerre contre Al-Qaida ; et ce qui aurait n’être qu’un récit médiocre sur le modèle de vieux comics de propagande du type Superman vs. Hitler, ou bien un joyeux défoulement lisible au second degré, s’est avéré un torchon gavé de l’islamophobie la plus primaire, qui a déconcerté et rebuté nombre de ses amis dans le métier et toute une partie de ses anciens fans. Bref, les choix de 300 en matière de liberté créative ne vont pas sans relents nauséabonds.

…et son adaptation
Revenons-en au film. Zack Snyder est un fan de comics, qui a déjà signé plusieurs adaptations toutes caractérisées par un recours abondant aux effets spéciaux numériques : ses films font partie de ces grosses productions récentes où la frontière entre prises de vue réelle et animation n’existe pratiquement plus, tant les images des acteurs sont lourdement retouchées. L’adaptation de 300 par Snyder se veut très fidèle à l’univers visuel du comic, et en accentue encore la dimension fantastique. Ciel d’encre, contrastes accentués, taches rouges des capes et des gerbes de sang, éclats métalliques des armes et des boucliers : les images du film sont autant de tableaux qui rappellent l’art pompier du XIXe siècle. La réalisation use et abuse des ralentis esthétisants hérités du bullet time de Matrix pour donner à voir (admirer ?) les corps des guerriers en plein élan, les corps d’ennemis transpercés, le sang qui gicle. Certains plans s’inspirent par ailleurs des procédés de mise en scène des jeux vidéo d’action, comme le défilement en parallaxe horizontale, qui donne à voir le personnage avançant pour tuer l’un après l’autre des ennemis qui se présentent en face de lui, tandis que le décor défile au rythme de sa course (ces scènes sont reconnaissables au sentiment de profonde frustration éprouvé alors par le spectateur du film, qui cherche en vain la manette de jeu). La bande originale du film, quant à elle, recourt moins à l’orchestre symphonique qu’à la guitare électrique. Il faut avouer qu’une bataille de hoplites sur fond de heavy metal, il fallait le faire, et cet anachronisme musical frappant joue paradoxalement en faveur du film, parce qu’il en souligne les écarts avec la réalité historique en rappelant à tout moment qu’on a affaire à un film d’action décomplexé.
Le film apporte plusieurs modifications au scénario de la bande dessinée. La reine de Sparte, Gorgô, a un rôle beaucoup plus développé. Et surtout, le film me paraît autoriser davantage de distance critique envers les Spartiates que le comic de Miller : l’introduction donne un tableau très sombre de l’eugénisme spartiate, et un certain nombre de répliques montrent que les Spartiates ne sont pas tellement meilleurs que les Perses qu’ils combattent. Malheureusement, le fond ne change pas beaucoup : même exaltation des Spartiates, mêmes moqueries envers les Athéniens avec « leurs philosophes et leurs amateurs de mecs », même manichéisme et même simplisme dans le partage entre des héros à la plastique sculpturale et des méchants invariablement dépeints comme laids, handicapés, monstrueux ou décadents. Le résultat atteint un tel degré d’outrance qu’il en devient difficilement tenable. Par exemple, il faut bien garder à l’esprit que ces Spartiates, si prompts à se moquer de la sexualité de leurs camarades athéniens, sont tous bodybuildés comme des Hercule de péplum italien des années 1950, et se promènent tous vêtus en tout et pour tout de sandales, d’une cape rouge, d’un casque et d’un… slip en cuir complètement anachronique, sorti de nulle part pour dérober au public puritain américain la vue de leurs organes génitaux (on pouvait imaginer de leur mettre des pagnes, plus proches de la réalité historique, mais Miller semble nourrir une peur panique de tout ce qui pourrait même lointainement ressembler à une jupe sur un corps d’homme). Une telle moquerie dans la bouche d’un Spartiate est donc plus comique qu’autre chose dans un film qui a établi un nouveau record en termes d’homoérotisme refoulé sur le grand écran.
Ce film est à mon sens l’exemple typique d’un récit qui peut être regardé et compris de multiples façons différentes selon le niveau d’éducation du spectateur et le type de références culturels dans lequel il a baigné auparavant. On peut le regarder comme un pur divertissement, et y voir soit un horrible nanar, soit un film d’action réussi, indépendamment de son manque complet de subtilité. Mais le contenu du film, comme celui du comic, rend parfaitement possible d’admirer au premier degré la violence qu’il esthétise et l’idéologie guerrière qu’il promeut, voire de le regarder comme un authentique appel à un choc des civilisations, idéologie dont Franck Miller se réclame. Des spectateurs particulièrement mal informés risquent même de prendre pour argent comptant les déformations historiques auxquelles recourt le scénario pour exagérer le rôle de Sparte au détriment de celui des autres cités. Autrement dit, comme toujours, une mauvaise connaissance de l’Antiquité expose à toutes les récupérations politiques et idéologiques.
Par bonheur, le film est si outré qu’il a donné lieu immédiatement à d’innombrables parodies, sur Internet (le fameux cri de Léonidas « This is Sparta ! » en tuant l’émissaire perse est devenu un « mème ») et aussi en film, puisqu’une parodie québécoise, Spartatouille, est sortie en 2008. De quoi rassurer un peu sur les risques de prendre le film trop au sérieux. D’ailleurs, si vous comprenez l’anglais, je vous recommande l’hilarante « bande-annonce honnête » de 300, sur la chaîne Youtube Honest Trailers, qui se fait un plaisir de récapituler les excès du film.




 Publié par Liber
Publié par Liber