Référence : Naissance des pieuvres, film français réalisé par Céline Sciamma, produit par Lilies Films, 85 minutes, sorti en France en 2007.
La bande annonce
Tous les films n’entretiennent pas les mêmes relations avec leur bande-annonce. Il y a les bandes-annonces qui, avides de bien montrer à quel genre le film appartient et à quel public il se destine, le découpent en morceaux et le réduisent à un alignement de poncifs qui donnent l’impression (parfois injuste) de l’avoir déjà vu cent fois. D’autres bandes-annonces, en général pour des films à gros budget, se contentent d’accumuler les explosions et les plans à effets spéciaux (et, souvent, les poncifs). Il y a toute une catégorie de bandes-annonces qui forment quasiment des courts-métrages d’une durée comprise entre une et trois minutes. Certaines en disent trop et montrent si bien l’intrigue du film qu’en arrivant au bout on a l’impression d’avoir découvert tout ce qu’il y a à voir, ce qui endort la curiosité au lieu de l’entretenir et dispense de voir le film complet. D’autres savent faire mieux : sans dévoiler l’intrigue, elles montrent juste ce qu’il faut pour se faire une idée du sujet et de l’esthétique du film.
La bande-annonce de Naissance des pieuvres est de celles-là. Une musique synthétique hypnotique, des groupes de filles en maillot de bain qui s’entraînent à la natation synchronisée, des jeux de regards et des variations lumineuses suggérant une relation, amitié ou désir… et c’est tout. Ce qui renforce l’impression d’un court-métrage quasiment autonome, dans le cas de cette bande-annonce, c’est qu’elle dispose de sa propre musique, absente de la bande originale du film, mais tout aussi réussie (l’ensemble a été composé par le DJ français Para One). Voilà donc ce qui m’a intrigué. Qu’en est-il du film ?
Le film
La bande-annonce donne un bon aperçu de l’esthétique du film (ce qui explique que je lui aie consacré tant de place au début de ce billet). Ce qui frappe dans Naissance des pieuvres, c’est d’abord l’économie de mots de son scénario. L’image, la musique, les ambiances sonores, et bien entendu le montage, occupent une place importante, proportionnelle au rôle du regard dans l’intrigue. Car c’est avant tout un film sur le désir et ses ambiguïtés, et le jeu des regards est l’un des principaux moyens de porter le désir.
Qui regarde qui ? Marie, une jeune fille brune, maigre et réservée, regarde un spectacle de natation synchronisée. Son attention est retenue par un groupe de nageuses, parmi lesquelles la capitaine, une jeune fille dans le genre blonde plantureuse, qui semble pleine d’assurance. Pendant ce temps, dans les vestiaires, Anne, une jeune fille mal à l’aise avec ses formes rondes, se fait reluquer accidentellement par un garçon, François. Voilà les quatre personnages principaux du film : non seulement il n’y en aura pas plus, mais François n’est guère qu’un enjeu peu développé à côté des trois filles, qui sont les véritables héroïnes. En fait de plongée, c’est une plongée dans l’univers des filles, loin des garçons qui se cantonnent à des plans de groupes mal dégrossis, loin aussi des adultes qui semblent perpétuellement absents, hors jeu, peut-être parce que ce n’est pas à eux qu’on veut se confier sur ces sujets et à cet âge. Tout est prêt pour un huis clos au sein d’un genre et d’une classe d’âge.
Peu de mots, mais ils sonnent juste. Ayant maintes fois subi les tentatives piteuses de séries télévisées ou de téléfilms pour faire parler des personnages d’adolescents de manière réaliste, j’ai été impressionné par la capacité du film à montrer des adolescentes crédibles. Le scénario de Céline Sciamma n’y est pas pour rien (il a d’ailleurs été primé, tout comme plusieurs de ses scénarios suivants) : il excelle à reproduire la syntaxe entrecoupée des dialogues familiers, le laconisme mi-timide, mi-cruel des échanges où chaque coin de phrase peut ménager un retournement de situation, l’irruption d’une tension ou la révélation d’un attachement, des traits d’esprit étincelants ou assassins, une poésie fugace. Mais le meilleur scénario ne pourrait rien sans le talent des actrices, toutes marquantes, chacune dans un registre distinct.
Dès les premiers plans, on est invité à tenter de cerner les relations entre les personnages. Et on n’y arrive jamais vraiment, tant le film ménage de non-dits et d’ambiguïtés savantes. La seule chose qui devient claire (assez vite pour que j’en parle sans vous divulgâcher l’intrigue) est l’amour de Marie pour Floriane. Mais tout le reste demeure dans un flou remarquable, ouvert à toutes vos interprétations personnelles. Marie et Anne sont-elles amies ou davantage au début du film ? Que deviennent-elles ensuite ? Que ressent Floriane au juste, et pour qui ? Ce qui est remarquable dans ce jeu des désirs et des silences, c’est la manière dont le film, tout en feignant de présenter les choses de manière claire (trois filles célibataires qui cherchent à sortir avec des garçons), fait éclater allègrement les catégories toutes faites en matière de couple et d’orientation amoureuse et sexuelle. Selon la manière dont vous comprenez tel échange de regards, tel geste ou telle réplique à tel moment donné, vous ne penserez pas la même chose sur qui désire qui, qui sort avec qui et qui faire entrer dans les sacro-saintes catégories de l’hétérosexualité et de l’homosexualité – auxquelles ajouter la catégorie de la bisexualité n’est qu’un faible moyen de commencer à répondre à ces multiples ambiguïtés.
Autant que de désir ou de sentiment, l’emprise est un thème primordial dans ce film. Rarement film aura dépeint de manière aussi patente les jeux de pouvoir qui se nouent entre adolescentes à la faveur de cette étape de la vie où l’on est plus fragile et plus exposé que jamais face face au groupe et à ses attentes, face à une autre personne à la psychologie différente. C’est en termes d’emprise, de domination psychologique, que je comprends personnellement le titre du film, Naissance des pieuvres. Les pieuvres, ce sont ces gens qui mettent les autres sous leur coupe, profitent d’eux, les manipulent et parfois leur font beaucoup de mal. La « pieuvre » par excellence, en apparence, c’est Floriane, avec son corps plus adulte que ceux des autres, son aplomb et sa sensualité affichée, provocante, qui intimide terriblement Marie, la brunette osseuse et introvertie. Par bonheur, le film dépasse ces archétypes, qui se révèlent n’être que des apparences. Chacune, au fond, peut être la pieuvre de quelqu’un, et le mot pourrait même s’appliquer aux hommes.
Pour autant, ce n’est pas impossible de comprendre le titre de manière plus littérale, si on considère que les pieuvres sont un terme flatteur pour désigner les nageuses. Sans être un « film de sport » (on n’en verra jamais beaucoup la technique), le film ménage d’impressionnants aperçus du travail d’un groupe de natation synchronisée. Il fait voler en éclats les clichés nés des vieilles comédies musicales hollywoodiennes comme La Première Sirène (Mervyn LeRoy, 1952) en montrant la force physique et le travail acharné qui se dissimulent derrière ces numéros tout en grâce et en sourires.
Une autre prouesse m’a frappé en repensant à ce film : la manière dont il adopte résolument le point de vue de certains personnages plutôt que d’autres (celui de Marie et d’Anne plutôt que de Floriane, ceux des filles à l’exclusion de ceux des garçons)… sans pour autant nous donner accès clairement à leurs pensées et à leurs sentiments. Le personnage de Marie, qui est celui que l’on suit du plus près du début jusqu’à la fin, n’est pas le moins énigmatique. C’est une grande différence du cinéma avec la littérature : autant, dans un roman, on peut exprimer les pensées et les moindres ressentis d’un personnage en adoptant une focalisation interne, autant, au cinéma, il est toujours difficile de montrer la pensée ou l’émotion intime, car tout doit passer par l’image, c’est-à-dire par les surfaces (l’expression du visage, la posture, les gestes), ou par le son, c’est-à-dire déjà une expression (même une voix off reste une parole), sans moyen d’aller chercher la pensée à sa source. Céline Sciamma retourne cette limite pour en faire une force, en nous rappelant à plusieurs reprises, par les réactions inattendues d’un personnage, que cette adolescente qu’elle nous donne à voir depuis une demi-heure ou une heure, nous ne la connaissons toujours pas si bien, si tant est qu’elle se connaisse elle-même.
Les nombreux plans silencieux en extérieur, ainsi que les silences entre personnages dans les chambres, les vestiaires ou les boîtes de nuit, entretiennent ce jeu d’ambivalences. La musique, quant à elle, renforce la confusion jusqu’à son point de rupture. Les compositions électroniques de Para One installent des ambiances insidieuses, lourdes de mal-être ou pesantes d’hypnose, des compositions sans mélodie claire, où l’on se perd comme en apnée sous l’eau après le tout premier plongeon. Dans la seconde moitié du film, au contraire, la musique fait pulser des rythmes jusqu’à la transe, exprimant à mon sens l’ivresse du désir, de l’amour fou, le moment de tous les possibles en boîte de nuit. Ce recours à la musique électronique et cette esthétique du ravissement, du vertige par le rythme, m’a rappelé les films de Xavier Dolan comme Laurence Anyways, à cette différence que Céline Sciamma opte en général pour des musiques purement instrumentales, sans paroles.
N’espérez pas que la fin du film vous livre toutes les réponses aux questions qu’il soulève. Céline Sciamma, scénariste, ne doit pas être une grande adepte de la Poétique d’Aristote, ni des arcs narratifs actuels où chaque personnage est censé partir d’un point A bien défini pour se rendre jusqu’à un point B tout aussi clair (la mort ou la vie, le célibat ou le couple, le bonheur ou la misère) et si possible satisfaisant (« Et ils vécurent heureux… »), où le public peut le laisser en toute tranquillité d’esprit au moment de quitter la salle sur fond de générique. En ce qui me concerne, je trouve que ce n’est pas plus mal et que la fin ouverte du film, paradoxalement, clôt son univers sur lui-même en une bulle d’émotions fortes qui ne perdra jamais son énergie, ni son intérêt. Le microcosme de Naissance des pieuvres devient ainsi une sorte de jardin de masques troublants, un genre contemporain de Fêtes galantes cinématographiques dont les images ne sont pas près de cesser de me hanter. Ce film est à mes yeux une leçon de cinéma, précisément parce qu’il montre une maîtrise complète des procédés du medium, doublée d’une capacité à les tordre au service d’un récit personnel pour mieux parler du réel.
Dans le même genre
De Céline Sciamma, j’ai vu aussi Tomboy (2011) qui m’a paru bien beau sans me faire non plus l’effet d’un chef-d’oeuvre, ainsi que l’excellent film d’animation Ma vie de Courgette, plus travaillé dans son évocation de l’enfance et de ses différentes facettes, et dont Céline Sciamma a signé le scénario, avec Claude Barras à la réalisation (2016). Je n’ai pas encore vu Bande de filles ni Portrait de la jeune fille en feu, mais je compte bien combler ces lacunes très bientôt. Au passage, l’ensemble des films de Céline Sciamma, outre les DVD, sont disponibles en vidéo à la demande sur la foisonnante plate-forme UniversCiné, que l’on peut utiliser par achats ponctuels de visionnages ou de téléchargements ou bien par abonnement.
En matière de belles histoires d’amour entre femmes, j’ai eu l’occasion d’évoquer ici la bande dessinée de Julie Maroh Le Bleu est une couleur chaude (parue en 2010). Au cinéma, j’ai parlé de deux films sur des écrivaines : Colette de Wesh Westmoreland (2019), avec Diane Kruger dans le rôle-titre, et Vita et Virginia de Chanya Button (2019 aussi), sur Virginia Woolf et Vita Sackville-West. Aucun des deux n’est parfait, mais les deux valent largement le détour.
Du côté des hommes, si vous cherchez une évocation de la naissance de sentiments ambigus à peu près au même âge que les personnages de Naissance des pieuvres, je ne peux que vous recommander le magistral roman Les Amitiés particulières de Roger Peyrefitte (1972), qui se situe cependant davantage du côté de la belle prose classique et de la vieille France que des élans très actuels de la cinématographie de Sciamma. Pour quelque chose de plus récent, mais aussi de plus romantique – et si vous lisez l’anglais – je vous recommande la belle BD en ligne Prince of Cats de Kori Michele.
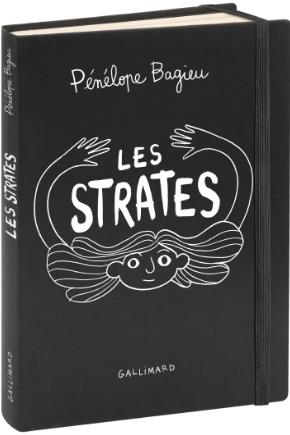



 Publié par Liber
Publié par Liber 



