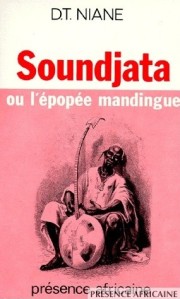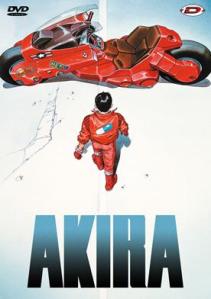L’Inde dispose d’un cinéma foisonnant, extrêmement varié, mais trop peu connu en France où les films indiens sont encore trop mal diffusés ou peu commentés par les médias, en dehors de quelques exceptions (notamment la fastueuse version de Devdas réalisée par Sanjay Leela Bhansali en 2002, avec les stars Shahrukh Khan et Aishwarya Rai Bachchan dans les rôles principaux). Or depuis une bonne quinzaine d’années, l’Inde s’est aussi dotée d’un cinéma d’animation de plus en plus florissant. D’abord cantonnés au rôle de sous-traitants pour des studios étrangers (le plus souvent américains ou européens), les animateurs indiens ont pris leur autonomie, ouvert leurs propres studios et commencé à réaliser leurs propres films animés, destinés avant tout au public indien et jamais diffusés en France… jusqu’à maintenant.
Pas encore de miracle, cela dit : Kochadaiiyaan est sorti dans très peu de salles (moins d’une dizaine, à ce que j’ai pu trouver), et dans un silence médiatique aussi impeccable que désolant, du moins de la part des grands titres de presse que j’ai pu consulter. Cela dit, cela valait peut-être mieux pour lui : les mauvais journalistes de cinéma ont tendance à méconnaître complètement la richesse extraordinaire des techniques et des styles d’animation et à estimer que tout ce qui n’est pas un film animé en images de synthèse à très gros budget, de préférence américain et avec un style à la Pixar, ne peut être qu’un mauvais film ou une curiosité anachronique (à l’exception des films de Hayao Miyazaki qui sont tous qualifiés de chefs-d’œuvre, mais c’est l’exception qui confirme la règle). C’est naturellement loin d’être le cas et, même si Kochadaiiyaan n’est certes pas un chef-d’œuvre, ce n’est pas une raison pour ne pas en dire quelques mots.
Une nouvelle pierre dans un édifice en plein chantier : l’animation indienne
Aller voir Kochadaiiyaan dans un cinéma français, en 3d relief, c’est avoir un aperçu d’une animation en plein essor dont les artistes et les techniciens accomplissent chaque année des pas de géants, et qui pourrait bien donner naissance dans peu d’années à de grosses productions capables de rivaliser avec Disney ou Dreamworks, voire des œuvres uniques à la personnalité aussi forte que celle des films d’animation français ou japonais par exemple. Ce ne sont ni les studios, ni les animateurs, ni la technique, ni les idées, ni la personnalité qui manquent, seulement à la rigueur le budget (mais l’Inde, tout comme les États-Unis, possède ses énormes studios – ce qu’on appelle « Bollywood » ou « Kollywood » – capables d’aligner les films à gros budget chaque année) et surtout l’expérience. Passer de la sous-traitance ou bien de la production de publicités, de clips, de courts métrages ou de séries d’animation télévisées à un film au format long métrage, c’est un pas qui n’a rien d’évident et que n’importe quel studio d’animation dans le monde aborde toujours avec appréhension : les exigences de qualité sont sans commune mesure, les enjeux financiers aussi.
Il y a peu de temps, l’Inde en était encore au temps des pionniers. Les studios d’animation existent dans le pays depuis les années 1950 et, depuis une vingtaine d’années, l’arrivée de l’animation par images de synthèse a réclamé de former les animateurs à des techniques entièrement différentes. L’Inde a déjà produit des dessins animés de bonne qualité, comme Ramayana: The Legend of Prince Rama, certes co-produit avec le Japon (co-réalisé par Yugo Sako et Ram Mohan), en 1992, qui offre un aperçu du mariage aussi étonnant que réussi entre l’univers de la mythologie hindoue venu tout droit de l’épopée du Ramayana, un univers visuel nettement indien et un style d’animation très proche des dessins animés japonais. Mais, à ma connaissance, il n’y a pas eu tant que ça de grands dessins animés indiens avant le tournant de l’an 2000.
Kochadaiiyaan est loin d’être le premier dessin animé indien à être animé en images de synthèse. Ce titre ne revient pas non plus à Roadside Romeo, co-produit par Disney en 2008, qui s’en targuait abusivement. Non, il faut chercher bien plutôt autour de l’an 2000 (soit à peine cinq ans après Toy Story de Pixar qui était le premier film d’animation en images de synthèse tout court) pour trouver déjà une production indienne, Pandavas : The Five Warriors, réalisée par Usha Ganesarajah et produite par le studio Pentamedia Graphics (là encore, on est en pleine mythologie : le sujet du film est emprunté au Mahabharata, l’autre grande épopée indienne antique). Kochadaiiyaan n’est pas non plus le premier film indien animé en capture de mouvement, puisque Sindbad : Beyond the Veil of Mists, le précédent film de Pentamedia, sorti également en 2000, avait déjà systématisé cette technique à l’échelle d’un film. Tant les Pandavas que Sindbad recherchaient déjà un rendu réaliste. À visionner des scènes de ces films, on a le sentiment de voir des scènes cinématiques de jeu vidéo de la fin des années 1990 : les décors sont bien faits, les costumes et accessoires bien modélisés et riches en détail, mais l’animation elle-même et le rendu de détails comme les ombres et les effets de lumière ne sont pas encore très élaborés. Comme les effets spéciaux vieillissent vite ! Les spectateurs non avertis auront vite fait de se moquer de ces premiers essais, en oubliant la prouesse technique qu’ils représentaient encore aux États-Unis il y a quinze ans.
Dans l’intervalle, l’industrie de l’animation indienne s’est développée à toute vitesse, portée par des succès comme celui de Hanuman en 2005 (en dessin animé). Toutes sortes de studios se sont créés et les films se sont multipliés, chacun tentant d’avoir sa part du gâteau auprès du public, sans que le succès soit toujours au rendez-vous. Les techniques employées restent aussi bien le dessin animé (comme dans la co-production indo-disneyenne Arjun, the Warrior Prince en 2012, de nouveau inspiré du Mahabharata et qui ne semble malheureusement pas avoir trouvé son public) que les images de synthèse (par exemple Bal Ganesh en 2008, qui raconte la jeunesse du dieu Ganesha dans un style cartoonesque, ou Ramayana : The Epic de Chetan Desai en 2010). Les sujets sont souvent mythologiques, voire franchement religieux (comme dans Dashavatar en 2008), ou bien reprennent sous forme animée les sujets et les conventions des gros films « bollywoodiens » (comme Roadside Romeo déjà cité ou Koochie Koochie Hota Hai en 2011).
Un prince parfait se venge d’un roi secrètement fourbe
Cette longue introduction permet de mieux comprendre l’intérêt de Kochadaiiyaan. À commencer par l’originalité de son sujet : contrairement à ses prédécesseurs qui ne se détachaient pas des sujets mythologiques préexistants, Kochadaiiyaan est un film d’aventure de fantasy situé cette fois dans un univers entièrement fictif, quoique toujours proche de l’atmosphère des grandes épopées indiennes et inspiré davantage par l’Inde médiévale réelle que par les fictions à forte dose de merveilleux : oubliez les elfes, les orques et les magiciens barbus, et sortez plutôt les guerriers à moustache, les princesses en sari, les chars à chevaux et les complots de palais. Précisons aussi que le film s’adresse davantage aux adolescents et aux adultes qu’aux très jeunes enfants (disons que je le classerais dans la catégorie des « 12 ans et plus »).
L’histoire est celle d’un bon film d’aventure rempli de ficelles classiques mais efficaces. Dans un lointain passé, deux royaumes rivaux sont constamment en guerre. Un tout jeune prince, Rana, entreprend, pour des raisons qu’on ignore, un voyage périlleux vers le royaume ennemi. Arrivé à moitié mort dans ledit royaume, sans qu’on connaisse son identité, il y grandit et devient un grand guerrier. Promu au titre de commandant en chef de l’armée royale, il découvre dans les mines secrètes du roi des milliers d’esclaves venus de son royaume natal, qu’il n’a pas oublié. Il obtient de changer ces esclaves en guerriers et de les mener au combat contre leur propre royaume… pour bien évidemment rentrer chez lui avec eux et rejoindre les armées de son royaume natal. Ce premier exploit ne couvre que les quelques premières minutes du film et ouvre une longue série de prouesses. Les enjeux réels du film ne se dévoilent que progressivement, lorsqu’on découvre la haine a priori inexplicable que Rana voue à l’actuel roi de son royaume natal. Pour la comprendre, il faudra un flashback relatant la vie du père de Rana, Kochadaiiyaan, le héros à la crinière de longs cheveux, injustement trahi par le roi.
Le film fait alterner avec une bonne régularité les scènes d’action épiques (un peu sanglantes, donc pas destinés à de très jeunes enfants, quoique sans surdose d’hémoglobine) et les scènes plus calmes de réflexion, de complots ou d’amour. Les rebondissements sur les motivations cachées de Rana et du roi sont bien amenés et confèrent à l’histoire un côté feuilletonnesque pas désagréable. L’ensemble fait parfois penser au Comte de Monte-Christo d’Alexandre Dumas pour la vengeance et les secrets, et au Cid de Corneille pour les exploits guerriers et les dilemmes familiaux, le tout dans un univers qui emprunte tout de même au Mahabharata ses héros surpuissants et moralement irréprochables et ses royaumes rivaux.
Pour un public européen ou américain, le scénario du film rappellera surtout les films d’aventure du milieu du XXe siècle comme ceux mettant en scène Errol Flynn (Les Aventures de Robin des bois, L’Aigle des mers) ou, sous nos latitudes, les films de cape et d’épée façon Scaramouche ou Le Bossu. Comme dans ces films, le héros est présenté comme foncièrement bon (« Loyal Bon », diraient les joueurs de Donjons et Dragons) et lutte contre l’injustice avec un esprit de sacrifice qui n’a d’égal que son sens de la répartie. Rana et Kochadaiiyaan ne sont cependant pas aussi rebelles et insolents que leurs cousins à rapière : ils sont parfaits, trop parfaits, et tombent parfois dans les travers des personnages de ce type, un peu trop lisses, comme Mickey ou Tintin. La critique vaut surtout pour Kochadaiiyaan lui-même, dont on comprend qu’il finisse par taper sur les nerfs de son roi à force d’être un modèle de vertu. Rana, de son côté, offre heureusement un personnage plus nuancé, vengeance secrète oblige. En outre, Kochadaiiyaan contient aussi une part d’humour qui équilibre bien ses éléments de drame, même si le tout devient peut-être un peu trop sérieux dans le dernier tiers du film.
Les héros principaux sont tous des hommes ; la plupart des personnages féminins ont simplement le rôle d’épouses ou de mères, mais la princesse royale est un peu mieux traitée puisqu’elle est aussi douée pour les arts martiaux que pour tomber amoureuse du héros. Si le film ne m’a paru contenir aucun message politique, social ou religieux particulier (les quelques allusions à Shiva sont banales dans le cinéma indien, majoritairement hindou, et se rapportent autant à l’univers des épopées mythologiques qu’aux réalités actuelles du pays), l’une des péripéties secondaires du film consiste en un mariage entre deux personnes de castes différentes encouragé par le héros, sujet qu’on retrouve fréquemment dans le cinéma bollywoodien mais qui n’est pas encore si évident dans la société indienne.
Dans la plus pure tradition bollywoodienne, le film est ponctué par de nombreuses chansons allant de pair avec autant de chorégraphies de la part des héros et de foules de figurants animés. Pour un public non habitué aux films de Bollywood, cela peut paraître un peu surprenant de voir des foules de danseuses, de villageois, de hauts dignitaires royaux ou même de soldats entonner une chanson en dansant au beau milieu d’une scène, mais c’est l’une des conventions les plus classiques de ce cinéma et pour autant qu’on l’accepte, elle ne manque pas de charme.
Reste une question qui m’a taraudé pendant plusieurs scènes : puisque Kochadaiiyaan et son fils sont supposés être des modèles de vertu si parfaits, pourquoi diable ne s’arrangent-ils pas pour faire la paix entre les deux royaumes au lieu de jouer les patriotes belliqueux ? D’accord, la guerre fait partie des conventions de ce genre de film, et il n’y aurait pas vraiment d’aventure si nos deux héros étaient encore plus doués. Mais une autre réponse apparaît à la toute fin, dont l’ultime rebondissement semble clairement fait pour permettre une suite au cas où le film aurait du succès. Pour le coup, c’est de bonne guerre.
Des images réussies, l’animation et la réalisation encore inégaux
Parlons maintenant des images et de l’animation – c’est là que les Athéniens s’atteignent et que les Pixar se pixélisent. Outre tout ce que j’ai dit sur le contexte propre à l’animation indienne, il faut ajouter que le film se revendique d’un rendu aussi photoréaliste que possible, à l’aide notamment de la technique de la capture de mouvements, et aussi que la production a été menée tambour battant en un temps record d’un an et demi. Une accumulation de paris périlleux.
Si l’on tient compte de ce contexte particulier, surtout par rapport aux précédents films d’animation indiens en images de synthèse, il faut convenir que les progrès sont sensibles. Kochadaiiyaan contient tout ce dont un film d’aventure épique a besoin, et il ne lésine pas dessus : villes et palais ou paysages naturels, armées en marche ou foules chamarrées de courtisans et de danseuses, jardins, tours, prisons, combats à pied, à cheval, en char ou sur mer, duels héroïques et assassins infiltrés, tout y est. Décors, costumes et accessoires impressionnent par leur luxe de détails, qu’il s’agisse des motifs des vêtements, de la texture de cuir des rênes d’un cheval ou de la peau des acteurs et actrices principaux. Bref, il y a des images superbes et le film n’est pas avare en grand spectacle.
L’animation elle-même est plus inégale. Les ombres, les reflets et les effets de lumière sont correctement rendus et l’ensemble garde un niveau de qualité professionnel, mais certaines scènes sont moins réussies que d’autres. Les ombres, parfois, sont un peu rares, et certains plans font penser à des scènes cinématiques de jeux vidéo du début des années 2000. Ça ne pique pas les yeux et ça reste regardable, mais ça n’atteint pas le niveau des grosses productions des pays riches. Le « photoréalisme » revendiqué n’est donc pas toujours au rendez-vous, bien que les éléments les plus importants, notamment les corps et les visages des acteurs principaux, restent particulièrement soignés.
Rien de surprenant là-dedans : je ne vois pas comment cela aurait été possible étant données les contraintes de temps et de budget des animateurs du film. Mais encore une fois, on serait trop sévère de voir dans le film un nanar sur la base de cette simple différence de niveau. À mes yeux, on est plutôt dans la catégorie intermédiaire, celle des films qui maîtrisent déjà bien les techniques numériques mais qui n’ont simplement pas les moyens de mettre des centaines de millions de dollars, d’euros ou de yens dans leurs effets spéciaux. Cela n’a jamais empêché personne de faire de bonnes choses avec des ordinateurs (par exemple, voyez L’Ours montagne d’Esben Toft Jacobsen, film danois sorti en 2011, ou Sam et les monstres de feu de Kompin Kemgumnird, thaïlandais cette fois, sorti en 2012).
Le film trouve ses défauts les plus gênants dans certains détails plus particuliers. Si les scènes de chorégraphies ne sont pas si mal transposées en animation dans l’ensemble, les expressions des personnages et les mouvements des lèvres sont parfois ratés, notamment dans certaines des premières chansons. Dans la première chanson d’amour, surtout, la princesse avait un regard terriblement inexpressif et prenait une allure de Barbie en plastique dans certains plans (mais faut-il blâmer les compétences des animateurs ou le jeu de l’actrice ?). Cela m’a inquiété pour la suite, mais les choses s’amélioraient ensuite, avec des scènes parfois franchement réussies.
Deuxième défaut, qui m’a davantage gêné pendant le film : la vitesse des déplacements de la caméra et la brièveté des plans, notamment dans les scènes d’action. Le film contient de nombreux plans magnifiques, mais trop vite expédiés. Est-ce par peur que des plans plus longs laissent voir les défauts de l’animation (alors que les décors et les costumes peuvent sans problème supporter d’être admirés), ou bien une concession abusive à la mode actuelle des montages frénétiques ? Toujours est-il que certaines scènes m’ont paru y perdre, que ce soient des scènes de combat (le combat contre les hyènes, par exemple) ou des scènes de danse (la danse de Kochadaiiyaan, par ailleurs visuellement et musicalement très réussie).
Dernier défaut : la 3d relief, correcte, mais qui ne supporte pas toujours bien ce montage trop nerveux, d’où quelques effets de relief aberrants dans quelques plans. Cependant, cela ne m’a pas beaucoup gêné, même si je reverrais bien le film en 2d à l’occasion.
Le bilan technique de Kochadaiiyaan reste globalement bon : le travail accompli est impressionnant, les images du film sont belles et riches en détails, les progrès par rapport aux précédentes productions du même type sont indéniables. L’animation indienne s’approche à grande vitesse de la cour des grands. Il est d’autant plus frustrant de voir des plans à l’animation perfectible ou au rendu imparfait. En sortant de la séance, je rêvais à ce que le film pourrait donner dans une version non pas « director’s cut » mais, disons, une version peaufinée qui améliorerait la finition de l’ensemble pour le rendre vraiment magnifique.
Une bande originale réussie
J’ai mentionné plus haut les chansons. Un film de Bollywood ne serait rien sans sa musique. Celle de Kochadaiiyaan est composée par A. R. Rahman, un grand nom de la musique de films en Inde. Et le résultat est incontestablement une réussite. Les chansons sont tour à tour entraînantes ou paisibles, toujours émouvantes. Chose assez rare pour être saluée, les paroles des chansons étaient aussi sous-titrées, ce qui permet de profiter pleinement de la poésie propre aux chansons bollywoodiennes, remplies d’images et de métaphores colorées que personne n’oserait inclure dans un film sous nos latitudes. Oubliez les figures de style parfois pâles ou cliché des dessins animés Disney : les chansons bollywoodiennes sont beaucoup plus dépaysantes, et, quand elles sont réussies, elles forment des poèmes à part entière. Les parties instrumentales ne sont pas négligées et accompagnent efficacement l’action le reste du temps.
Si vous voulez quelques exemples de la bande originale, je vous recommande la chanson « Engae Pogudho Vaanam » qui accompagne la première apparition de Rana et de ses guerriers : épique et entraînante, elle donne le ton pour les aventures qui suivent (le refrain signifie en gros « Là où vole le vent, nous allons »). Vous pouvez l’écouter par exemple sur Youtube. Parmi les chansons sentimentales, voyez la belle « Idhayam » qui exprime les doutes de la princesse Vadhana (là encore, on la trouve sur Youtube). Vous remarquerez vite que le film a été produit en au moins trois langues, chose très courante en Inde où la diversité linguistique est une réalité banale : la version originale du film est en tamoul, mais la bande originale a également été éditée dans des versions en hindi et en télougou.
En somme…
En somme, si Kochadaiiyaan n’a pas encore réussi à éveiller l’intérêt des médias sous nos latitudes, et si ses prouesses d’animation n’atteignent pas encore tout à fait le niveau suffisant pour conquérir un public toujours sévère en cette période de surenchère technique débridée, il reste néanmoins un film très regardable et témoigne des progrès rapides de l’animation indienne en ce début de siècle. Je ne serais pas surpris que, dans quelques années, l’Inde se hisse sans grand effort au rang des grands studios américains, européens ou japonais, et que ses films bénéficient enfin de la large diffusion que mérite le savoir-faire et la créativité de leurs animateurs.
Le film n’aurait pas pu se faire sans la célébrité et les moyens dont jouit en Inde Rajnikanth, dit « superstar », l’acteur principal du film : espérons que Kochadaiiyaan, qui bénéficie de plusieurs sorties à l’étranger, trouvera son public et ne dissuadera pas les producteurs de retenter l’expérience. Pour la réalisatrice, Soundarya R. Ashwin, fille de Rajnikanth, dont c’est le premier film, le pari était dangereux, mais il est relevé avec un résultat honnête, hormis le montage parfois trop frénétique. De quoi suivre avec curiosité les prochains développements de l’animation indienne et les futures réalisations d’Ashwin.
Sur les mêmes sujets
Si vous cherchez un film d’animation du même genre qui soit complètement réussi, je ne peux que vous recommander Ramayana: The Legend of Prince Rama de Yugo Sako et Ram Mohan (1992) dont je parlais plus haut. C’est un dessin animé de bonne qualité, qui rend justice à la fois à l’épopée du Ramayana et aux arts visuels indiens, avec une animation très correcte. Ce petit bijou injustement méconnu n’est malheureusement pas édité en DVD sous nos latitudes : il faudra vous contenter de le regarder en ligne en attendant qu’il soit enfin édité comme il le mérite. Parmi les films plus récents que je n’ai pas encore vus, Arjun, the Warrior Prince (2012) semblait très prometteur, également en 2d, mais avec un style proche des Disney de la période Tarzan ou des premiers dessins animés Dreamworks en 2d (du type Le Prince d’Égypte, La Route d’Eldorado ou Spirit ).
Si vous voulez plus d’informations sur Bollywood et le cinéma indien en général, allez donc faire un tour sur le Bollyblog d’A2, qui est une mine d’informations. A2 est passionnée de cinéma indien, et c’est même elle qui m’a fait découvrir Kochadaiiyaan, ce dont je ne peux que la remercier ! Si vous n’y connaissez rien au cinéma indien, il vous suffira de commencer par la page qu’elle a prévue spécialement pour les néophytes.




 Publié par Liber
Publié par Liber