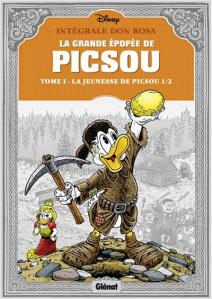Référence : Jâmi, Medjnoûn et Leïla, traduit du perse (Afghanistan) par Antoine Léonard de Chézy, Paris, Libella, coll. « Libretto », 2018. Le livre n’indique pas qu’il consiste en une simple réédition d’une traduction parue en 1807, notes comprises (voyez plus bas).
Quatrième de couverture de l’éditeur
« Cette histoire d’amour populaire dans tout le Moyen-Orient raconte les péripéties du poète bédouin Keïs et de sa cousine, la belle Leïla.
Ils évoluent au rythme d’une vie nomade caractéristique des Arabes de cette époque. Du fait de leur proximité, les campements qui s’établissent dans les oasis propices au repos sont un cadre idéal pour que les jeunes hommes et les jeunes filles de tribus différentes voient naître parfois les passions les plus vives. Mais la nécessité de changer régulièrement de lieu afin de trouver sa subsistance contrariait ces amours naissantes
Le récit tragique de ces deux amants, aussi fameux au Moyen-Orient que Tristan et Iseult ou Roméo et Juliette en Occident, est d’une simplicité extrême. Il a été mis en littérature par les plus grands poètes arabes, turcs, persans… La version ici proposée a été composée en 1487 par le poète Jâmi. Elle sera la source d’inspiration revendiquée par Louis Aragon pour son recueil Le Fou d’Elsa. »
Mon avis
Une mauvaise édition
Ah, la belle couverture tentante que cette miniature persane de Mirak Tabriz montrant Medjnoûn dans le désert ! Le beau petit livre en moyen format, facile à trimballer ! Le prix… le prix, on y reviendra. Un grand classique que ce texte, nous dit le quatrième de couverture, qui a raison… mais sur la qualité de cette édition elle-même, l’enchantement n’a guère duré. Si vous n’avez pas beaucoup de temps, voici la version courte : c’est une mauvaise édition, à la limite de la malhonnêteté, lisez plutôt le texte dans une autre édition ou lisez autre chose. Voilà. Si vous avez le temps, voici les raisons qui me font penser que c’est une mauvaise édition. Ce sera un peu long, mais parfois amusant (ou navrant, selon votre tempérament).
Tout commence par des notes de bas de page d’un genre assez particulier. Dès la première page du texte proprement dit, en page 11, la note 1, qui compare le début du texte à ceux d’autres poèmes composés dans d’autres langues, évoque une traduction due à « la plume élégante de M. Th. Law ». Plus loin, la même note mentionne des vers de Virgile en latin, sans les traduire, puis explique des mots persans en donnant leur équivalent… en latin. Personne ne fait ça dans une édition annotée destinée au grand public. Personne, du moins, de nos jours. Ayant eu souvent l’occasion de fouiner dans des éditions anciennes, je n’ai pas tardé à subodorer la réédition à l’identique d’une édition du XIXe siècle. Une rapide recherche avec le nom du traducteur sur le catalogue de la Bibliothèque nationale de France a confirmé mon intuition : le brave Antoine-Léonard de Chézy est mort en 1832 et il a publié cet ouvrage en 1807. C’est sa traduction, ainsi que ses notes, qui sont reproduites ici. Autrement dit, Libretto a proposé au lectorat de 2018 de redécouvrir un texte âgé de plus de six siècles (cette version de la légende date de 1487, selon la note de l’éditeur), mais avec une traduction et des explications elles-mêmes âgées de plus de deux cents ans.
Or, s’il paraît que le vin se bonifie en vieillissant, c’est rarement le cas des notes de bas de page. Qu’on en juge. En page 63, une note expliquant que la Kaba est la « Laison (sic) carrée de la Mecque » nous renvoie à ce sujet à la Description de l’Arabie de Niebhur, un ouvrage hautement à jour puisque paru en 1774. La note de la page 64 nous réserve une référence bibliographique devenue incompréhensible à tout autre que des initiés (« Voir R. labb. Gol. Lex., p.2091 », Libretto pensait sans doute organiser un jeu-concours pour récompenser les gens qui arriveraient à comprendre). La note de la page 67 renvoie à une Chrestomathie de « M. de Sacy » indiquée comme encore à paraître : il s’agit de l’Arabische Chrestomathie de Silvestre de Sacy, dont la traduction française semble être parue en 1806. A la page 101, une note est convaincue que les Arabes bédouins du XVe siècle avaient encore les mêmes tentes qu’ « au temps de Salomon » et renvoie à ce sujet à Pietro della Valle, voyageur des XVIe-XVIIe siècles (tant qu’à faire). Cela devient presque touchant aux pages 111-112, lorsque notre traducteur nous renvoie aux Mémoires sur l’Egypte dans leur édition parue chez Didot, à Paris, « en l’an 8 », c’est-à-dire les Mémoires sur l’Égypte, publiés pendant les campagnes du Général Bonaparte dans les années 1798 et 1799, bref, les comptes-rendus savants de l’expédition d’Egypte de Napoléon Ier. Vous l’aurez compris : ces notes sont complètement obsolètes sur le plan scientifique, et sont souvent elles-mêmes incompréhensibles, au point qu’il faudrait des notes sur les notes.
Tout aussi surannée est la conception du monde du traducteur. De Chézy emploie un style fleuri, des protestations de modestie et des éloges hyperboliques au sujet de ses collègues dont les universitaires actuels ont appris à se passer (ou à les rendre moins voyants). En homme du XIXe siècle commençant, il y va allègrement de son male gaze sur la beauté des personnages féminins du récit, en en appelant à une supposée complicité de son lectorat, sans oublier la misogynie ordinaire de la note de la page 126 (Leïla explique qu’elle n’a pas couché avec Medjnoûn. Commentaire de De Chézy : « Leïla fait là un léger mensonge ; mais quelle est la femme qui ait jamais dit la vérité sur ce point ? »). De manière plus anecdotique, aux pages 25-26, au sujet d’un détail gentiment érotique portant sur la taille des seins de Leïla, la note 1 se croit contrainte de se lancer dans une circonvolution compliquée et de citer Martial en latin (toujours sans traduction), simplement parce que notre pauvre homme tient à nous expliquer que « les Orientaux » aiment les femmes aux petits seins, mais, vivant au XIXe siècle, ne se sent pas autorisé à l’écrire clairement. Bref, il est de son époque et ses propos ont mal vieilli par endroits.
Je ne sais pas vous, mais, en ce qui me concerne, je ne suis nullement spécialiste de la poésie de l’empire timouride du XVe siècle. J’aurais donc été preneur d’un véritable apparat de notes et de commentaires, propre à m’éclairer sur l’oeuvre, son auteur et son contexte avec un savoir et des références à jour. Si la traduction de De Chézy revêt une importance particulière dans l’histoire littéraire française, qu’à cela ne tienne, mais, dans ce cas, que l’on ajoute des commentaires sur la traduction : ce n’est pas infaisable, et même, cela se fait régulièrement (je pense par exemple à la traduction en vers des Géorgiques de Virgile par l’abbé Delille, que Gallimard, dans l’édition parue en « Folio classique » en 1997, a pris soin de faire précéder d’une introduction conçue par une latiniste actuelle, Florence Dupont).
Rien de tel chez Libretto. Non seulement il n’y a aucun effort de remise en contexte de cette traduction, mais l’éditeur n’indique nulle part sa date de parution d’origine, pas plus que les dates de naissance et de mort d’Antoine-Léonard de Chézy, ni aucun autre renseignement à son sujet. Pourquoi avoir omis ces informations basiques, pourtant cruciales pour la compréhension et l’appréciation du texte ? C’est à la limite de la malhonnêteté.
Il y a pire. Au début du volume, une « note de l’éditeur » est censée nous renseigner sur l’auteur et le contexte. Elle est présentée sans signature, au point que j’en suis venu à me demander si elle datait de l’édition Libretto ou d’une autre édition plus ancienne. Elle est en tout cas postérieure à 1963, année de la parution du Fou d’Elsa d’Aragon, qu’elle mentionne. Je suis tout de même allé voir l’édition de 1807 en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France… Oui, parce que, naturellement, cette traduction, datant de 1807, est depuis belle lurette dans le domaine public, et elle est même consultable gratuitement sur Gallica (voyez ici la première partie et là la seconde).
Et la comparaison s’est révélée instructive. Premièrement : l’éditeur semble parfois paraphraser, sans aucun recul critique, un développement de De Chézy sur les coutumes des Arabes bédouins qui figure dans son premier volume aux pages XXV et suivantes.
Deuxièmement : la Note de l’éditeur de l’édition Libretto omet d’indiquer que la traduction de De Chézy est largement incomplète. Certes, elle indique que De Chézy omet les louanges à Mahomet que Djâmi place en tête de son récit selon la tradition de son époque. On pourrait, d’ailleurs, se demander pourquoi ne pas les réintégrer à une édition actuelle : après tout, nous nous farcissons bien les multiples lettres de compliments des dramaturges et romanciers de l’Ancien Régime adressées à leurs protecteurs ou protectrices ou au Roy… En plus, De Chézy affirmait en son temps dans sa préface (page XXXI) : « Ces morceaux renferment sans contredit des beautés du premier ordre »… Mais où avais-je la tête ? Cela aurait supposé de payer un traducteur encore vivant pour compléter la traduction de De Chézy ! Et il y a encore pire. En lisant un peu plus loin, je me suis aperçu que De Chézy prévenait, dans sa préface, qu’il avait aussi « omis plusieurs morceaux sans nul intérêt dans le corps de l’ouvrage, et diverses réflexions philosophiques qui le terminent ». De Chézy est si conscient du caractère personnel de ses choix qu’il se dit prêt à accepter que son ouvrage soit considéré comme « une imitation » plutôt que comme une traduction à proprement parler. Toutes nuances dont l’édition Libretto ne fait nulle mention. Libretto commercialise donc une traduction qui n’en est pas une, accompagnée de notes largement obsolètes, en les faisant précéder d’une « Note de l’éditeur » qui plagie deux paragraphes de la préface du traducteur et omet toutes sortes d’informations essentielles sur la date et la nature du texte.
Troisièmement, et de manière plus accessoire : dans l’édition de 1807, les notes du traducteur ne figurent pas au bas des pages, mais en fin de volume, ce qui explique qu’elles soient parfois très longues puisque De Chézy n’avait pas de contrainte particulière de place. L’édition Libretto les transforme en notes de bas de page, d’où des notes parfois démesurées qui s’étalent sur deux ou trois pages et prennent plus de place sur la page que le texte principal (par exemple en page 12 ou, pire, aux pages 68-69).
Quel était l’intérêt de rééditer cette version du texte ? Tel quel, le livre interdit de profiter pleinement du récit, à moins d’être un érudit en matière de littérature persane. Mais les universitaires qui travaillent dans ce domaine peuvent consulter directement les éditions anciennes en bibliothèque, et tout le monde peut consulter Gallica. Il n’y avait pas besoin d’en réimprimer tout un tirage. S’agissait-il de faire redécouvrir un classique oublié ? Mais dans ce cas, pourquoi le faire dans de si mauvaises conditions, plutôt que d’en faire faire une traduction nouvelle, ou au moins d’inclure une préface écrite par un spécialiste actuel de la littérature persane, afin de remettre le texte de Jâmi et sa traduction dans leurs contextes respectifs ? La démarche aurait été bien plus honnête et le résultat, bien plus intéressant.
Qu’un éditeur comme Libretto ne souhaite pas prendre la peine d’élaborer une traduction nouvelle, je peux l’admettre. Mais cela leur aurait-il coûté une telle fortune de demander à un ou une universitaire spécialiste du sujet de fournir une préface qui resitue tant l’oeuvre que la traduction dans leurs contextes respectifs ? Non. C’est donc une édition pingre, facile, de la réimpression au kilomètre sous une couverture aguicheuse, bref, une mauvaise édition.
En un mot comme en cent : n’achetez pas cette édition si vous voulez comprendre quelque chose au texte, et tournez-vous plutôt vers d’autres ouvrages mieux édités, plus respectueux de leur lectorat, qui vous permettront de découvrir la littérature persane ancienne dans de meilleures conditions.
Un grand texte
Il est grand temps d’en venir à l’oeuvre elle-même. Une précision sur son auteur, d’abord, dont « Jâmi » est une manière ancienne de transcrire le nom. J’ai l’impression qu’actuellement, on le transcrit plutôt « Djami ». Son nom complet est Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad Nūr al-Dīn Ǧāmī et il vit de 1414 à 1492, la plupart du temps à Hérat, dans ce qui est maintenant l’Afghanistan et qui, à l’époque, faisait partie de l’empire timouride. Ses écrits sont marqués par le soufisme, dont les conceptions sur la sagesse transparaissent apparemment dans Medjnoûn et Leïla, mais je serais bien en peine de savoir comment au juste puisque cette édition a été incapable de me renseigner là-dessus.
Medjnoûn et Leïla est une histoire d’amour comme peu de gens oseraient en publier de nos jours. A nos yeux de gens du XXIe siècle, tout paraît excessif et hyperbolique dans ce récit. « Medjnoûn », un peu comme le Tristan de nos légendes médiévales, est marqué par un destin inscrit dans son nom, encore qu’il s’agisse ici d’un surnom que les bergers lui donnent quand ils contemplent les débuts de ses amours contrariées. « Medjnoûn » signifie en effet « l’infortuné » voire « le fou » (fou d’amour, naturellement). Une simple rencontre avec une belle et spirituelle jeune femme d’une tribu rivale, Leïla (« nuit »), suffit à provoquer chez les deux jeunes gens un coup de foudre dont les conséquences scelleront leur destin. La suite est, pour aller vite, une histoire à la Roméo et Juliette, à savoir un amour contrarié qui mène les amants à la mort… à cette différence que Roméo fait figure de tigre mangeur d’hommes à côté de Medjnoûn, que son amour rend pacifique jusqu’à l’extrême. Il en vient même à cesser de manger de la viande et à protéger une gazelle qui lui rappelle Leïla, y compris lorsque son ami et lui-même sont sur le point de mourir de faim dans le désert !
Cette intrigue est relatée dans un style si fleuri et enthousiaste qu’on pourrait le recommander à toute personne qui n’aurait pas le moral, en dépit du triste dénouement de l’histoire. Leïla est ainsi appelée « cette tendre fleur du jardin parfumé de la confiance, cette rose éclatante du printemps de la vie, cette jeune gazelle, dont les grâces enchanteresses eussent subjugué les coeurs les plus indomptables », et le reste est à l’avenant. Les personnages sont tous forts, beaux et intelligents, ce qui n’empêche pas ensuite que certains commettent des erreurs crasses (en particulier les pères qui font obstacle aux amours de leurs enfants). C’est une histoire d’amour qui m’a beaucoup rappelé le genre d’histoire d’amour qu’on peut trouver dans les romans grecs et romains de l’Antiquité (Chéréas et Callirhoé de Chariton, ou bien, pour citer un exemple un peu moins oublié, Daphnis et Chloé de Longus) et qu’on retrouve au XVIIe siècle dans des écrits comme Le Conte des contes de Giambattista Basile ou dans les nouvelles incluses par Cervantès dans la première partie de son Don Quichotte : on y trouve la même rhétorique hyperbolique sur la beauté et les autres qualités des personnages, les mêmes passions échevelées, les mêmes rebondissements romanesques devenus depuis des clichés du genre. Mais je ne sais pas du tout quels liens on pourrait (éventuellement) établir entre ces oeuvres. Pour le savoir, il aurait fallu demander à un ou une vraie spécialiste d’écrire une préface et/ou des notes…
Le contexte où évoluent ces personnages a quelque chose d’exotique à nos yeux : un univers de Bédouins plus ou moins inspiré du XVe siècle, mais en réalité assez atemporel, car en dehors de la mention du calife et du pèlerinage à la Mecque, on ne sait pas grand-chose du lieu et de l’époque précis où se déroule l’histoire. Ce ne sont pas les Mille et une nuits pour autant : il n’y a pas de surnaturel, seulement des passions excessives.
Vus depuis notre XXIe siècle trop porté au cynisme et à l’ironie, les personnages atteignent une telle plénitude dans leurs sentiments que leur romantisme débridé en devient rafraîchissant. Un peu de premier degré fait parfois du bien – quand bien même je me doute que le poète s’inscrit dans une longue tradition littéraire dont j’ignore les codes (j’aurais pu en apprendre un peu plus, si l’édition avait été mieux faite… pardon, j’arrête). Quant à vous, je ne sais pas si cela peut vous plaire : disons qu’il ne faut pas avoir peur des sucreries, mais ce sont des sucreries succulentes, de la première qualité.
Conclusion
Conclusion, eh bien, c’est un texte magnifique, mais qui mérite une véritable nouvelle édition, et même une traduction nouvelle en bonne et due forme, afin de donner à lire un texte entier (et non le texte coupé de partout de la « traduction » de De Chézy), de mettre à jour un certain nombre de traductions de vocables qui ont donné du fil à retordre au traducteur du XIXe siècle (c’est lui-même qui le dit dans plusieurs notes) et de mettre à jour introduction et notes pour refléter l’état actuel des connaissances. J’ai l’air d’en demander beaucoup ? Pas du tout : le grand public a le droit de s’instruire et il n’y a aucune raison de ne lui donner que des réimpressions tiédasses de traductions obsolètes annotées avec des connaissances obsolètes. Il faudra peut-être passer d’abord par une édition universitaire avant d’en venir à de meilleures éditions grand public. Cela implique, naturellement, une recherche française et francophone de qualité, dotée des moyens nécessaires, ce qui est toute une affaire en soi, les politiques ayant une fâcheuse tendance à ne rien connaître au fonctionnement de la recherche (surtout en littérature et en sciences humaines – quoique je doute qu’ils seraient plus à leur aise devant un accélérateur de particules). Mais je ne peux qu’appeler de mes voeux de nouveaux travaux sur ce beau récit, qui mérite sa place dans les classiques littéraires disponibles en français.
Dans le même genre, je ne connais pas grand-chose en littérature persane ou plus ou moins persane, hormis Les Mille et une nuits. En matière de bergers amoureux, il y a bien sûr les Bucoliques de Virgile et Daphnis et Chloé de Longus dans notre coin du monde, mais leurs amours restent assez sages par rapport à la folle passion de Medjnoûn. Dans le monde arabe, à une époque plus ancienne, j’avais lu il y a un bon moment L’épopée de Antar, dont G. Rougier a donné une édition aux éditions Bachari en 2006. Ça se lit bien, mais c’est une épopée plus qu’un roman d’amour pur, avec de nombreux épisodes guerriers (à base de razzias sur des troupeaux, un peu comme certains exploits de jeunesse de Nestor dans l’Iliade). Plus récemment, et dans un autre coin du monde encore, je ne peux pas ne pas penser à Devdas de Sarat Chandra Chatterjee, ce Roméo et Juliette d’Inde paru au début du XXe siècle, dont je parle dans un billet ici, et à ses multiples adaptations cinématographiques, dont celle de 2002 avec Ashwarya Rai et Sharukh Khan dans les rôles principaux. Il y a dans tout le cinéma amoureux bollywoodien un lyrisme achevé tout aussi amusant et rafraîchissant (à mes yeux) que dans ce Medjnoûn et Leïla. Dans les deux cas, ces histoires d’amour s’inscrivent dans des sociétés aux attentes très contraignantes, un peu comme les idylles des jeunes premiers de Molière dans la France pleine de mariages forcés du XVIIe siècle.




 Publié par Liber
Publié par Liber