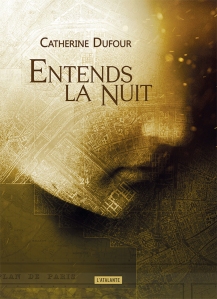
Référence : Catherine Dufour, Entends la nuit, Nantes, L’Atalante, 2018.
Quatrième de couverture de l’éditeur
« La chair et la pierre sont de vieilles compagnes. Depuis des millénaires, la chair modèle la pierre, la pierre abrite la chair. Elle prend la forme de ses désirs, protège ses nuits, célèbre ses dieux, accueille ses morts. Toute l’histoire de l’humanité est liée à la pierre.
Quand on a 25 ans, un master en communication, une mère à charge et un père aux abonnés absents, on ne fait pas la difficile quand un boulot se présente.
Myriame a été embauchée pour faire de la veille réseaux dans une entreprise du côté de Bercy, et elle découvre une organisation hiérarchique qui la fait grincer des dents : locaux délabrés, logiciel de surveillance installé sur les ordinateurs, supérieurs très supérieurs dans le style british vieille école.
Mais quand un de ces supérieurs s’intéresse à elle via Internet au point de lui obtenir un CDI et lui trouver un logement, elle accepte, semi-révoltée, semi-séduite…
Mauvaise idée ? Pas pire que le secret qu’elle porte.
Myriame est abonnée aux jeux dangereux dans tous les cas, et sa relation avec Duncan Algernon Vane-Tempest, comte d’Angus, décédé il y a un siècle et demi, est à sa mesure. Du moins le croit-elle.
Catherine Dufour, éprise de légendes urbaines, nous offre avec ce roman un « anti-Twilight » tout en humour et une ode à Paris bouleversante. »
Mon avis
J’avais découvert Catherine Dufour avec l’un de ses tout premiers romans du cycle de Blanche-Neige et les lance-missiles : de la fantasy humoristique, donc, parue au tout début des années 2000. J’avais dû grignoter le tout premier tome quand un ami l’avait lu, puis opter pour la préquelle L’Immortalité moins six minutes qui me laisse le souvenir d’un univers à l’humour cruel. Sauf que, depuis ce début (à l’époque remarqué : c’était l’une des rares qui arrivait à écrire de la fantasy humoristique vraiment drôle sans s’appeler Terry Pratchett), Catherine Dufour a bien mené sa barque, et cela dès son roman suivant, Le Goût de l’immortalité, couvert de prix et dont tant l’univers que le ton semblent tout différents. Je ne l’ai pas encore lu, pas plus que ses livres précédents. Ma mémoire étant ce qu’elle est, on peut aussi bien considérer qu’Entends la nuit est le premier roman de Dufour que je lis « vraiment », sous la superbe couverture d’Aurélien Police.
Ce qui saute aux yeux, mais qui est peut-être davantage caractéristique de cette écrivaine que de ce roman en particulier, c’est le style. Prenant, percutant, très imagé, jonglant avec les registres de langue sans hésiter à faire cohabiter des tournures orales relâchées ou une parodie de franglais avec une belle métaphore poétique dans des phrases voisines voire dans la même, le style de Dufour aligne les traits d’esprit, les pointes d’humour et les flèches émotionnelles avec la cadence frénétique et la puissance de feu d’un… eh bien, toujours d’un lance-missile, à vrai dire, mais il serait plus juste d’évoquer une écrivaine aguerrie qui sait poser sa « voix » propre et qui dispose de nombreuses cordes à son arc. Ça se voit très vite, ça dure tout le roman, on ne peut que le constater : voilà qui est fait. Il y a des perles, des trouvailles de langage géniales, des collisions de mots délicieuses, des images d’une belle poésie à certains endroits. Au passage, l’écriture de Dufour (du moins dans ce livre) emprunte beaucoup à la langue orale et travaille une langue française du quotidien très actuelle, aux antipodes du beau style académique d’un Jean-Philippe Jaworski, par exemple. Ce serait intéressant de la rapprocher d’écrivaines comme Virginie Despentes et son Vernon Subutex (que j’ai encore trop peu lu pour me livrer moi-même à cet exercice en détail). Leur parenté dépasse d’ailleurs le style puisqu’elle se dessine aussi dans le choix du sujet : époque actuelle, cadre urbain, évocation de la précarité et des inégalités sociales, la différence principale étant que Dufour utilise le miroir grimaçant de l’imaginaire pour commenter indirectement la France d’aujourd’hui. On pourrait aussi penser à Nothomb, mais cela fait trop longtemps que je n’ai plus lu cette dernière pour approfondir le rapprochement.
Le style, donc, est l’une des grandes forces du roman, mais peut constituer l’une de ses limites dès lors qu’on en vient à l’échelle du livre entier. Commençons à parler de l’intrigue : elle est ficelée, emballée et pesée très convenablement, en dépit de quelques défauts dont je parlerai plus loin, et les gens qui cherchent avant tout des romans rythmés où l’auteur actionne régulièrement les leviers de l’action, du mystère et du danger pour les rescotcher à leurs pages, pourront commencer Entends la nuit sans avoir trop de soucis à se faire. Cependant, adopter un style qui a lui-même des allures de course acrobatique sur des montagnes russes en vitesse accélérée peut finir par poser problème quand on ne relâche jamais la pression pour ménager des pages plus tranquilles et laisser souffler un peu les lecteurs ébouriffés. Or Dufour déploie une énergie constamment hypersaturée qui a fini par faire grogner le paresseux à trois doigts qui somnole en moi. À mon sens, il aurait fallu ménager quelques pauses, espacer de temps en temps les échanges de traits d’esprit au profit de variations plus sensibles dans les tonalités du style, qui m’a quelquefois fait l’effet de devenir paradoxalement monotone dans son intensité.
Passons à l’histoire proprement dite. La relecture a posteriori de la fin du quatrième de couverture m’enduit de doute : ce roman était-il censé n’être qu’un roman de fantasy urbaine humoristique ? C’est qu’à mes yeux il ne s’y résume pas, loin de là. Pour moi, Entends la nuit commence comme une satire sociale mordante sur le monde du travail, continue comme une romance fantastique teintée d’humour avant de se changer en un thriller qui montre au passage que Dufour est capable de faire très peur sans problème quand elle le veut (ou alors je suis bon public, n’étant pas un lecteur de romans d’horreur).
Hormis son style, le second grand atout du roman à mon sens est le choix de son élément surnaturel principal. C’est là que cela devient difficile de chroniquer le roman sans faire quelques révélations, donc, si vous n’avez pas lu ce livre et que vous ne voulez vraiment rien savoir du tout à l’avance, vous pouvez sauter ce paragraphe. Vous préférez continuer celui-ci ? Bien. Les personnages surnaturels du roman sont des lémures, librement inspirés des créatures de la mythologie romaine du même nom. Sans trop tout détailler à l’avance, il s’agit d’esprits de défunts liés à des lieux, mais qui se distinguent des simples fantômes par le fait qu’ils sont, matériellement, les lieux qu’ils hantent. Cela reste un thème classique du fantastique (abordé il n’y a pas si longtemps par des auteurs comme Mélanie Fazi ou Serge Lehman*), mais son traitement, porté par le style de Dufour, s’avère suffisamment original pour apporter du nouveau.
La première moitié du livre m’a paru la plus réussie, avec son entrelacement constant entre le quotidien le plus terre-à-terre, le fantastique, l’érotisme et la sexualité et un humour à plusieurs facettes qui sait tour à tour détendre l’atmosphère ou faire grincer des dents, avec une satire sociale féroce du monde du travail, un propos social sur le monde de l’immobilier et une héroïne à la psychologie complexe. Tout cela fait avancer le propos du livre sur plusieurs plans à la fois avec maestria et une subtilité que la suite abandonne, en partie par contrainte puisqu’il faut bien lever quelques mystères.
La seconde moitié, qui dépasse le cadre de la seule relation entre Myriame et Vane pour donner à voir le monde nocturne dont ce dernier fait partie, m’a paru multiplier les ficelles classiques de thriller (trahisons, course-poursuites, violence graphique) en affaiblissant ou en oubliant ce qui faisait à mes yeux l’originalité du début, à savoir la satire sociale et la complexité psychologique des êtres surnaturels dont Vane fait partie. Là encore, Dufour prend le parti de tout miser sur l’intensité (augmentation des enjeux, sexe, violence) mais, ce faisant, elle affaiblit l’originalité de ses personnages et court le danger du déjà-vu. Cela se lit toujours très bien, mais le résultat devient bien moins mémorable. Je m’attendais en outre à voir articulés plus finement la part de satire sociale du monde de l’immobilier et les éléments proprement fantastiques de l’histoire : finalement, en dehors de ses deux personnages principaux, Dufour se contente d’ébaucher assez vite un univers de méchants vraiment très méchants et très implacables, dont j’ai cru deviner qu’il pouvait faire allusion à des gens du monde réel (les requins de l’immobilier ? de la finance ? les riches ? tout ça à la fois ?), mais qui semble oublier, ou ne plus oser, s’articuler étroitement au monde réel. Les personnages se cantonnent à des archétypes déjà rebattus, les événements à des rebondissements traités avec une bonne maîtrise du suspense mais en somme banals. Quant au dénouement, il m’a semblé en queue de poisson. J’ai quitté le livre sur une mauvaise impression, frustré à l’idée que, sans ce virage « facile », le livre aurait pu accumuler une force de frappe beaucoup plus percutante vis-à-vis de ce qu’il semble vouloir dénoncer à certains moments (en particulier dans la scène où figure la citation de Baudelaire qui sert de titre au roman).
En dépit de mes différentes réserves, Entends la nuit reste un livre que je recommande à toute personne qui aime les romans au style mordant et au suspense haletant. Entre ses bonnes idées dans l’intrigue et les perles dont ses phrases regorgent, il contient assez d’éléments originaux et/ou réussis pour mériter l’attention de tous les amoureux et amoureuses de l’imaginaire francophone. Je compte bien, d’ailleurs, lire d’autres livres de Dufour, en espérant tomber un jour sur un chef-d’œuvre qu’elle est manifestement capable d’écrire et pas « seulement » sur un bon thriller fantastique doté d’éléments originaux et écrit par une plume hérissée. Mais, comme on dit, la critique est aisée et l’art est difficile…
* Vous voulez les titres ? « Villa Rosalie », nouvelle de Mélanie Fazi dans le recueil Notre-Dame aux écailles. « Le Haut-Lieu » de Serge Lehman, novella incluse dans son recueil Le Haut-lieu et autres espaces inhabitables.



 Publié par Liber
Publié par Liber 



