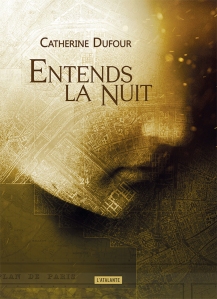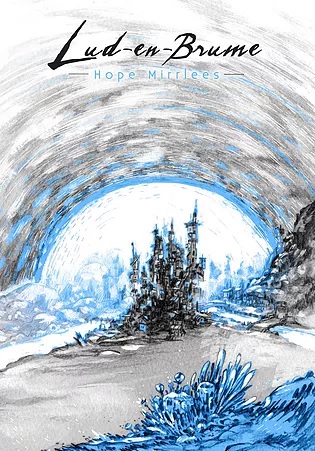Référence : Le Voyage du prince, film réalisé par Jean-François Laguionie, France/Luxembourg, 2019, 75 minutes.
L’histoire en deux mots
Un vieux singe, prince d’un pays faisant penser à l’Italie de la Renaissance en matière d’effervescence artistique et scientifique, s’est hasardé à traverser la mer à la faveur des glaces hivernales. Isolé par la débâcle, il a dérivé et s’échoue, inconscient, sur le rivage d’un pays inconnu. Recueilli par un jeune singe, Tom, il se réveille dans un pays étrange, à la technologie plus avancée que la sienne, peuplé de singes qui parlent une langue différente et qui le considèrent comme un être déroutant. À mesure qu’il se rétablit, le Prince découvre lui-même avec émerveillement la ville bâtie par ces singes. Mais lorsqu’il s’aperçoit que les habitants de ce pays s’imaginent qu’ils sont seuls au monde et que rien n’existe au-delà de la mer, son admiration laisse place à un sens critique d’autant plus caustique qu’il n’a plus rien à perdre.
Laguionie, un pilier de l’animation française
Le nom de Jean-François Laguionie est-il bien connu du grand public ? Il devrait : c’est l’un des réalisateurs français qui a conçu le plus de films d’animation, tous remarquables par leur beauté, leur originalité et la profondeur de leur propos. Les amoureux et les amoureuses du cinéma d’animation le connaissent depuis longtemps. Vous ne le connaissez pas encore ? Comme je l’aime beaucoup, je vais faire plusieurs billets en un et vous parler de tous ses films, ou du moins de tous ses longs-métrages.
Laguionie s’est fait remarquer, dès les années 1960 et 1970, par plusieurs courts-métrages novateurs, souvent primés, dont La Traversée de l’Atlantique à la rame en 1978. Il est passé au long-métrage en 1985 avec Gwen, le livre de sable, un récit de voyage mystérieux émaillé d’humour absurde : dans un pays imaginaire désertique, des entités inconnues déversent aléatoirement des tonnes d’objets semblables à des objets de la vie de tous les jours du milieu du XXe siècle. La jeune Gwen et la vieille Roseline entreprennent un long voyage pour percer les secrets de ces entités. Les dessins à la gouache, typiques de l’allure des premiers films de Laguionie, et l’animation façon papier découpé confèrent au film un rendu original, qu’on pourra trouver un peu raide, mais qui convient à merveille à l’atmosphère du récit.
En 1999, c’est Le Château des singes, sans doute le moins original des films de Laguionie en termes de graphismes, le seul où il fait effort pour lisser son univers visuel dans l’espoir de toucher un public plus large. Le résultat reste joli, surtout dans les décors à l’aquarelle qui posent la grande jungle où vit le peuple du héros, Kom. Précipité dans les profondeurs par une mauvais chute, Kom découvre le sol de la forêt et le peuple qui y vit : c’est l’occasion d’un conte humaniste qui parle de rencontre entre les cultures et d’éducation, mais avec beaucoup d’humour.
Laguionie revient en 2004 avec L’Île de Black Mór qui est le premier de lui que j’ai vu au cinéma. Prenez les romans de Dickens pour l’orphelin maltraité et les secrets de famille, mélangez avec L’Île au trésor pour les pirates et la chasse au trésor, ajoutez une touche de BD franco-belge pour l’humour et la fantaisie, étalez sur une toile à la façon du peintre Henri Rivière pour les traits bien marqués et les grands aplats de couleurs, confiez le tout à une équipe d’animation virtuose pour avoir de belles séquences de navires en mer, ajoutez une palette de voix juvéniles ou rocailleuses et terminez avec l’arrivée de Christophe Heral à la musique pour fournir un équivalent mélodique de la mer, des mouettes et de l’esprit d’aventure… et c’est prêt. C’est beau ! C’est classique comme tout au niveau des ficelles de l’histoire, mais c’est bien ficelé et c’est un excellent moyen de faire découvrir le genre des récits de pirates à un jeune public. Le mélange de piraterie, de roman familial et de fantastique léger me fait un peu penser aux bandes dessinées de Florence Magnin comme Mary la Noire ou L’Héritage d’Émilie, mais avec des graphismes plus clairs et aériens.
En 2011, c’est Le Tableau, mais comme l’année suivante j’ai créé ce blog, j’ai consacré à ce film un court billet que vous pouvez lire ici pour découvrir ce conte sur les personnages d’un tableau inachevé qui partent à la recherche de leur peintre afin de dépasser les inégalités sociales qui existent entre les Toupeints, les Pas-finis et les maigres croquis que sont les Ruffs.
Le précédent film en date de Laguionie, en 2016, est Louise en hiver, l’histoire d’une vieille dame qui se retrouve abandonnée seule dans une station balnéaire à la fin des beaux jours et doit survivre à la mauvaise saison sans aide. Voici un film qui revient un peu à l’esprit de « conte pour adultes » (au meilleur sens du terme) des courts-métrages du réalisateur : une dose de parabole philosophique, une dose de propos social, mais, ici, principalement l’histoire d’une vie dans un ordre résolument non chronologique, au hasard des souvenirs. Le sujet paraît réaliste et sérieux : il est traité avec fantaisie et humour, parfois avec onirisme. Mais un onirisme différent, plus inattendu : celui d’une robinsonnade en plein pays civilisé, dans une ville dont tout le monde est parti. En termes de structure narrative, on n’est pas loin de Souvenirs goutte à goutte d’Isao Takahata ou de Mari Iyagi de Lee Sung-gang, où les personnages, à la faveur de circonstances qui interrompent temporairement leurs habitudes, s’arrêtent et partent à la rencontre de leur passé. Tenez, le personnage et le lieu me rappellent un peu certaines scènes du jeu vidéo de Benoît Sokal Syberia (sorti en 2002) dont un chapitre se déroule dans un décor assez proche (mais plus tourmenté).
Et à l’issue de ce retour en arrière, je vais donc vous parler un peu du Voyage du prince.
Dans la lignée du Château des singes, mais en plus beau…
Le Voyage du prince se déroule dans le même univers de singes que Le Château des singes. Qu’on se rassure : il n’y a aucun besoin d’avoir vu le premier film pour apprécier le second, les deux histoires étant autonomes. Les gens qui se souviennent du Château des singes seront simplement heureux de reconnaître le personnage du Prince qui y apparaissait mais dont on se demandait ce qu’il avait pu devenir.
Ce qui frappe en premier dans Le Voyage du prince, c’est la voix off du narrateur, le Prince du titre. Le rôle des voix, des sons et de la musique est encore plus important dans un film d’animation que dans un film en prises de vue réelles – il est presque aussi crucial que dans une fiction radiophonique ou un livre audio – et Laguionie le sait très bien. La voix du Prince, la musique, les premiers bruitages, associés aux quelques premiers plans, suffisent à nous plonger dans l’univers bâti par le réalisateur et à nous y installer durablement. Les voix sont habilement choisies, les paysages sonores riches et la musique virtuose (Christophe Héral, qui a continué à travailler avec Laguionie pour Louise en hiver et Le Voyage du prince).
Le dessin, quant à lui, m’a frappé par sa finesse et sa beauté. Les dernières décennies ont vu l’épanouissement du cinéma d’animation français et européen, dont les réalisateurs, malgré des parcours du combattant toujours assez absurdes pour rassembler de petits budgets face aux rouleaux compresseurs des studios américains, ont tout de même un peu plus de moyens qu’avant. La technologie, en parallèle, a facilité bien des choses. Les graphismes du Voyage du Prince sont ainsi plus beaux et plus détaillés que ceux du Château des singes. Mais dans l’intervalle, Laguionie a aussi su imposer une « patte » visuelle mieux différenciée par rapport aux dessins animés à la Disney. Les singes n’ont rien de disneyen, ni rien de cartoonesque d’ailleurs, et beaucoup de personnages ont une allure sérieuse, et même hiératique dans le cas du Prince.
…pour une histoire distincte, à la Gulliver
Les débuts de l’histoire jouent beaucoup sur la différence entre le point de vue du personnage et les informations dont nous, public, disposons. Ainsi le Prince est-il frappé par la technologie très avancée du lieu où il se réveille, alors que nous reconnaissons sans peine dans les mystères qu’il évoque des technologies familières telles que la lampe électrique ou l’ascenseur dans un état qui nous fait penser au XIXe siècle européen. Les surprises, les malentendus et les tâtonnements d’une rencontre entre un voyageur et des hôtes issus d’un pays tout différent sont restitués avec justesse, humour et humanité. Cette distanciation est une façon toute simple mais très efficace à la fois pour donner vie aux personnages et à leur univers et pour nous donner à réfléchir. Le ton est donné : un conte qui interroge son public, sans brusquerie, mais comme en passant.
Outre la finesse du dessin dont j’ai déjà parlé, l’univers du Voyage du prince montre un grand talent dans l’évocation de lieux dotés d’une présence bien affirmée, qu’il s’agisse de la ville proprement dite avec ses façades Art Nouveau, ses boulevards brillamment éclairés à l’électricité et ses ruelles ombreuses, ou bien du Muséum abandonné qui sert de cachette au Prince et aux savants qui le recueillent, un endroit manifestement inspiré par le Muséum national d’histoire naturelle et le Jardin des plantes. La jungle, à son tour, offre une profusion de lignes et de couleurs, plus réaliste que les toiles expressionnistes de certaines scènes du Tableau mais toujours superbe à contempler. L’univers du film contient de belles trouvailles dans l’élaboration du monde des singes : sans ostentation et sans peine, Laguionie montre qu’il n’a rien à envier en matière de worldbuilding au dernier Pixar venu.
Très vite se met en place le tandem de personnages qui porte le film : l’amitié entre le vieux prince et le jeune Tom. C’est un type de tandem de personnages qui m’a paru original et que Laguionie semble aimer explorer régulièrement, puisqu’il formait déjà un élément important de Gwen, le livre de sable et que Laguionie avait abordé le thème de la vieillesse dans Louise en hiver. Les inconvénients de la vieillesse, la fatigue physique mais aussi un certain recul et un regard différent sur le monde, sont évoqués et joliment mis en contraste avec le point de vue de Tom. Ce choix bien pensé a en outre l’avantage de ne pas proposer, face aux problèmes que le film évoque, une « bonne » réaction qui serait celle du Héros avec une majuscule, mais deux regards distincts et parfois contradictoires. De cette façon, le film n’assène pas de réponse et nous laisse la liberté de conclure.
Ces choix m’ont plu car, assez rapidement, le film met en place un univers digne d’un conte philosophique. La ville bâtie par les singes rappelle les merveilles du Paris de la Belle Époque, mais elle possède aussi plusieurs travers qui constituent des allusions indirectes à nos sociétés de consommation actuelles, comme l’obsolescence programmée, le primat du divertissement, la dégradation de l’environnement et la violence sourde de l’indifférence à l’autre. Cela pourrait devenir assommant (un travers dans lequel d’autres réalisateurs tombent parfois en faisant des films trop brutalement « à message »), mais il n’en est rien : tout cela est esquissé sans insistance, presque discrètement. Les savants sont au pouvoir puisque la ville est gouvernée par une Académie, mais ils rejettent les découvertes trop innovantes, révélant l’obscurantisme qui conforte l’immobilisme social.
Cette subtilité bienvenue apparaît avec plus d’évidence dans le traitement des personnages. Les personnages principaux ne sont eux-mêmes pas parfaits : au sein du couple de savants qui a recueilli le Prince, le professeur Abervrach ne pense qu’à tirer profit du voyageur pour rédiger le rapport qui le réhabilitera au sein de l’Académie et lui permettra de retrouver le prestige social qu’il a perdu, tandis que son épouse et collaboratrice Élisabeth est rongée par sa méfiance envers l’étranger. Ses atermoiements, retracés avec une belle profondeur psychologique, en font un personnage secondaire marquant qui échappe à tout manichéisme.
On ne peut pas en dire autant du reste de la population de la ville des singes : plus le film avance, plus la société des singes révèle ses failles béantes et plus ses autres habitants deviennent les instruments d’une satire sociale. Et le Prince ? L’un des intérêts du film, qui en font une histoire réussie et absolument pas un film à message, réside dans le fait que les réactions du Prince ne sont pas cousues de fil blanc. Tout au long du film, le Prince est dépeint comme un vieil homme quelque peu cynique, à l’humour dévastateur, gonflé par une fierté certaine. Il a un côté « vieux désinhibé » dans ses rapports aux autres et, loin de prôner l’empathie par-dessus tout, il peut se montrer très « vache » à l’occasion. C’est aussi ce qui marque la différence entre Le Voyage du prince et son prédécesseur, Le Château des singes, qui, dans mon souvenir (lointain), ne donnait pas dans l’acidité. L’aventure racontée étant double puisque vécue simultanément par deux personnages, l’un jeune et l’autre vieux, le dénouement lui-même, avec la découverte finale faite par le Prince et Tom, est reçue très différemment par les deux personnages. Ce sont ces réactions qui m’ont beaucoup intéressé chez le Prince, plus imprévisible que Tom (classiquement jeune, curieux et idéaliste).
Sous cet angle, le Prince et son aventure m’ont fait penser aux Voyages de Gulliver de Swift, dont le héros toujours plus désabusé visite une succession de pays imaginaires dont les habitants inhumains (géants, lilliputiens, sauvages ou chevaux doués de parole) se croient tous parfaits en dépit de leurs défauts patents. La dernière partie du film me renforce dans cette comparaison : de toute évidence, le but n’est pas de proposer une utopie, mais de montrer des sociétés dont aucune n’est parfaite. Et pourtant le voyage ne débouche pas sur un repli sur soi : le Prince devient bel et bien un Ulysse.
Conclusion
Quand j’avais appris, il y a quelques années, que Laguionie préparait une suite au Château des singes, j’étais resté un peu sceptique. Le résultat dépasse mes attentes et réaffirme la grande virtuosité de Laguionie, à la fois comme créateur d’univers, comme animateur et comme conteur. C’est une grande chance de disposer, en France, de réalisateurs comme lui ou comme Michel Ocelot (Kirikou, Azur et Asmar, Les Contes de la nuit, Dilili à Paris), parvenus à un tel degré de maîtrise dans tous les domaines de la conception d’un film animé. Le Voyage du prince constitue une porte d’entrée de plus pour découvrir les univers de ce grand animateur, que l’ont soit jeune ou vieux.



 Publié par Liber
Publié par Liber