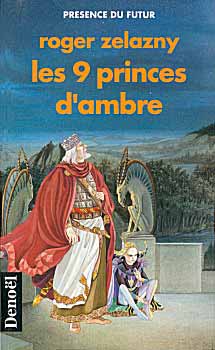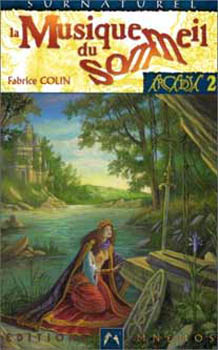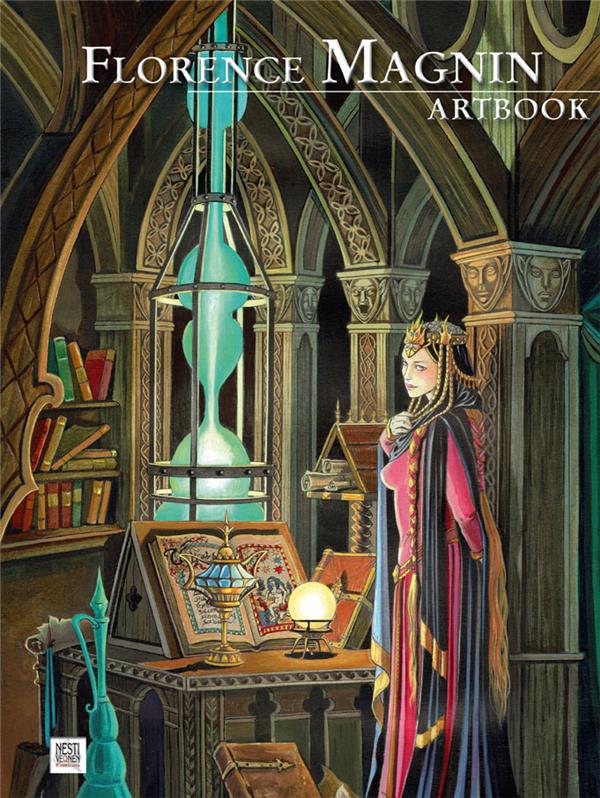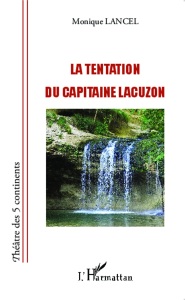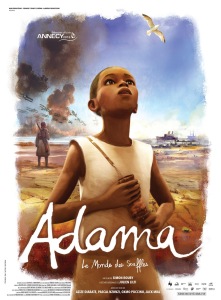Référence : Tehanetorens (Ray Fadden), Légendes iroquoises, traduit de l’anglais par Berthe Fouchier-Axelsen, avec des illustrations de John Kahionhes Fadden, Montréal (Québec), Alias, collection « Alias poche », 2020 (édition originale : Legends of the Iroquois, Book Club Co., 1998).
Quatrième de couverture de l’éditeur
« À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les Iroquois, anticipant leur totale disparition dans le grand courant nord-américain, se mirent à recueillir les récits de leur peuple. Mais avant que Ray Fadden commence son travail vers 1930, aucun véritable effort continu n’avait été fait pour connaître les légendes et les traditions iroquoises qui feraient comprendre aux jeunes générations les us et coutumes de leurs ancêtres. Le présent ouvrage offre une sélection significative des récits recueillis auprès de son peuple par Fadden dans les années 1930 et 1940. Il s’agit d’une merveilleuse occasion pour le lectorat contemporain de découvrir une riche partie de l’imaginaire de la nation iroquoienne.
Berthe Fouchier-Axelsen nous restitue ici ces légendes dans leur puissante simplicité, alors que Nadine N. Jennings, dans son avant-propos, les replace dans le contexte de l’époque en rappelant l’histoire de la Confédération iroquoise.
Le livre est magnifiquement illustré par John Kahionhes Fadden. »
Mon avis
Voici un petit livre qui m’a donné l’impression de rencontrer un peuple. En France, peu de gens ignorent le nom des Iroquois, qui comptent parmi les peuples nord-amérindiens les plus célèbres. Combien, cependant, ne les connaissent que par les images d’Epinal massivement diffusées par les westerns sous diverses formes, films, BD ou vieux romans d’aventure et mélangent allègrement les unes avec les autres les peuples des diverses régions des Etats-Unis et du Canada, Apaches, Cheyennes, Sioux et quelques autres, en laissant dans l’ombre une réalité infiniment plus riche et diverse ? Trop souvent, quand on s’intéresse au sort de ces Amérindiens, on évoque leur génocide par les colons européens (peut-être plus facilement de ce côté-ci de l’Atlantique), mais on oublie de préciser qu’une partie d’entre eux a survécu, de même que leur culture. Commémorer les morts en oubliant de mentionner les survivants, c’est enterrer ces derniers à l’avance, ce qui n’est pas beaucoup mieux.
Autant amateur de contes, de légendes et de mythes à l’âge adulte que je l’étais enfant, j’ai gardé l’habitude de découvrir peu à peu, par ce biais, des cultures des quatre coins du monde. C’est de cette manière que j’ai craqué pour ce recueil, à la Librairie du Québec, à Paris, où j’avais trouvé quelques mois plus tôt Kamik (Chasseur au harpon), de l’écrivain inuit Markoosie Patsauq, dont j’ai parlé dans un autre billet.
Ces Légendes iroquoises forment un recueil très court : 120 pages au format poche, écrit gros, avec des illustrations. Et pourtant ! Dans ces pages, on trouve tout ce qu’il faut pour découvrir non seulement les légendes iroquoises, mais aussi l’histoire et la culture de ce peuple et de ses six tribus, ainsi que l’auteur, Tehanetorens (Ray Fadden de son nom canadien), figure majeure de la préservation et de la transmission de la culture iroquoise.
Qu’on en juge. Après une brève préface à l’édition française par l’illustrateur (le livre est d’abord paru en anglais en 1998) vient un avant-propos de Nadine N. Jennings, docteure en études anglaises et professeure adjointe au Suny Canton College of Technology, dans l’Etat de New York. En trois ou quatre pages, Jennings présente l’histoire et la culture des Iroquois, qui se nomment eux-mêmes les Haudenosaunee, Ceux de la maison longue, du nom des bâtiments où ils vivent et dont elle présente l’organisation matérielle et politique, marquée par l’union de cinq tribus (auxquelles se joint une sixième en 1715) à l’instigation du pacificateur Dekanawidah. Elle évoque brièvement le système d’écriture iroquois, les pictogrammes, que le chapitre suivant, « Clefs pour les pictogrammes des Six-Nations », présente plus en détail, de leurs conditions matérielles d’écriture (par exemple directement sur les arbres, ou sur des objets d’écorce, ou encore sur les ceintures appelées « wampums ») jusqu’à leur sens et leur symbolique. Claire, concis, ce passionnant chapitre ainsi que les deux suivants (« Symboles des Six-Nations » et « Les clans des Six-Nations ») sont illustrés de nombreux exemples de pictogrammes avec l’histoire de leur reconstitution.
Un poème en prose est placé en tête des légendes : « La conservation de la nature telle que l’Indien la voyait ». D’une actualité brûlante, il met en avant les dégâts causés par la colonisation européenne aux écosystèmes de l’Amérique du Nord et la nécessité pour « l’homme blanc » de renoncer à l’avidité et au gaspillage dénoncés par le Grand Esprit, afin de changer de mode de vie pour préserver la vie autour de lui. Un second texte en prose poétique, « Souvenirs », clôt le volume et répond au premier, puisque les souvenirs qu’il évoque de manière vivace montrent une attention constante portée aux paysages, aux arbres et aux animaux autres que les humains.
Commencent alors les légendes à proprement parler. La plupart sont à vocation étiologique, c’est-à-dire qu’elles expliquent l’apparition d’une réalité qui existe toujours aujourd’hui : la médecine (« Le don du Grand Esprit »), la maîtrise du feu (« Une tradition : la découverte du feu »), l’invention de l’arc (« L’invention de l’arc et de la flèche »), l’origine d’une constellation (« L’histoire de la Grande Ourse », « Les sept danseurs ») et même l’apparition des moustiques actuels (« Pourquoi nous avons des moustiques »). Les premières légendes montrent également des divinités apparemment centrales dans la culture iroquoise, comme le Sat-kon-se-ri-io, aussi appelé le Grand Esprit, et l’Enfant-tonnerre (dont la légende du même nom relate la naissance et le destin), ou encore l’ancêtre des Iroquois (« Sa-go-ia-na-wa-sai, notre aïeul »).
Les autres légendes donnent une large place aux récits de chasse surnaturelle, un quotidien âpre où les humains n’ont pas toujours le dessus sur les animaux ou créatures rencontrées. Ainsi, dans « La tête volante », un malheureux chasseur tombe sur une entité apparemment invulnérable. Plusieurs récits mettent en oeuvre le motif du changement de taille, et il est difficile de ne pas penser à Alice au pays des merveilles ou aux Voyages de Gulliver en les lisant (tout particulièrement dans « La bête féroce »). D’autres récits mettent en scène des animaux locaux, lors de rencontres rares et privilégiées avec des humains (« La danse des lapins ») ou dans leur vie entre bêtes (« Le chant de la grive solitaire »).
Ces récits sont courts, voire très courts (certains dépassent à peine deux pages), et illustrés par John Fadden, dont les crayonnés soignés, détaillés et très évocateurs contribuent pleinement à nous immerger dans l’univers de ces légendes en donnant à voir l’apparence des personnages et des créatures, les vêtements, les coiffures, l’équipement des chasseurs.
Le chapitre final, d’une quinzaine de pages, est consacré à la vie et à l’oeuvre de l’auteur, Tehanetorens, Ray Fadden de son nom d’état civil fédéral. Durant un XXe siècle qui voit les Iroquois en butte à des Etats déterminés à les « civiliser » (comprendre : à faire disparaître leur culture dans une éducation uniquement « états-unienne »), Tehanetorens entreprend, avec une persévérance remarquable et salutaire, de recueillir, de préserver et de transmettre la culture iroquoise. Il poursuit cette tâche dans les années 1930-1940 et jusqu’à sa mort (survenue en 2008, selon sa notice sur le catalogue de la Bibliothèque nationale de France).
Deux choses m’ont frappé à la lecture. La première est la persistance d’une logique de génocide du peuple iroquois et d’effacement délibéré et systématique de la culture iroquoise de la part des Etats à des époques très récentes, bien après la Deuxième guerre mondiale. Ce sont des crimes qu’il faut faire connaître, faire reconnaître aux Etats, et pour lesquels il faut rendre justice aux Iroquois et aux autres peuples concernés, si nous voulons définitivement tourner la page de la colonisation et entrer pleinement dans une ère démocratique.
La deuxième chose qui m’a frappé est la manière privilégiée par Tehanetorens pour sauver la culture iroquoise. Des folkloristes européens se seraient contentés de tout recueillir par écrit, dans des recueils de contes, des lexiques et des grammaires de langues menacées de disparition, comme cela s’est beaucoup fait en Europe et en France, dans nos régions, aux XIXe et XXe siècles. Tehanetorens, lui, ne semble pas avoir publié beaucoup de livres. Il a privilégié la mise en place d’une organisation (l’Akwesasne Mohawk Counselor Organization) et de structures vivantes, propres à organiser une transmission du savoir entre les générations, par la mise en contact des jeunes avec leurs aînés et des tribus entre elles. Ainsi son travail a donné naissance au Musée amérindien des Six-Nations (Six Nations Indian Museum), à Onchiota, en 1954, et ses écrits les plus nombreux ne sont pas des livres mais du matériel pédagogique, livrets, cartes, fresques murales. Cela s’explique en partie par l’urgence, à l’époque, de résister à la politique de scolarisation et d’éducation forcée « à l’américaine » que le gouvernement de New York tente d’imposer avant de renoncer devant la résistance de la population iroquoise.
Sans l’action de gens comme Tehanetorens, les jeunes Iroquois, séparés de leurs parents, auraient été entièrement élevés dans la culture dominante des colons et n’auraient jamais eu accès à leur culture natale, qui aurait entièrement disparu. Au lieu de cela, cette culture a survécu et reprend doucement du poil de la bête. Mais l’attitude des gouvernements successifs, tant au Canada qu’aux Etats-Unis, demeure changeante et trop ambiguë, marquée par un déni persistant. A ceux qui trouvent à redire aux études décoloniales, et qui prétendent que ce type de démarche revient à remuer inutilement ce qui ne serait que de mauvais souvenirs bien révolus aujourd’hui, il est important de faire comprendre que la colonisation n’est pas terminée. Elle ne le sera pas tant que les Amérindiens ne seront pas traités sur un pied d’égalité avec les autres citoyens et citoyennes des pays où ils vivent.
Conclusion
Ces Légendes iroquoises sont une merveille à lire et à regarder. Les légendes, avec leurs textes courts, limpides et illustrés, sont accessibles à un très jeune public, de même que les poèmes et la présentation de l’écriture pictographique. Les uns comme les autres feraient de belles ressources pédagogiques pour faire découvrir la culture iroquoise au-delà des clichés des westerns, où qu’on se trouve dans le monde. Les préfaces et la notice consacrée à Tehanetorens, quant à elles, semblent davantage destinées à un lectorat adulte et constituent une mine d’informations sur l’histoire et les luttes des Iroquois. Elles m’ont rendu extrêmement curieux d’en apprendre davantage sur ces sujets.
Dans le même genre, je peux vous conseiller plusieurs autres livres. Il y a quelques années, j’avais été marqué par la lecture du Fripon divin de C. G. Jung, C. Kerényi et P. Radin, consacré aux mythes des Winnebagos, autre peuple d’Amérique du Nord. Ces mythes, déroutants et réjouissants, valent la lecture. Les interprétations proposées dans le même ouvrage ont plus ou moins bien vieilli. J’en parle en détail dans ce billet.
William Camus, autre écrivain iroquois (son nom iroquois est Ka-Be-Mub-Be), a publié plusieurs recueils de contes amérindiens recueillis et traduits par lui (ainsi que d’autres livres variés, notamment des romans de science-fiction). Le seul que j’ai lu pour l’instant est Légendes de la Vieille-Amérique, paru chez Bordas en 1979 et réédité en 1996 chez Pocket junior dans la collection « Mythologies ». J’ignore s’il est encore disponible en neuf, mais il doit pouvoir se trouver d’occasion. Le recueil rassemble des contes et légendes de peuples amérindiens très variés : Menomini, Navajo, Oglala, Cheyenne, Zuni, Hopi, Chippeway, Wishita, Athabaska, Kato, Fox et Iroquois, ces derniers étant représentés par le conte « Le vieillard atteint de toutes les maladies », qui est une autre version de la légende de l’invention de la médecine relatée sous le titre « Le don du Grand Esprit » dans Légendes iroquoises. Ces Légendes de la Vieille-Amérique sont un trésor qui mérite amplement une réédition.
Sur les Premières Nations au sens plus large, je ne peux que vous conseiller (je n’ose dire « chaudement ») le récit Kamik, plus connu sous le titre Chasseur au harpon, de l’écrivain inuit Markoosie Patsauq, dont je parlais il y a quelques semaines dans cet autre billet.
Parmi les écrivains de culture amérindienne encore actifs aujourd’hui, j’ai entendu parler de l’écrivaine et musicienne Joy Harjo, américaine et creek, couronnée en 2019 « Poet Laureate » (poétesse lauréate), la plus haute distinction que puisse recevoir un poète dans le monde anglo-saxon. Son autobiographie poétique, Crazy Brave, relate son enfance et son parcours et le peu que j’en ai grignoté est plus que prometteur.
Je n’ai pas encore lu d’ouvrages d’histoire ou d’anthropologie consacrés aux Amérindiens, mais cette lecture m’a donné envie d’en lire.





 Publié par Liber
Publié par Liber