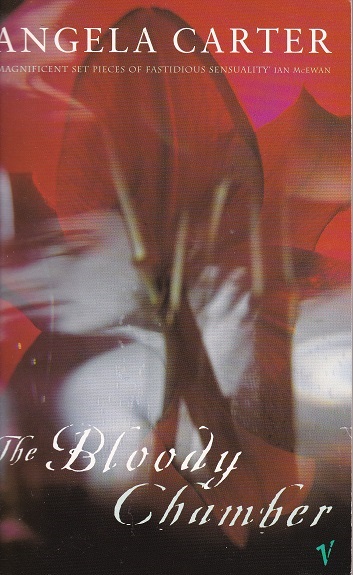Référence : Jen Wang (texte d’après la nouvelle Anda’s Game de Cory Doctorow, dessin et couleur), IRL. Dans la vraie vie, Talence, Akiléos, 2015, 192 pages (première édition : In Real Life, New York, First Second Books, 2014).
Quatrième de couverture de l’éditeur
« Anda aime Coarsegold Online, le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur sur lequel elle passe le plus clair de son temps libre. C’est un endroit où elle peut être un leader, une combattante, une héroïne. Un endroit où elle peut rencontrer des gens du monde entier et se faire des amis. Mais tout se complique le jour où Anda se lie d’amitié avec un Gold Farmer, un enfant chinois pauvre dont l’avatar recueil[le] illégalement dans le jeu des objets de valeur pour les revendre aux joueurs des pays développés. Ce comportement va à l’encontre des règles de Coarsegold, mais Anda réalise rapidement que les questions de bien et de mal sont beaucoup moins simples quand la vie d’une personne réelle est en jeu. »
Mon avis
Ayant adoré Le Prince et la Couturière de la même auteure (j’ai vu avec plaisir que l’album avait obtenu un Fauve d’or à Angoulême fin janvier), j’ai lu avec beaucoup de curiosité IRL. Dans la vraie vie, dont l’histoire est assez différente. L’intrigue s’inspire d’une nouvelle ou courte novella, Anda’s Game, publiée le 15 novembre 2004 dans le magazine Salon par l’écrivain canado-britannique Cory Doctorow et reprise depuis dans plusieurs anthologies (vous pouvez trouver plus de détails sur la fiche de la nouvelle sur l’Internet Speculative Fiction Database ; en revanche, je n’en connais pas de traduction française). À cette histoire, Jen Wang apporte son talent de scénariste et de dessinatrice. On y trouve le trait rond, les visages expressifs et la mise en page très dynamique qu’elle a déployé par la suite dans Le Prince et la Couturière, mais avec deux types de décors bien distincts : le quotidien d’Anda (le collège, la maison familiale, les cybercafés) et l’environnement virtuel de Coarsegold Online (dont Jen Wang invente l’interface graphique et l’univers de fantasy).
Dès la préface, l’album développe un propos engagé : il s’agit de parler de jeux vidéo… et d’économie. On comprend vite en entamant la lecture de la BD proprement dite. De jeu vidéo, il en est question tout de suite, mais du point de vue de jeunes filles. Anda et ses camarades sont des joueuses passionnées de jeux vidéo, mais elles sont habituées à n’incarner que des personnages masculins par peur des réactions sexistes qu’entraînent invariablement les personnages féminins de la part des joueurs. Tout commence quand une représentante de la guilde des Farenheits, un groupe exclusivement composé de joueuses, vient recruter plusieurs collégiennes pour les encourager à s’enhardir en ligne (… et leur vendre des abonnements à un jeu dont on apprend par la suite qu’il lui rapporte de l’argent). Ainsi, d’emblée, la BD s’inscrit dans les problèmes de société actuels, avec netteté mais sans prendre de gros sabots. Anda se porte volontaire et on repasse à des problèmes typiquement adolescents : la négociation avec sa mère pour se faire offrir l’abonnement, l’inscription, la socialisation en ligne, l’envie de faire ses preuves auprès des autres.
L’économie des jeux vidéo est loin de se résumer au paiement du jeu : pour nombre d’entre eux, et notamment les jeux vidéo de rôle massivement multijoueurs en ligne (les MMORPG) dont s’inspire Coarsegold Online, elle comprend l’usage de tout un tas de fonctionnalités payantes optionnelles, mais qui procurent vite des avantages aux joueurs les plus riches. À cela s’ajoute la pratique du farming (« culture » ou « exploitation en ferme », du verbe to farm signifiant « cultiver dans une ferme »). C’est une pratique d’optimisation d’un personnage qui relève pratiquement de la triche, puisqu’elle consiste à répéter la même action un grand nombre de fois dans le jeu à seule fin d’accumuler, selon les cas, des points d’expérience, des pièces d’or, etc. qui permettent au joueur de rendre son personnage plus puissant à coups de montées de niveau rapides. C’est cette pratique qu’Anda va découvrir dans Coarsegold Online.
L’équipe de supervision du jeu offre en effet de rémunérer des joueuses pour éliminer les personnages qui s’adonnent au farming. « Gagner de l’argent de poche supplémentaire en jouant ? Cool ! » se dit Anda, comme sans doute beaucoup d’ados le penseraient à sa place. Et de massacrer des personnages sans complexe… au début. Un jour, elle noue contact avec un de ces personnages et se rend compte qu’il est lui-même payé pour faire du farming pour le compte de joueurs riches. Sauf que lui ne gagne pas d’argent de poche : il gagne sa vie tout court. Autrement dit, ce qui n’est qu’un loisir pour la jeune fille aisée qu’est Anda forme le travail quotidien de ce joueur, non pas un ado mais un enfant, contraint de jouer des dizaines d’heures par semaine, au point qu’il en a mal au dos comme un vieillard.
En dépit du caractère fictif des personnages et du jeu vidéo Coarsegold Online, l’intrigue est très réaliste, puisqu’elle évoque des technologies et des situations très actuelles, du sexisme aux inégalités de richesse entretenues par l’économie des jeux vidéo, bien qu’on ne soit pas en reste de fantasy grâce aux scènes qui se déroulent dans l’univers du jeu. Derrière Coarsegold Online, on peut aisément reconnaître les classiques du MMORPG comme World of WarCraft. À vrai dire, en d’autres temps, le sujet n’aurait pas déplu à un Zola (le quotidien des farmers penchés sur leur écrans et devant tenir des cadences infernales n’est pas loin d’un véritable Germinal du virtuel) ou à un Maupassant, voire un peu avant, à un Voltaire (on aurait pu écrire : « C’est à ce prix que vous avez des XP en Europe »…). Il est abordé ici avec ce qui semble au prime abord être de la légèreté – un récit de formation coloré et optimiste d’une adolescente au départ un peu timide et embarrassée d’elle-même – mais qui devient vite sérieux à mesure qu’Anda découvre la réalité sordide qui se cache derrière les fonctionnalités payantes de Coarsegold Online et la pratique du farming. L’optimisme demeure, mais il se fait plus exigeant : dès lors qu’Anda veut rester intègre, elle prend conscience qu’elle doit essayer de changer les choses de son mieux… et que c’est loin d’être facile.
Bien ficelée, l’histoire développe un propos engagé et nuancé à la fois. Anda va de découverte en déconvenue, se trouve peu à peu en rupture vis-à-vis des Farenheits, de sa mère, voire de l’enfant qu’elle prétend aider, mais, loin de se désespérer, elle réagit, s’indigne, se documente, met en place des moyens d’agir… dans la vraie vie, puisque l’enjeu réel est là, même quand on joue à un jeu vidéo. IRL nous rappelle ainsi utilement l’ampleur des enjeux qui se cachent dans les coulisses de l’industrie du divertissement.
Que trouver à dire au chapitre des défauts ? Les esprits pessimistes pourraient reprocher à l’album son dénouement, les adeptes de l’originalité à tout crin y reconnaîtront des ficelles classiques, et les esprits chagrins jugeront peut-être la mise en page un peu trop aérée… Ce serait oublier que le but de l’album ne réside visiblement pas dans l’invention d’un parcours original, mais au contraire dans l’évocation d’une histoire réaliste, partant du quotidien d’un personnage comme vous et moi auquel on s’identifie aisément, et qui nous emmène sans aucune difficulté jusqu’à des questions d’économie dont on ne soupçonnait parfois pas même l’existence avant d’ouvrir l’album. Qu’on adhère ou non à l’optimisme de son propos, on ne peut que saluer l’habileté et le dynamisme avec lesquels l’album traite, avec clarté et subtilité, toute une palette de thèmes, de l’adolescence à l’économie et à la lutte pour les droits sociaux en passant par le sexisme, l’amitié en ligne ou les différentes formes de lutte et d’héroïsme – le tout dans une histoire que j’ai trouvée plaisante, accessible et vraisemblable. Une réussite à mes yeux, qui me confirme dans l’idée que Jen Wang est une auteure à suivre.



 Publié par Liber
Publié par Liber