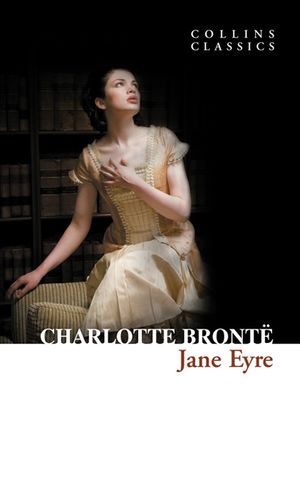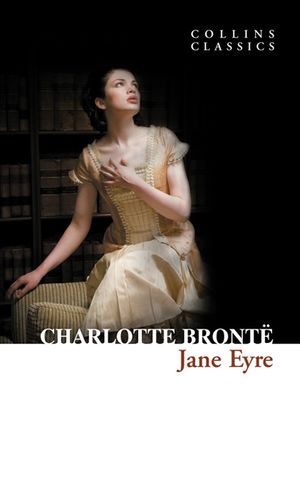
Référence : Charlotte Brontë, Jane Eyre, Londres, Harper Collins, collection « Collins Classics », 2010 (première édition : Londres, Smith, Elder & Co., 1847).
Quatrième de couverture de l’éditeur (traduit par mes soins)
« Je ne suis nullement un oiseau ; et aucun filet ne me prend ; je suis un être humain libre à la volonté indépendante.
Le fameux roman de Brontë raconte l’histoire de l’orpheline Jane, enfant née dans des circonstances malheureuses. Élevée et maltraitée par sa tante et ses cousins, finalement envoyée dans une pension lointaine et cruelle, ce n’est que lorsque Jane devient gouvernante à Thornfield qu’elle trouve le bonheur. Humble et mesurée, mais déterminée, Jane tombe bientôt amoureuse de son maître sombre et orageux, M. Rochester, mais avant peu des événements étranges et perturbants surviennent au manoir… » (J’omets le dernier morceau de phrase qui en dit trop à mon goût.)
Mon avis
Où l’on dit quelques mots sur le texte anglais et l’édition Collins Classics
Des sœurs Brontë, j’avais lu l’an dernier Wuthering Heights (Les Hauts de Hurlevent) d’Emily Brontë, roman magnifique et terrible dont la puissance et la noirceur m’ont marqué et que j’ai eu le plaisir de vous présenter en détail ici. Mais je n’avais jamais lu Jane Eyre, écrit par Charlotte Brontë et paru la même année (quelle année !). Je n’en connaissais que des adaptations en films ou téléfilms vues il y a longtemps et qui ne m’avaient laissé que de beaux paysages, de beaux costumes, une atmosphère de secrets dans la campagne anglaise et l’image d’une vieille femme folle. C’est toujours une bonne introduction, mais, comme tout lecteur qui apprécie le romantisme, le fantastique et la littérature anglaise, il fallait tôt ou tard lire le livre.
Ayant atteint un assez bon niveau d’anglais pour cela grâce à mes études, je l’ai lu dans le texte original. Autant prévenir les internautes qui seraient encore mal à l’aise avec la langue des Brontë : Jane Eyre est un pavé et sa prose dix-neuviémiste réserve bien des difficultés à qui ne disposerait pas déjà d’une solide connaissance de la langue anglaise et d’un vaste vocabulaire. Il comprend toutefois moins de tournures dialectales que Wuthering Heights où les répliques du serviteur Joseph sont à réserver aux anglicistes chevronnés.
J’ai lu Jane Eyre dans la collection Collins Classics, que j’ai choisie pour son petit prix et surtout son petit format, équivalent au format poche français, malheureusement trop rare outre-Manche. Il n’y a pourtant rien de plus pratique que de pouvoir trimballer son livre partout avec soi. En contrepartie, la Collins Classics propose très peu d’annexes : le volume commence par deux pages sur… l’éditeur, puis deux sur les vies et les œuvres des sœurs Brontë. Et c’est tout… du moins je le croyais, jusqu’à ce que je termine le roman et que je tombe sur un solide lexique d’une trentaine de pages expliquant les mots anciens ou rares ! Sa présence était indiquée par le quatrième de couverture, mais à demi masquée par l’étiquette du prix, ce qui fait que je ne l’avais pas vue. J’avais pris le parti de m’en sortir tout seul, mais il m’aurait été bien utile pour quelques mots. Au passage, à l’ère de l’omniprésence téléphonique, il n’y a rien de plus facile que de consulter Internet ou une application quelconque sur un ordiphone pour dégoter un vocable inconnu.
Où le blogueur se demande (encore) ce qui fait qu’on se plonge si confortablement dans la lecture d’un bon gros roman
Jane Eyre, donc, est un pavé : 460 pages bien comptées en format poche. Autant dire un microcosme où l’on se plonge pour un bon moment et dont on suit le personnage principal pendant de longues années, de l’enfance (qui forme les premiers chapitres) jusqu’à l’âge mûr (celui de Jane Eyre narratrice, qui nous relate sa jeunesse avec la distance critique et l’expérience de l’âge qu’elle a acquises). Un livre dont le titre n’est autre que le nom de son personnage principal et de son narrateur : quoi de plus classique, de plus typique, même, pour un roman ? Et en effet tout tourne autour de Jane Eyre, ses débuts dans la vie, son éducation, son parcours dans la société, son élévation morale et spirituelle, sa vision du monde profondément modelée par le contexte chrétien où elle grandit, et la lutte intime que se livrent en elle son rigoureux sens du devoir et les passions qui l’agitent.
Là où Wuthering Heights est un roman familial, une intrigue collective qui adopte une structure assez complexe, fait alterner les points de vue de plusieurs personnages et joue des mystères des uns et des autres, Jane Eyre se cantonne à une structure des plus classiques : une narration linéaire, à peine dotée d’un récit-cadre implicite par le truchement discret du personnage âgé qui relate sa jeunesse. On ne quitte jamais Jane Eyre, on sait tout d’elle et on ne peut apprendre des autres que ce qu’elle veut bien découvrir. Quoique classique, ce mode de narration présente l’avantage d’épouser de près l’expérience que tout un chacun, vous ou moi, pouvons avoir de notre vie en tant qu’individus, tout en restant plus accessible que les somptueuses mais parfois intimidantes expériences littéraires menées plus récemment sur le « courant de la conscience », le stream of consciousness (mais il faut les lire aussi !). Lu de nos jours, dans un début de XXIe siècle avide de récits collectifs où les romanciers et les scénaristes de séries ont tendance à multiplier les personnages jusqu’au vertige, c’est bon de se retrouver de temps en temps embarqué auprès d’un seul personnage et de ne voir le monde que par ses sens et ses pensées pour quelques centaines de pages.
Est-ce cette simplicité d’abord, ou le caractère du personnage, ou plus généralement la plume de Charlotte Brontë ? Toujours est-il que j’ai d’emblée été captivée par Jane Eyre et que je me suis régalé de bout en bout. À vrai dire, je vois plusieurs autres raisons à cette puissance de séduction du récit. Le roman de formation qui commence avec l’enfance en est une : le début de Jane Eyre nous fait voir le monde par les yeux d’une petite fille, avec des passages d’une remarquable finesse dans l’évocation de l’enfance, de ses pensées, de ses rêves, de ses craintes, et en particulier de l’incapacité des enfants à restituer avec des mots la richesse de tout ce qu’ils savent percevoir à l’extérieur et ressentir en eux, mais pas encore exprimer.
Autre explication à la puissance séductrice de ce roman : la conjonction de fréquents huis clos dans des intérieurs bien meublés et de la mauvaise saison dans la campagne anglaise. Jane Eyre ne tient pas entièrement du roman gothique, loin de là, mais en reprend plusieurs tropes, dont l’archicélèbre « dark and stormy night« , auquel se joint très souvent le plaisir de se calfeutrer dans un intérieur confortable pendant que la tempête fait rage au dehors, le suave mari magno (« Qu’il est doux, quand la mer est déchaînée… ») de Lucrèce dans son traité De Rerum Natura . Je force un peu le trait : en réalité, au début du livre, Jane est enfermée bien contre son gré et profite assez peu du confort de la maison – elle ne demanderait qu’à pouvoir s’enfuir pour courir librement sous les lourds nuages, parmi les herbes hautes ! Mais lire les premières pages, imaginer cet intérieur anglais ancien et l’hiver au dehors, quand le hasard fait qu’on commence à lire Jane Eyre en automne, est un bon moyen de se laisser emporter encore plus sûrement par l’histoire.
Cerise sur le gâteau : pendant les premières pages de Jane Eyre, la jeune Jane Eyre s’occupe à… lire ! En analyse littéraire, on vous bondirait aussitôt dessus avec du métapoétique et de l’autotélique. Ici, je me contenterai de dire que cela fait jouer encore plus à fond l’identification entre le lecteur et le personnage.
Où l’on a la révélation que Jane Eyre n’est pas le même livre que Wuthering Heights
En commençant ma lecture, j’imaginais Jane Eyre comme un roman d’amour moins dur et agressif que Wuthering Heights, et moins tourné vers le fantastique ; je craignais quelque chose d’un peu mièvre par endroits. J’ai pu constater que Jane Eyre est, effectivement, beaucoup moins rude que le roman d’Emily Brontë. Et que la part du fantastique (au sens fort du mot) y est réduite à un unique rebondissement décisif, bien qu’il soit présent de manière plus subtile et diffuse tout au long du livre, sous forme d’éléments descriptifs, de comparaisons placées dans les pensées ou les paroles des personnages, ou encore de croyances, de rêves ou de peurs. Souvent il est avancé sur le mode du trait d’esprit (par Rochester) ou de la ruse (comme la scène de la diseuse de bonne aventure qui, en somme, pourrait venir d’un Tintin). Mais à d’autres endroits, des péripéties techniquement réalistes sont présentées d’une manière assez dramatique pour faire venir en tête le fantastique, et, ici ou là, on trouve, semés avec une savante discrétion, des mots directement venus du roman gothique ou fantastique, comme « esprit » ou « goule » ou « vampire ». Il n’y a pas de goule ou de vampire dans le roman, je le dis pour ne pas faire de déçus ; mais le fantastique, lui, est là, ou plutôt ce qu’on appellerait de nos jours « du frisson », au sens d’une forme plus légère du fantastique.
Jane Eyre apparaît, à bien des égards, plus posé, plus civilisé et bien moins directement subversif que Wuthering Heights à l’égard des conventions de son époque. Mais s’il parle d’amour, avec quelques scènes romantiques au sens le plus cliché du mot (superbement amenées et maîtrisées), on ne saurait le cantonner à cet aspect : il parle beaucoup d’indépendance féminine, d’ascension sociale, de morale et de religion. Mes souvenirs des films ou téléfilms qui en étaient adaptés se résumaient largement à la relation entre Jane et Rochester : c’est une vision très réductrice du roman. On y rencontre en réalité plusieurs autres personnages, d’autant plus fortement campés que le roman, en dépit de sa longueur, tourne autour d’un assez petit nombre de protagonistes qui réapparaissent en général plusieurs fois. Si Jane et Rochester forment les deux figures centrales, le tableau demeure plus vaste et complexe.
Où le blogueur part dans une analyse beaucoup trop longue du thème de la religion dans Jane Eyre, tout en parlant vaguement du reste de l’intrigue
Ainsi, la religion occupe une part fondamentale dans Jane Eyre et plusieurs personnages en donnent des visions variées, souvent sévères. Au cours des premiers chapitres, à Gateshead Hall, Jane Eyre reçoit une éducation autoritaire et injuste de la part de sa tante, qui ferme les yeux sur le harcèlement qu’exercent ses enfants biologiques sur cette petite fille pauvre et adoptée qu’elle méprise et dont elle accueille les révoltes comme autant de preuves d’un caractère pratiquement démoniaque. Par la suite, le pensionnat religieux de Lowood (low wood, la forêt basse, celle de l’ambiguïté morale, peut-être ?) oppose deux figures d’autorité : M. Brockehurst, fortement associé à une dévotion hypocrite d’homme riche qui n’applique ses préceptes d’éducation austère qu’aux enfants des autres, et Miss Temple, qui, bien que moins fréquemment associé aux lectures bibliques et aux prières, fait figure d’incarnation de la charité chrétienne, une sorte de Vierge, pour ne pas dire de… temple, près de laquelle les jeunes filles se réfugient pour retrouver les meilleurs aspects du christianisme, bonté, charité et recherche de la vraie justice. Impossible d’oublier la première grande amitié que lie Jane Eyre à Lowood : Helen Burns, figure mystique dont le nom de famille est lui aussi éloquent.
L’évolution morale de Jane Eyre réserve des surprises aux gens du XXIe siècle qui pourraient s’attendre à ce que sa révolte contre l’éducation affreusement stricte et injuste qui lui est donnée gagne en ampleur au fil du roman. Les chose se révèlent beaucoup plus nuancées, et d’autant plus intéressantes, au moins en termes de vraisemblance psychologique et sociale. Car Jane Eyre, loin de fuir l’horrible endroit qu’est Lowood, va finir par y rester volontairement (il faut dire que le pensionnat change lui-même du tout au tout dans l’intervalle), et offre par la suite l’image d’une jeune femme aussi calme, réservée et docile qu’elle s’était montrée passionnée et rebelle pendant son enfance. Jane Eyre a-t-elle accepté les préceptes dont on lui a martelé le crâne ? A-t-elle entièrement cédé à cette éducation rigoriste qu’elle a subi à Gateshead puis à Lowood ? Non, et toute la suite montre l’héroïne partagée entre ce que Freud aurait appelé un Surmoi de fer extrêmement exigeant et les passions et les désirs qui réémergent à plusieurs moments du récit, mais auxquelles elle ne cède jamais d’emblée. C’est donc un personnage calme en surface mais intérieurement tourmenté, qui, en termes de psychologie, ne se connaît pas elle-même, ou n’accepte pas toujours de se connaître. Quand elle se reconnaît, peine à opérer un choix. Et quand elle choisit, elle choisit durement, tranche dans le vif de sa propre existence et est capable de pleurer tout en continuant à faire ce qu’elle considère comme son devoir. Quels dilemmes, quelles souffrances, mais quelle force ! Si ce n’est pas une héroïne, je ne sais pas ce que c’est.
Cette dimension religieuse a aussi son importance dans la relation entre Jane et Rochester. Tout aussi déterminé que Jane, M. Rochester est un propriétaire riche et impulsif, mais dont les choix brusques ont quelque chose du caprice. C’est une sorte de Heathcliff en mode mineur, beaucoup plus apprivoisable et avec un potentiel nounoursesque que Heathcliff, entièrement constitué de côtes et de dents, ne peut jamais avoir. (Soyons clairs : entre ces deux hommes, le personnage littéraire qui crève les pages est clairement Heathcliff. Mais s’il fallait choisir entre les deux dans la vie réelle, il n’y a pas moyen, c’est Rochester qui fait le meilleur mari. Entre la figure romanesque qui marque au fer rouge la mémoire de son lectorat et un personnage moins affreux mais plus humain, Charlotte Brontë a préféré rester dans l’humain.) Rochester a des défauts moraux et, assez vite, la relation qui se noue entre les deux prend des allures de rédemption morale pour Rochester. Ce qui est très intéressant, c’est qu’à aucun moment Jane ne se passionne pour la religion et que Rochester, de son côté, ne cesse de lui donner des surnoms moitié moqueurs et moitié fascinés qui lui confèrent une allure surnaturelle : il la traite de fantôme nocturne, d’elfe, d’esprit, de changelin, etc. Il la situe, quant à lui, tantôt du côté de la perfection morale, tantôt du côté de la magie et de la croyance au surnaturel, ce qui, dans ce roman, est une façon de dire qu’il hésite à la craindre.
Thornfield Hall, la demeure de Rochester, où Jane entre comme gouvernante, montre assez vite une caractérisation ambiguë. Difficile de ne pas trouver une nouvelle dimension allégorique dans le nom de cette demeure, ce « champ d’épines » (thorn) où elle affronte de nouvelles épreuves. Jane vient pour faire l’éducation d’Adèle, une petite fille française, c’est-à-dire, dans l’esprit des Anglais de l’époque, forcément une petite coquette capricieuse qui ne pense qu’à la mode, et qui pourrait mal tourner au point de devenir comme les frères et sœurs adoptives qui martyrisaient Jane à Gateshead. Jane se rêve donc en éducatrice morale à la fois pour Adèle et pour Rochester, pour son élève et pour son maître. C’est en partie de cette manière qu’elle assoit une certaine autorité paradoxale sur ceux qui lui sont supérieurs par leur position sociale et leur richesse. Mais ce « champ d’épines » devient un lieu de souffrances aux allures d’enfer pendant certaines nuits, quand de sinistres événements font soupçonner à Jane la présence d’une femme dangereuse au statut mystérieux, qui devient vite une véritable figure du Mal.
Un personnage de la dernière partie du roman vient boucler la boucle en matière d’éducation religieuse : St John Rivers, le pasteur calviniste, incarnation d’une religion extrêmement exigeante et austère qui sacrifie toute passion et même tout souci des relations humaines, amoureuses, amicales et même familiales, au service d’une ambition dévorante. Je ne vais pas dire exactement quelle relation Jane noue avec ce Rivers, pour ne pas gâcher le plaisir aux gens qui n’auraient pas encore lu le roman, mais c’est un personnage qui tient un rôle important dans le dernier tiers de l’intrigue. En ayant lu tout ce qui précède, je m’attendais à ce que Jane Eyre le trouve vite insupportable. Il faut dire qu’à mes yeux de lecteur des années 2010, sa relation avec Rivers est ce qu’on qualifierait actuellement de « toxique », tant il entre de manipulation émotionnelle dans l’influence que Rivers se bâtit sur Jane Eyre. Il ne cesse d’exiger labeur, renoncements et sacrifices de la part des autres, au service moins de la cause qu’il prétend servir que de ses propres ambitions de carrière, le tout avec l’habituelle excuse (Dieu). Il est prêt à broyer des humains, y compris ses proches, au service d’une cause supposée sauver leur âme ; à mes yeux, il fait plus que friser le fanatisme. Jane va-t-elle le chasser ou le fuir en deux pages ? Non ! Quoi de plus logique, en somme, de la part d’une jeune femme qui a été capable de se passionner pour Helen Burns ? La ferveur presque mystique de Helen a profondément marqué Jane, ce qui lui ménage une épreuve morale encore plus difficile à surmonter pour pouvoir trouver le bonheur.
Cette emprise insecouable de l’éducation religieuse de Jane Eyre va jusqu’au point où même le bonheur qu’elle trouve à la fin du roman ne lui semble avoir été rendu possible que par un grand malheur qui légitime à ses propres yeux son attirance amoureuse en lui ajoutant une forme de caution morale liée à la charité chrétienne, car l’objet de ses sentiments a désormais besoin d’elle. Jane hésite tellement que, sans ce rebondissement, elle aurait peut-être continué à s’interdire de rechercher la personne qu’elle aime. À mes yeux, c’est une torture absurde et effrayante, mais c’est, je crois, assez représentatif des circonvolutions morales auxquelles se trouvaient bel et bien soumis les gens de ce pays et de cette époque.
Conclusion
Il y aurait bien d’autres aspects de Jane Eyre à commenter et à expliquer, mais ces analyses ont été faites depuis longtemps par d’autres et de bien meilleure façon qu’ici. Mon but, avec celle-ci, était seulement de montrer la profondeur et la subtilité des personnages, de leurs relations et des dilemmes auxquels Jane Eyre est confronté, dilemmes qui forment plusieurs des principales péripéties qu’elle doit affronter au fil de l’intrigue.
Ce ne sont pas les seules, et d’autres sont de véritables dangers physiques qui confèrent au roman certaines de ses pages les plus sombres : Jane Eyre se trouve à plusieurs reprises seule et menacée de mort par diverses circonstances, qui ne doivent pas grand-chose aux ficelles du roman d’aventure, mais beaucoup à celles du roman réaliste à la Dickens (surtout dans la première moitié du livre), ce qui les rend d’autant plus poignantes. La pauvreté, la famine, la marginalisation sont mises en scène d’une manière saisissante.
On l’aura compris : j’ai été pleinement convaincu par Jane Eyre qui mérite amplement son statut de classique de nos jours. Il m’apparaît moins en rupture frontale avec son époque et moins « hantant » (pour reprendre un mot anglais) que Wuthering Heights d’Emily Brontë, mais il forme une intrigue adroitement composée et brille surtout par ses personnages admirablement campés, tout en disant beaucoup de choses sur son époque. Il faudrait aussi parler du style de Jane Eyre, ce mélange de retenue, de lucidité et d’envolées passionnées vite contenues. Si Wuthering Heights est un orage qui dévaste tout sur son passage pour nous laisser trempés, transis et choqués, Jane Eyre est un nuage de tempête qui n’éclate pas, mais dont les éclairs aveuglent d’autant plus sûrement qu’ils demeurent peu nombreux.
À qui recommander Jane Eyre ? Aux amoureux du romantisme pas trop noir, de la campagne anglaise, des personnages féminins grandioses et de psychologie fouillée. Le premier tiers du livre rappelle beaucoup Dickens. La partie centrale du roman, où Jane Eyre est gouvernante à Thornfield, montre une peinture peu flatteuse de l’aristocratie anglaise qui ne déplaira pas aux amateurs de romans à la Jane Austen et de séries à la Downton Abbey. La relation entre Jane Eyre et St John Rivers constitue une partie moins connue du livre, mais pas la moins intéressante en termes de psychologie. Quant à la relation entre Jane et Rochester, elle constitue un incontournable des lectures romantiques.
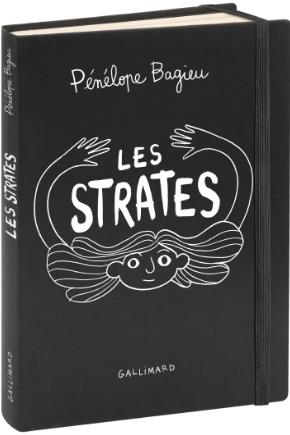



 Publié par Liber
Publié par Liber